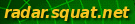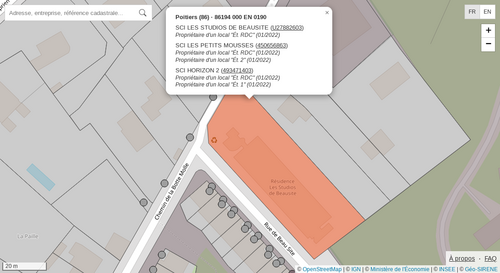Ancrages, Les Tanneries, 1997 – 20..
À l’hiver 1997, une bande de punks s’immisce à coups de masse dans une friche industrielle à l’odeur de sel et de cuir, boulevard de Chicago à Dijon. Après quelques teufs sauvages et chassés-croisés avec les agents municipaux, il est décidé de se barricader sérieusement, de s’installer définitivement et de donner naissance à l’espace autogéré des Tanneries [à l’automne 1998].
En 2001, après plus de deux ans de bataille pour retarder l’expulsion, les deux candidats favoris au poste de maire de la ville finissent par trouver judicieux, électoralement parlant, d’inscrire la légalisation de l’occupation du lieu dans leur programme de campagne. Il faudra quelques pressions supplémentaires pour que le vainqueur socialiste ne revienne pas sur sa promesse dans les mois qui suivent, et finisse par signer une convention précaire.
En 2008, alors que le ministère de l’intérieur se focalise sur la menace « anarcho-autonome », un rapport des Renseignements Généraux, intitulé « du conflit anti-CPE à la constitution d’un réseau pré-terroriste international », définit l’espace autogéré des Tanneries comme une « plaque tournante » de la mouvance en France. Le rapport précise qu’il sera dur de se débarrasser de cette « base matérielle ». Il pointe les risques posés par la fin, en 2011, de la convention passée entre la mairie et les Tanneries et prophétise en cas d’expulsion des émeutes comparables à celles survenues à Copenhague en 2007 à l’occasion de celle du centre autonome de la jeunesse Ungdomshuset.
Début 2009, la manchette du journal local affiche « les Tanneries, c’est bientôt fini ? ». Un peu plus de deux ans et quelques tergiversations plus tard, le conseil municipal décide, à l’issue d’un débat houleux, de financer à hauteur d’un million et demi d’euros les travaux nécessaires au relogement des Tanneries, présentées par la bouche même de l’adjoint à l’urbanisme comme alternativement « espace subversif et anticapitaliste » et « centre de culture urbaine ».
Les Tanneries ont traversé la dernière décennie avec passions et polémiques. Aussi bien, d’ailleurs, c’est la décennie qui a traversé les Tanneries : de l’antimondialisation aux luttes territoriales, se plonger dans les souvenirs et les archives, c’est s’offrir une balade dans l’époque. Après bientôt 15 ans d’existence, il y aurait mille façons de raconter l’histoire du lieu, les histoires du lieu. Si les murs décrépis tiennent encore debout (pour la plupart), c’est qu’ils sont solides de tout ce qui les a traversés depuis le début : du punk-rock aux amitiés entêtées, de l’anarchie aux ateliers mécaniques.
Rédacteurs de ce texte, nous sommes aussi les réducteurs de cette histoire, et avons choisi un bout de la lorgnette, et retenu l’idée d’« intervention ». D’après la taxinomie héritée du mouvement squat de la décennie précédente, les Tanneries sont en effet classées, au moins pour la période non litigieuse d’avant le conventionnement, dans la catégorie des squats politiques. C’est-à-dire qu’en plus d’y vivre ou d’y exercer diverses activités pratiques – raison d’être de tout lieu occupé – on prétend y contribuer à changer le monde.
Nous pensons, esprits retors que nous sommes, qu’il existe quelque chose comme un mouvement révolutionnaire, alors même que ses manifestations sont aujourd’hui si confuses ; et nous avons tenté d’y prendre part, depuis Dijon et en lien avec toutes sortes d’autres lieux et groupes. La participation de quelques hangars en périphérie d’une ville moyenne occidentale à la constitution de ce mouvement n’étant pas a priori assurée, il a fallu trouver des façons de se projeter dans le quartier, la ville, le monde entier (on verra qu’en fait on a plutôt suivi le chemin inverse…). Si au fil des ans la prétention n’a pas changé, les orientations suivies ont relativement évolué. Le recul nous donne le sentiment de voir se dégager quelques grandes périodes, chacune prise dans leurs ébullitions et leurs limites, et ce même si la réalité fut sans doute beaucoup plus entremêlée.
Note : Les relectures a posteriori sont trompeuses et l’envie de faire émerger des hypothèses est nécessairement simplificatrice. Si certaines de nos tentatives étaient présupposées et explicitement formulées, d’autres se sont révélées en chemin de manière beaucoup plus empirique et organique. Ce retour sur l’histoire se présente comme une recherche plutôt qu’un communiqué collectif. Pionniers ou compagnons arrivés en chemin, nous assumons ici une grille de lecture partisane sur un lieu qui reste marqué, au-delà des gestes et paroles régulièrement portées en son nom, par une hétérogénéité de groupes et de visions. Ajoutons que ce décorticage à cœur ouvert d’un processus en cours nous a paru utile mais d’autant plus malaisé qu’il ne tient pas lieu d’autopsie et l’on présume bien qu’il puisse titiller quelques bureaucrates tatillons de l’autre côté des barricades. On fera avec.
COURSES D’ORIENTATIONS POLITIQUES
1998 – 2002 – Mouvement squat, identité, contre-culture et activisme
« Anarchiste », « anticapitaliste », « punk », « Do It Yourself », « (pro-)féministe », « vegan », « antiautoritaire ». Dans les premières années, le fronton des Tanneries se pare de tout un tas d’étiquettes qui cherchent à affirmer des identités croisées. Il s’agit de constituer « notre monde » et d’être rejoint à partir de la défense de « nos espaces ». Dans la foulée des Tanneries, les maisons occupées essaiment, des intersquats se forment et constituent une contre-ville. Entre street-party crusty et blocus de la préfecture, on se focalise sur les ennemis « évidents » : répondre aux offensives des fachos qui nous tirent dessus en passant des nuits sur des toits avec quelques projectiles, parer aux incursions policières, trouver des avocats et barricader nos lieux. Même le combat contre l’expulsion est à la fois populaire et de fait autocentré.
Car les Tanneries sont d’abord le fruit d’une lutte acharnée pour rester. Nous décidons dès les premiers mois d’occupation de mettre en branle sans trop de chicanes et de barrières idéologiques un panel large de moyens de pression : concerts de rue et manifs à répétition, portes ouvertes et permanences en ville, occupations, enchaînements et irruptions dans les bureaux du maire, traques des apparitions des élus et présence devant les réunions électorales, lettres d’interpellation et embouteillage des communications à coups de fax, mails et coups de fil, guérilla médiatique et harcèlement visuel dans la ville, conflit franc et invitations à négocier… Après une attaque incendiaire anonyme qui détruit complètement notre premier espace de vie et qui se conclut par des tentatives d’expulsion, une interdiction de demeurer sur les lieux et un procès, on décide de dégager les décombres et de continuer l’aventure dans les hangars attenants. Des camarades d’autres villes de l’Est, de Suisse ou d’Allemagne, attirés par le remue-ménage et les appels répétés, viennent régulièrement nous prêter main-forte.
En parallèle, le mouvement « anticapitaliste » resurgit à l’échelle (alter)mondiale. C’est le temps du « we are everywhere », et nous faisons feu de tout bois, sans forcément qu’il soit primordial de savoir en quoi cela pourrait s’ancrer spécifiquement dans la vie dijonnaise. Les Tanneries servent de centre de convergence pour aller à Davos [1], ou au G8 d’Évian, pour les contre-sommets. On se lance gaiement à l’assaut de l’industrie pétrolière ou de la finance en bloquant des stations-service et des banques pendant Seattle, on fait irruption dans les centres commerciaux contre les OGM ou le Plan Colombie [2]… Il s’agit de participer aux « campagnes de solidarité », de débarquer régulièrement au consulat italien pour soutenir les premiers anarchistes incarcérés pour des sabotages sur les chantiers du TAV dans le Val Susa, mais aussi de contribuer activement aux réseaux plus larges qui se constituent en cette fin de siècle, à la recherche de structures communes et de perspectives stratégiques : en quelques années les Tanneries se retrouvent imbriquées dans un vaste maillage, entre intersquats, indymedia, Sans-Titre, infokiosques, anar-geeks, Action Mondiale des Peuples [3]… et gagnent leur statut de plaque tournante !
2003 -2005 – Voyages et micro-politique
Si les activités continuent aux Tanneries, nos élans politiques s’essoufflent parfois et le collectif des habitant.e.s se fait et se défait. Après quelques années d’intense agitation certain.e.s ressentent le besoin de changer d’air. On tente de rebondir et on fait même appel un temps à nos potes de partout pour imaginer un relais et une « non-permanence » formalisée sur les Tanneries, par peur d’une désagrégation subie. Les habitant.e.s ont souvent à ce moment-là un pied à Dijon, un pied ailleurs, et le regard à l’affût d’aventures à l’autre bout de l’Europe. Par chez nous, sortis de l’urgence permanente, on prend le temps de se creuser la tête sur nos formes d’organisation et nos relations, parce qu’on a beau brandir comme credo le refus des dominations, cela relève plus d’un perpétuel chantier que d’un quelconque décret, et on se rend bien compte que les dominations en question se terrent aussi bien dans nos propres maisons que derrière les barrières des zones rouges des contre-sommets. Les Tanneries sont alors le lieu d’une « micropolitique des groupes » expérimentale, qui s’attache à décrypter les rôles et les scléroses, à trouver des formes qui structurent le collectif et ses échanges, en essayant de ne pas l’enfermer pour autant dans une somme de tableaux comptables. C’est aussi un moment de recherche de réponses qui nous soient propres, sans flics, sans juges et sans docteurs, vis-à-vis d’agressions ordinaires et autres pétages de plombs spectaculaires qui plombent parfois les ami.e.s et la vie du lieu. Nos batailles pour déconstruire certaines normes dont on se délesterait bien et s’autonomiser vis-à-vis des institutions passent par des initiatives croisées : rencontres féministes ou groupes de parole entre mecs sur la masculinité, découverte de l’antipsychiatrie, remise en cause des « chefs », échanges de savoirs informatiques ou électriques… Si l’usage systématique des petits groupes, tours de parole ou autres « points météo [4] » est aujourd’hui révolu, les attentions qui se forgent à l’époque vont continuer à bouleverser radicalement nos réflexes et nos focales. Cette première période sans menace d’expulsion est aussi mise à profit pour aménager, refaire la plomberie ou se chauffer et construire des locaux plus adaptés : atelier informatique au fond d’une cave, mezzanine, kiosque et ateliers…
2005-2008 – Retours et recherche d’ancrage
De nos pérégrinations, nous retenons une confrontation à des dynamiques plus territorialisées, des luttes de quartier barcelonaises à l’occupation pendant plusieurs mois des arbres du parc Paul Mistral, en plein centre-ville grenoblois, contre sa destruction. Nous observons là-bas le travail méticuleux pour documenter et répondre à l’emprise du conglomérat technoscientifique en termes sociaux et urbanistiques. Nous en revenons avec le désir d’aller au-delà des généralités sur l’« exploitation capitaliste » ou la « consommation » et de décrypter les enjeux et tensions spécifiques à l’endroit où l’on vit.
Du côté de Dijon, on aspire aussi à moins tourner sur nous-mêmes. On forme des groupes de circonstance et des collectifs temporaires, en prenant soin de ne jamais s’afficher comme « les Tanneries » pour ne pas être directement catalogués. Au final, on se retrouve à se réunir plusieurs fois dans la même semaine, avec à peu près les mêmes gens, sous un nom différent : collectif « un toit pour toi », « silence on tourne », « CPE-LRU-RTT (Chômeurs-Précaires-Étudiants Lycéens-Rageurs-Utopistes Révoltés-de-Tout-Temps) », assemblée des Tanneries, caisse de solidarité, groupe informel…
Quand le CPE nous tombe dessus, on y débarque avec un peu de retard, une cuisine collective et un infokiosque pour l’occupation de la fac. On tente de peser à l’extérieur des AG, depuis les marges, par un ensemble d’actions qui changent la tonalité du mouvement… Notre crew se retrouve et s’ouvre pleinement pendant quelques semaines où l’on se rappelle, au comble de l’excitation, que l’on vit aussi beaucoup pour ces moments-là. Entre rencontres singulières avec une nouvelle génération en rébellion et explosion des possibles dans une ville devenue terrain de jeux et d’actions quotidiennes au sommet des grues, dans la rue ou en déménageant les locaux de l’UMP, on se sent pris dans un tournant où, pendant quelque temps, les manières de penser et de faire la politique qui nous animent vont entrer en résonance et se retrouver parfois motrices dans des mouvements sociaux larges et transversaux.
2007 – Bras de fer
En 2007, un fonctionnaire inconnu frappe un soir à la porte pour nous informer de pourparlers secrets entre une multinationale de santé et le maire qui souhaite leur revendre les terrains des Tanneries. Deux jours plus tard, nous entrons en trombe et en furie dans le conseil municipal. Keny Arkana nous propose un concert sauvage de soutien devant la mairie le soir des élections. Un samedi lors d’une première manifestation, nous hissons des cabanes dans les arbres qui longent la mairie et annexons le parc en contrebas. Embrouilles avec la Préfecture, le GIPN tarde à intervenir. Le dimanche matin, le maire se pointe dans un bar du coin et signe une nouvelle convention sur 5 ans. Au conseil municipal du lundi, les ténors de la droite pestent, et s’entendent rétorquer : « Si vous voulez faire de l’expulsion des Tanneries votre prochain cheval de bataille électoral, allez-y, je vous souhaite bien du courage ! » Cette année-là le mouvement contre l’expulsion du centre autonome Ungdomshuset est un point de référence majeur : nous observons avec attention comment les amis danois ont jonglé habilement entre manifs familiales de masse, coups médiatiques et appels aux « brigades internationales » pour venir s’attaquer en bloc à la police. Nous nous émouvons de la manière dont après l’expulsion, l’embrasement de la ville pendant trois jours, les nombreuses incarcérations qui suivent et le refus de la mairie de « traiter avec des terroristes », ils continuent pendant un an, chaque semaine, à réinventer des manifestations à chaque fois différentes jusqu’à obtenir un nouveau lieu. Nous observons comment une lutte partie du « ghetto squat » se mue en un défi politique qui finit par scinder la population et par pousser des dizaines de milliers de personnes à s’engager. Leur détermination donne du souffle, le sens d’une camaraderie à la fois dense et dispersée à travers l’Europe. Elle nous pousse, l’année qui suit, à appeler à des journées internationales de résistance des squats et espaces autonomes pour marquer un front commun face aux politiques répressives.
2008 et au-delà, assumer une entité
Trêve de dissimulation, nous admettons au bout d’un moment que dans cette petite ville, tout le monde se dit que nous sommes « les tanneurs » et que nos présences opaques créent souvent plus de méfiance qu’autre chose. C’est dans ces années, à partir d’un collectif plus stable, que les Tanneries s’affichent plus ouvertement : un espace de construction ET d’offensives, un espace d’où se constitue une entité politique, visible, nommée, rejoignable, qui cherche à agir sur la ville. Un détour chez les camarades du centre autonome Ifanet à Thessalonique, au soir des révoltes de l’hiver 2008, nous permet d’interroger leur choix d’assemblées politiques ouvertes hebdomadaires et de creuser nos propres partis pris, dans un contexte français où cette jonction entre lieu de vie, d’activité et d’organisation offensive est plutôt timide… Hormis dans les rapports policiers.
C’est qu’après des années d’existence et d’activisme débridé où les expériences s’additionnent et s’éparpillent, le besoin de stabilité se fait sentir, pas seulement en ce qui concerne l’assurance de garder le lieu mais aussi dans les formes d’interventions politiques. Il nous semble alors que les Tanneries peuvent être autre chose que la tanière d’un groupe, que le lieu d’un milieu : une force politique à l’échelle de la ville, au moins. Nous voulons être le point d’articulation entre un tas de dynamiques : squats, potagers, concerts, journaux, actions ou caisse de solidarité. Cette aspiration est régulièrement l’objet de controverses, et nos cœurs balancent entre volonté assumée d’incarner un mouvement et primat à la singularité des énergies par peur des tendances hégémoniques et centralisatrices.
Le mouvement des retraites de 2010 est l’occasion de s’affirmer comme une créature polymorphe mais cohérente. Contrairement à ce qui s’est passé pour le CPE, le fait de venir des Tanneries ne nous donne pas l’impression d’arriver de l’extérieur, et de devoir s’y cantonner. Il s’agit d’être un point à partir duquel se relient des pratiques et des contenus politiques, des outils de coordination et de rencontres par le biais d’un bulletin de grève, de la participation au comité de lutte, de ressources juridiques et financières en cas de répression, etc. On est une bande large et aux contours flous mais avec une force d’action indéniable, des matériaux, réchauds et véhicules pour porter matériellement les blocages, un espace où se réunir et continuer à se voir si la mayonnaise du mouvement retombe…
Cet ensemble ne se tient pas sans retomber parfois dans les formes classiques de l’organisation militante, de son speed gestionnaire et de ses agendas noircis par une succession de réunions. Notre salut tient à un certain refus de la séparation entre nos vies et nos luttes, et aux moyens partagés au sein de la grande maison ou avec d’autres bandes, aux dérives et aux apéros, aux amitiés sur lesquelles on peut compter dans les coups durs ou pour ne pas raccrocher face aux injonctions normalisatrices, aux équipées à l’autre bout de la France, aux mains dans le cambouis, aux danses jusqu’au petit matin et à ce que nous nous attachons à produire très concrètement ensemble. Il est bien téméraire de parler de « politique » sans au moins mentionner cette vibration collective et ludique, cette intensité des liens au quotidien et la sédimentation affective qui donne un sens à l’existence et permet de se risquer à lutter.
On sent qu’on peut peser localement, initier des luttes contre ce qui menace directement de contenir nos existences, comme la vidéosurveillance, le fichage ADN, ou le rouleau compresseur éco-urbanistique ; ou développer des solidarités avec des ouvriers en grève, ou des migrants pourchassés qui s’immiscent dans la ville et dans notre quotidien… On croise un tas de monde, militant de gauche, prolo débrouillard, humanitaire catholique ou chômeuse heureuse. Une partie de l’énergie est orientée autour des déplacements possibles plutôt que sur la recherche permanente de marquer une rupture nette. Dans une ville de gauche où les milieux militants et culturels sont tellement inféodés aux autorités locales et reclus dans l’indignation 2.0, on espère contribuer à ce que certains posent des actes et assument des conflits. On se prend quand même plus d’une fois des murs et des réus sclérosées à s’en taper la tête, mais l’endurance crée aussi des brèches. Il y a une certaine jubilation à recroiser une mère d’élève en tailleur qui raconte comment elle a fini par bousiller la borne biométrique du lycée, ou à s’emparer d’un internat vide en manif en face du tribunal avec le soutien officiel de tout ce que Dijon compte d’assos citoyennes et humanitaires, au grand dam de la préfecture. Il n’est pas aussi facile de neutraliser les positions paternalistes vis-à-vis des 300 migrants qui s’installent des mois durant dans l’internat, mais on essaie quand même, à notre sauce et à l’interface, de faire en sorte que des luttes « autonomes » puissent naître.
Isolées entre un boulevard et une friche industrielle, les Tanneries n’ont eu pendant longtemps pour seul voisin qu’un orchestre de musique napoléonienne qui se contenta de jouer l’« hymne à la joie », sourire en coin, alors que notre bâtiment était en train de cramer en 2001. L’occupation en mars 2010 de terres maraîchères menacées à deux rues de chez nous crée le déclic nécessaire à un rapport nouveau au quartier. On se met à rencontrer les voisins et à causer jardin. D’autres maisons sont squattées, ainsi qu’une ancienne boucherie industrielle avec un groupe de réfugiés d’Afrique de l’est. Au printemps 2011, des familles du coin, des bandes de potes viennent défricher d’autres parcelles, poser des ruches… Des Rroms s’installent dans les anciens abattoirs voisins et quelques paysans sans terre restaurent un champ lunaire récemment passé au tractopelle par la mairie. Tous ces groupes se frottent et s’entremêlent lors de boums, de repas, pour remettre le jus ou répondre aux incursions policières. Les Somalien.e.s viennent manifester pour le potager devant la mairie et nous invitent à regarder des images de Mogadiscio, au retour d’un feu d’artifice devant la prison. On a le sentiment d’une communauté qui se construit, hétéroclite, précaire, mais bien vivante, loin des rêves lisses des urbanistes et de leur « éco-cité » pour laquelle tout ceci devrait bientôt être rasé.
LES TANNERIES ET LE « MOUVEMENT »
Visibilité
Nous avons fait le pari qu’un mouvement avait parfois besoin de « vitrines », aussi trompeuses soient-elles sur la structuration et la répartition réelle de ses forces, aussi dangereux que soient les miroirs déformants et les focalisations sur des points donnés. Il ne s’agissait pas de contester le choix d’apparitions diffuses, « révoltés anonymes de la guerre sociale » ou rien du tout – à partir d’un bar clando, d’une ferme paumée, d’une coloc’ proprette, d’une nuit sans lune, d’une fac occupée ou d’une route calcinée… Nous entendions la pertinence de repousser les espaces identifiables, les catégories classiques du politique et les costumes attendus. Il nous a pourtant semblé tout aussi nécessaire que des lieux ou des groupes circonscrits avec suffisamment d’assise et de présence dans la durée puissent assumer des énoncés publics et des solidarités – que ce soit avec ceux qui pètent des vitrines à Dijon le soir de l’élection de Sarkozy, ou avec les inculpés de l’antiterrorisme dans une période où d’autres pouvaient préférer, avec leurs bonnes raisons, ne pas afficher de liens… Il ne nous apparaissait pas forcément contradictoire de démonter d’un côté les désignations d’« anarcho-autonomes », et de pouvoir répondre de l’autre, en cramant des fumigènes devant la pref’ avec le Réseau Éducation Sans Frontières [5] : « peut-être et alors ? Nous sommes soutenus, entourés et fiers de ce que l’on crée » plutôt que : « non pas du tout, restons cachés ! »
Nous avons jugé joyeux d’être un repaire d’où l’on pouvait sortir en bande avec des palettes pour un blocage de la zone industrielle voisine, avec un tas de fourches pour aider à une occup’ des terres d’à côté ou pour une boum sur le boulevard, où l’on puisse rentrer d’un péage gratuit ou d’une manif remuante poursuivi par la BAC, fermer les grilles et faire des pieds de nez… quitte à se retrouver un après-midi avec un escadron de gendarmes mobiles devant chez nous, missionnés pour empêcher le départ d’une chasse au trésor cycliste dont ils pensaient qu’elle camouflait une émeute [cf. constellation « fête sauvages »]. Parce qu’effectivement, la visibilité fait qu’il est par ailleurs plus délicat d’échapper aux soupçons policiers et de brouiller les identités. Elle implique que certaines actions puissent avoir des conséquences directes sur un espace, avec la menace que cela pèse dans certains choix. En même temps quand les commentaires du canard local nous relient de toute façon peu ou prou à tout ce qui trouble ou salit la ville, et en appellent régulièrement à nous passer au lance-flammes, ça finit par noyer le poisson.
Nous avons choisi d’être un lieu d’où pourraient partir des bus ou des appels, et de tisser des ponts entre Dijon-boulevard de Chicago et Davos, Vichy ou Valognes, des jumelages avec Notre-Dame-des-Landes, de fournir un espace de rencontre et d’organisation pour des journées d’action intersquats européennes, des réseaux de geeks ou un G8… Le patchwork Tanneries et nos positions atypiques, qui n’ont pas échappé aux critiques lapidaires venues de différents milieux radicaux, ont au moins permis à diverses écoles de s’y croiser et de nous traverser. De chantiers collectifs en invitations à venir se poser quelque temps, les Tanneries ont offert une porte d’entrée suffisamment accessible pour un tas personnes qui rêvaient de se barrer de leur vie d’avant ou de se raccrocher à des mondes en lutte.
Quelles qu’aient été nos diverses manières d’apparaître à la ville, notre vieille usine taguée a conservé une façade à la fois poreuse et rugueuse. Elle devient un symbole appropriable quand des lycéens se construisent des cabanes au fronton graffé « tanneries 2 » devant leur lycée pendant les blocages du CPE, ou quand on entend tous ceux qui disent mythiquement avoir « ouvert les tanneries » ou s’en sentir acteur sans qu’on les connaisse forcément.
D’un autre côté, si on est une « vitrine », elle n’est pas tout à fait transparente : les Tanneries vivent aussi à travers l’existence plutôt bien délimitée d’un groupe « tanneurs » pas forcément facile d’accès. Notre histoire est celle d’une composition aussi tendue que soudée, entre un collectif anarcho-punk presque trentenaire et un collectif de vie autour duquel se tisse une nébuleuse existentielle et politique. Le lieu a beau se vouloir ouvert à un tas d’initiatives à partir de quelques principes autogestionnaires, on sent bien qu’il n’est pas toujours facile de contourner ces piliers, et de se l’approprier. Son alchimie se tord toujours entre assemblées publiques, alliances claires et accueil de projets et soirées plus hétérogènes qui parfois accrochent et parfois clashent.
L’assise des Tanneries et le soutien hétérogène dont elles ont bénéficié pendant toutes ces années tiennent sans doute à leur caractère hybride et à l’impossibilité de les enclore dans un univers prédéterminé. La défense de l’espace autogéré part d’un collectif de vie qui l’habite au quotidien et de l’ouverture large liée à l’aspect « centre social », aux concerts et à leur aura de « légitimité culturelle ». Dans le même temps le pendant politique tranché marque un rapport au monde, une histoire et un mouvement auxquels se référer, une présence à partir de laquelle nous ne pouvions être confondus avec une simple expérience alternative ou artistique. Le labyrinthe de hangars, de grands espaces ouverts couverts de peinture et de constructions hétéroclites dessine un contre-territoire dans la ville, univers palpable et difficilement récupérable, à l’interface entre « citoyens dijonnais », « jeunesses réfractaires » et outre-mondes sans-papiers, freaks ou déserteurs qui passent et se posent par ici. Et si l’aventure anarcho-punk dont le lieu était issu a parfois participé d’une certaine clôture identitaire, on doit aussi à sa persistance une part d’énergie à rebrousse-poil des tentatives de lissage.
Nous ne sommes pas toujours sûrs de ce qui nous relie réellement aux centaines de personnes qui passent ici chaque semaine, majoritairement dans des soirées, souvent « en soutien », mais généralement surtout pour se déhancher ou boire des coups. Il s’y développe sans doute au moins une sensibilité à un univers décalé sans vigiles ni profits, des possibilités de croisement et de diffusion de prises de positions et quelques transes suantes enchevêtrées. Dans cette ville réduite, nous avons beau être ces trublions intempestifs qui osent tenir tête aux autorités, sortir le maire d’une manif’ ou lui faire craindre des troubles lors d’un G8 des universités annulé au dernier moment, nous ne sommes définitivement plus une force anonyme, qu’ils pourraient simplement éradiquer sans déclencher une levée de bouclier au cœur même de la cité. Parce qu’à force, une bonne partie de Dijonnais.e.s, certains travaillant au sein même des structures qui gèrent la ville, ont fini par s’attacher d’une manière ou d’une autre à notre existence. Sur ce terreau, les Tanneries se sont perpétuées entre tension dans la rue et injection d’un certain type de dialogue : imaginer pouvoir imposer des négociations et se pointer dans leurs bureaux sans baisser la tête, parce qu’il y a aussi des confrontations à mener sur ce terrain-là et la possibilité que certains face-à-face entérinent plus de possibles que de renoncements.
En dur
Le pari de la légalisation
La politique radicale et ses objectifs maximalistes nous contiennent parfois dans un certain sentiment d’impuissance. Pourtant, la certitude qu’il est possible aussi d’arracher quelques victoires concrètes tient ici lieu d’acte fondateur et de mythe commun même à ceux et celles arrivé.e.s après les premières batailles.
Des débats intenses s’amorcent dans les premiers mois d’occupation sur l’issue de la lutte avec la mairie et la possibilité d’aboutir à une convention d’occupation, parfois perçue comme un défi « impur ». Cette problématique relativement neuve par chez nous en ce qui concerne les squats dits « politiques » renvoie à des conflits qui ont marqué les Kraakers hollandais, Hausbesetzer allemands, ou Occupanti italiens et à l’analyse selon laquelle la « légalisation » d’un certain nombre de lieux a été un levier pour diviser le mouvement et acheter une certaine « paix sociale ». Nos voyages à travers l’Europe nous permettent de nous rendre compte aussi à quel point ces mêmes mouvements peuvent bénéficier d’un certain nombre de structures stables. Difficile de solder le débat. Nous nous prenons bien la tête… et mettons la main à la pâte puisque nous faisons le pari mais aussi le compromis de travaux de mise aux normes conséquents sur une partie du bâtiment, pour briser ce qu’il reste à la mairie d’arguments publics pour nous virer. Nous nous risquons après coup à une convention parce que les négociations partent d’un rapport de force et que nous décidons que ce bout de papier en sera la marque plutôt qu’une bride. Nous vérifierons au fil des années que notre marge de manœuvre tient effectivement avant tout au terrain politique et à nos élans désinvoltes, et pas tant aux règles et clauses inscrites sur papier qu’il est toujours possible de se donner les moyens de transgresser.
Notre rage d’ancrage a d’abord été guidée par l’envie d’affirmer que ce qui nous étreint n’est pas qu’une folie de jeunesse ou une digression colérique avant de rejoindre les chemins tracés. Les lieux communs selon lesquels les utopies collectives finissent forcément en eau de boudin et ne peuvent être le choix d’une vie sont les premiers arguments posés par tous ceux qui veulent se rassurer sur le fait qu’il n’y avait pas d’autres possibilités pour eux et pour les autres. Jusqu’au sein des milieux radicaux, notre génération, échaudée par la mémoire floue des dits « échecs » des années 70 et fille des replis des années 80, était marquée par une aspiration libérale à pouvoir toujours décrocher, à ne jamais trop s’engager dans le temps et avec d’autres, au point que cela mine nos potentiels existentiels et politiques. 14 ans après, que l’on ait occupé ce lieu dès les premières années ou qu’on l’ait rejoint en cours de route, une de nos plus grandes forces est de pouvoir affirmer que l’on est toujours là et que l’on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Cette temporalité s’est révélée nécessaire pour apprendre et valider nos « expériences », pour ne pas avoir à tout réinventer à chaque génération, pour voir les arbres pousser devant la maison et approfondir une culture politique commune au-delà des évidences et des prêts-à-porter parachutés. Elle a permis d’entretenir une mémoire orale et archivée, des personnes-relais qui ne parlent pas qu’au passé. Ce lent cheminement a permis la constitution de réseaux : notre rapport au « mouvement » hors de Dijon, ses contacts et ses lieux éparpillés, mais aussi et surtout localement : des avocats, artisans, journalistes, architectes, maraîchers, des fils et filles de flics et de politiciens, des militants associatifs et des syndicalistes, des mécanos et métallos, des filous et des gitans ou des fonctionnaires complices qui refilent des infos.
Commencer à envisager une « force matérielle » qui nous soit propre est venu progressivement. Squatteurs urbains, déserteurs des lycées ou des facs, nous avons d’abord voué un culte à la bidouille approximative, aux mezzanines en parpaings et aux vertus du gaffer plutôt qu’au « travail bien fait » vanté par nos aïeux. Nous sommes partis de bricolages, récups, recyclages, piratages et échanges – que nous ne sommes pas prêts d’abandonner – et d’une production Do It Yourself souvent immatérielle, principalement sociale et culturelle : soirées, journaux, disques, rencontres, affiches, expertises juridiques… Nous en sommes venus à l’acquisition progressive d’outils et machines qui tiennent la route – informatique, mécanique, culinaire ou sonore – puis au désir de tenir plus de maillons d’une chaîne, de se former et de pouvoir produire de manière plus conséquente : disposer d’une imprimerie, d’une radio, de potagers, d’une brasserie, d’une boulangerie ou de ressources en bâtiment… L’élan productif tient ici autant du remède face à un sentiment d’amputation, entre nécessités pratiques et jubilations créatives, que de choix tactiques sur ce qui doit permettre d’alimenter nos interventions politiques « autonomes ».
Le monde des squats d’où nous sommes issus et dont nous ne renierons jamais la force existentielle, est pratiquement toujours à la merci du court terme où d’un recadrage répressif. Nous savions qu’il était devenu dans les années 90 presque impossible de tenir une nouvelle occupation en Allemagne malgré et peut-être du fait de l’intensité du mouvement autonome des années 80, et avons partagé les soubresauts genevois du milieu des années 2000 quand ce qui restait d’une des dynamiques squat les plus denses en Europe, terrain de découverte pendant notre adolescence, s’est fait laminer en quelques mois. Bases, refuges, fermes, maisons ou ateliers, nous estimions devoir compter aussi sur des lieux plus sûrs, dans les moments de tumultes comme dans les périodes plus froides. Nous avons rejoint à notre manière ce que d’autres ont tenté ces dernières années sur des modes différents, à la ville ou à la campagne avec des baux emphytéotiques, achats collectifs ou locations – sans nous priver du plaisir de continuer à nous immiscer régulièrement derrière des portes verrouillées.
Malgré la consistance acquise au fil du temps, nous bataillons encore avec la fragilité de ce que nous portons. Notre histoire et un certain nombre de départs témoignent de la difficulté d’habiter dans la durée des lieux publics et ouverts, de se sentir une communauté forte dans un maelström constamment traversé de nouvelles têtes, énergies, irruptions inattendues et sollicitations extérieures. Notre utopie d’un espace « total » part d’un refus de la séparation, mais reste empreinte d’une tension constante entre magie et épuisement. Notre choix de rester en ville a encore du mal à se trouver un tempo qui ne soit pas celui d’une course permanente et refuse pourtant que le nécessaire ralentissement n’ait pour point de chute que la campagne.
Le grand déménagement
En 2009, nous apprenions par la presse que la mairie devait nous dégager mais s’engageait à nous reloger « dans les meilleures conditions », pour parer à un clash renouvelé. Malgré toute notre méfiance, il nous a paru nécessaire de les tester pour voir jusqu’où ils étaient prêts à aller, d’être capables de rassembler face à une proposition qui se serait avérée ostensiblement médiocre. Nous avons à nouveau posé un certain nombre de conditions politiques à l’ouverture d’un dialogue et finalement obtenu des engagements sur la préservation de notre autonomie, sur la possibilité de déplacer l’ensemble de ce qui constitue aujourd’hui les activités des Tanneries et sur un bail gratuit et de longue durée. Dans ces conditions, nous avons fini par parier tactiquement sur la possibilité de déménager et de nous enraciner dans un espace qui nous convienne plutôt que de mener une nouvelle bataille, sans doute épique, mais dont nous estimions cette fois qu’elle aboutirait probablement à notre départ à coup de tonfas et de tractopelles. Nous avons opté pour le projet plus que pour les murs, et pour le maintien d’acquis plutôt que de nous risquer à tout recommencer. Nous sortons de longs tiraillements internes et avons testé de nouveau notre capacité à construire des points d’accords en assemblée, alimentés par des échanges avec des espaces et collectifs amis en d’autres points de l’hexagone. Si l’on se tient aujourd’hui dans ce consensus à vif, on ne doit pas oublier pour autant que ce processus a aussi contribué à l’éloignement de certaines personnes qui ne se retrouvaient pas dans une logique de négociations a priori. Nous sommes partagés entre la fierté de ce que nous avons réussi à imposer, l’excitation de poursuivre l’aventure ailleurs et la peur de nous retrouver coincés et de chuter, d’être pris malgré nous par des logiques plus conciliantes. Comme en 1999 lorsque nous nous engagions à soutenir encore plus fort les autres squats si on obtenait un jour une convention, nous nous sommes formulés collectivement des principes et garde-fous qu’il faudra éprouver avec le temps. Le premier était de couper court au dialogue si l’on sentait que des initiatives politiques qui nous sont chères commençaient à être écartées par peur que cela froisse le processus de relogement. Pendant les trois ans qu’ont duré les négociations, nous n’avons cessé, sur des terrains voisins et jusque sous leurs fenêtres, de nous entrechoquer avec la municipalité – peut-être plus durement encore que par le passé, peut-être par peur de lâcher prise. Nous ne savons pas ce que nous réserve le futur, si ce n’est de rester en chantier et de continuer à batailler sur la ville, mais nous espérons que ce texte puisse servir de jalon pour ne pas oublier d’où nous venons.
Notes:
[1] Rencontres annuelles au Forum économique mondial.
[2] Plan d’aide financière et militaire des États-Unis et de l’Union européenne initié au milieu des années 90 pour assurer leurs intérêts en Colombie. Il occasionna diverses actions de solidarités et échanges avec des communautés colombiennes menacées.
[3] Réseau anticapitaliste mondial formé en 1998 après le blocage du sommet de l’OMC à Genève.
[4] Tour de parole où chacun peut parler de ses ressentis et de son humeur du moment.
[5] Action en soutien à deux camarades parisiens inculpés pour terrorisme parce qu’ils transportaient des fumigènes dans une manifestation de sans-papiers.
[Publié dans Constellations, Trajectoires révolutionnaires du jeune 21è siècle.]
Des squats à Dijon https://radar.squat.net/fr/groups/city/dijon/squated/squat
Des squats expulsés à Dijon https://radar.squat.net/fr/groups/city/dijon/field_active/1/squated/evicted
Des groupes (centres sociaux, collectifs, squats) à Dijon https://radar.squat.net/fr/groups/city/dijon
Des événements à Dijon https://radar.squat.net/fr/events/city/Dijon