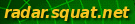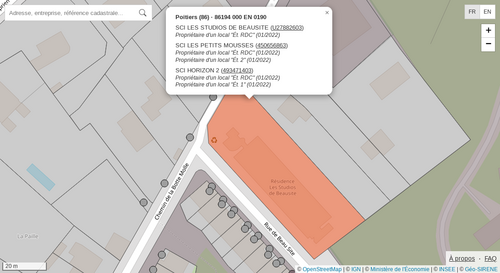Ça faisait longtemps que les groupes logements le disaient et pourtant, il a fallu les événements dramatiques entourant le 1er juillet -plus de 400 familles sans abri à Montréal et marathon de dernière minute à Québec et Hull- et l’ouverture d’un squat par le Comité des sans emploi Montréal Centre pour que les autorités et les journalistes reconnaissent l’existence d’une crise du logement au Québec.
Réalités de l’actuelle crise du logement
Deux données en particulier illustrent la réalité de la crise du logement : la rareté des logements et l’effort financier consacré à se loger. On peut mesurer aisément le phénomène de la rareté des logements en examinant le taux d’inoccupation. Par exemple, on calcule qu’un marché « équilibré » fonctionne avec un taux d’inoccupation d’environ 3% (pour que le rapport de force soit favorable aux locataires, il faut qu’il soit beaucoup plus élevé). Or, aujourd’hui, le taux d’inoccupation est beaucoup plus bas (1,6% à Québec en 2000 comparé à 3,6% il y a à peine un an, et on se dirige vers le 1%; à Montréal on parle de moins de 1% et à Toronto, où des gens meurent toutes les semaines dans les rues, c’est 0,1%).
L’autre aspect de la crise, c’est l’effort consacré à se loger. Les gouvernements calculent que du moment que quelqu’un ou un ménage consacre plus de 30% de son revenu aux dépenses liées au logement, il y a un « problème impérieux ». Or, en 1996 et ça a sûrement augmenté depuis, plus de 42% des locataires vivaient cette situation (45% à Québec et 46% à Montréal). Pire, 23% des locataires consacraient plus de 50% de leurs revenus au loyer (là ça devient carrément catastrophique).
Évidemment, ce ne sont là que deux aspects de la crise. Pour avoir un portrait complet, il faudrait également aller voir du côté de l’itinérance (15 000 personnes à Montréal en 1989) et des taudis (pas loin de 100 000 logements auraient besoin de réparations majeures, et 250 000 des réparations mineures). Évidemment que dans la situation actuelle, ça ne peut qu’empirer.
Concrètement, la situation a explosé le 1er juillet dernier, quand on s’est rendu compte que, pour la première fois depuis 1976, un nombre considérable de ménages (400) ne pouvaient tout simplement pas trouver de logements à Montréal. Et là on ne parle même pas de tout ceux et de toutes celles (surtout toutes celles en fait) qui ont du se contenter d’une merde et/ou de quelque chose de trop cher et en deçà de leurs besoins. À la fin du mois, le Comité des sans emploi, avec son action squat est revenu taper sur le clou. On peut de plus être certains que la crise refera surface en septembre quand des milliers d’étudiantEs devront trouver à se loger en ville et que les « campeurs » y retourneront.
Le marché du logement : une illustration de la société de classe
Mais, il y a plus, l’actuelle crise du logement n’est en fait que la pointe de l’iceberg d’un marché profondément vicieux, le marché du logement. Le logement, dans la société capitaliste, est à la fois un besoin vital et une marchandise. Comme toutes les marchandises, il est régit par un marché. Ce marché s’était, en 1996, un peu plus de 1,2 millions de logements locatifs qui rapportaient à leur proprios à peu près 7,3 milliards de dollars par années. Ce marché, comme tout marché capitaliste, est fortement concentré : en effet, si 85% des propriétaires de logements sont des « propriétaires-occupantEs », ils ne possèdent toutefois que 32% des logements. Parallèlement, les propriétaires immobiliers, qui ne sont que 3,5% des proprios, possèdent 53% de tous les logements locatifs. On voit ici très clairement se dessiner les contours d’une classe parasitaire.
Ceci dit, contrairement à une certaine croyance populaire dans nos milieux, les locataires ne sont plus majoritaires depuis 1976 au Québec. Ainsi, une bonne partie de la classe ouvrière a réussi à échapper au marché privé du logement et a pu « accéder à la propriété ». En effet, aujourd’hui, ce sont plus 56% des ménages qui sont propriétaires (1). Comme on s’en serait douté toutefois, ces propriétaires sont surtout concentrés en banlieue et dans les petites villes. En effet, dans les vieilles villes, les locataires sont toujours majoritaires (73% des ménages à Montréal, 67% à Québec, 59% à Hull, 64% à Sherbrooke, 60% à Longueuil et 59% à Trois-Rivières). Comme par hasard, c’est aussi là que ce concentrent les pauvres et, comme de raison, les locataires sont généralement beaucoup plus pauvres que les proprios (27 148$ /an en moyenne vs 42 298$ /an).
Quelle(s) intervention(s), dans quelle(s) perspective(s)
Si à première vue, les locataires ont peu de pouvoir face à la crise, l’existence même des associations de locataires prouve qu’il n’est pas forcé qu’il en soit ainsi. Dans la relation basique propriétaire/locataire, c’est le propriétaire qui a le gros bout du bâton. Ceci dit, comme dans la relation patron/salarié, il est possible, en s’organisant collectivement, de faire pencher le rapport de force dans le sens des intérêts des locataires. Ce battre comme locataires pour nos intérêts et vouloir améliorer concrètement notre situation ici et maintenant, c’est possible. Il n’appartient qu’à nous d’utiliser les droits qui sont reconnus et qui sont bafoués, de s’organiser pour les faire respecter. Arrivé à un certain stade d’organisation, il est même possible nous même, de façon autonome et par le biais d’un pur rapport de force, de réglementer le marché (ex. : les « rent strike » en Irlande). On n’en est pas là, bien sûr, mais il ne coûte rien de le rappeler.
Durant les années 1980, lors de la crise précédente, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, de concert avec le Bureau d’Animation et d’Information Logement (BAIL), organisait systématiquement des séances d’informations dans le quartier sur des sujets comme « comment refuser une augmentation de loyer » au moment des renouvellements de baux. Avec la crise actuelle, il y a fort à parier que les groupes communautaires n’auront pas le choix de revenir à ces pratiques. Les mécanismes de protections de la Régie du Logement ne sont pas toujours évident mais ils sont là. D’ailleurs, comme le soulignait récemment le BAIL, les demandes de révisions de loyers et les refus d’augmentation sont en hausse constante. Il faudra que nous soyons beaucoup plus nombreux à le faire pour renverser le rapport de force en notre faveur.
D’autre part, des groupes comme le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et le FRAPRU seront appelés à se radicaliser dans la prochaine année. En effet, la situation est grave car, en plus de la crise du logement qui nous pend au bout du nez, les gouvernements sont plus dur que jamais à faire bouger. Ainsi, le gouvernement fédéral, malgré des surplus importants, refuse d’investir dans la créations de nouveaux logements sociaux. Sa seule façon de parer à la crise est d’investir dans du logement abordable pour les ménages gagnant entre 20 et 40 000 dollars par années. Il s’agit beaucoup plus d’une subvention déguisée aux promoteurs que d’autres choses.
Du côté du provincial, l’actuel programme qui permet de construire des coopératives d’habitations, Accès Logis, en est à sa dernière année et rien ne dit qu’il sera maintenu ou qu’un autre programmes le remplacera. La notion de logement social subi une dérive en ce moment, en effet, les gouvernements veulent de plus en plus s’en servir pour régler des « problèmes spécifiques » alors que normalement, les logements devraient être accessibles à tous ceux qui en ont besoin. D’autre part, avec la réorganisation municipale, rien n’est coulé dans le béton (surtout si c’est Bouché qui rentre!).
Pour faire face, les groupes logements n’ont que peu de moyens. Pourtant, on sent déjà que le ton est prêt à monter. En plus du squat du Comité des sans emploi, qui a été soutenu par le FRAPRU et certains de ces groupes membres ce qui était impensable il y a quelques années, le FRAPRU s’est voté un ambitieux plan d’action lors de son dernier congrès. Ce plan inclus des occupations de terrain et de bâtisse au printemps. Gageons que nous n’avons pas fini d’en entendre parler.
L’action du Comité des sans emploi a donné des idées à plusieurs militantEs du Comité populaire. Et si ce printemps on s’ouvrait un squat dans Saint-Jean-Baptiste… en attendant nos 8 000 logements sociaux (bien sûr!).
Note :
1 – La proportion de propriétaires par rapport aux locataires pourraient porter à accréditer les thèses de « la disparition de la classe ouvrière », cependant, pour ce faire, il faut « oublier » que plus 110 000 ménages propriétaires consacrent plus de la moitiés de leurs revenus aux « dépenses de propriétés ».
Nicolas Phébus