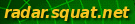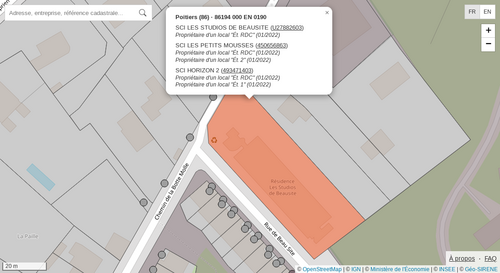Parmi les activités publiques qui démarrent au squat de la Loupiote, il y a les cours gratuits d’italien… Nous proposons qu’un fil conducteur de ces cours soit la traduction d’un bouquin encore inédit en français, le dizionario antipsichiatrico, qui date de 1997 et explique de manière très claire et accessible le B.A.-BA de l’antipsychiatrie, avec moult exemples et récits à l’appui. Les cours auront lieu tous les mercredis de 18h à 20h (ils commencent donc mercredi 3 décembre) et sont ouverts à tou-te-s (quel que soit le niveau d’italien) ; on discutera ensemble de la manière dont nous voulons avancer. La Loupiote c’est au 4 rue du Pont-Carpin (limite Grenoble – (st)Martin d’Hères, près av.G. Péri, tel. 04.76.01.85.24).
Voici quelques premiers extraits traduits du dizionario antipsichiatrico (de Giuseppe Bucalo):
» Je me souviens d’avoir demandé une fois à Louise : » De quoi as-tu besoin ? Qu’est-ce qui peut t’aider ? »
Louise me répondit : » Je voudrais être une chenille et ramper sur le sol. Je voudrais qu’il y ait quelqu’un, mais je ne voudrais pas qu’il m’arrête, me remette debout, m’empêche de le faire. Je voudrais que cette personne reste là et me regarde, sans intervenir. »
Je me souviens de lui avoir dit : » Peut-être qu’ainsi cette chenille pourra enfin devenir un papillon ? »
Louise me regarda, sourit et ne dit plus rien. Que fallait-il à Louise ? Un témoin ! Combien cette aide peut être loin de celle qu’elle avait eu de ses thérapeutes (et que des millions d’autres individus ont des spécialistes de la santé mentale). Même quand on te laisse ramper par terre, personne ne te regarde, personne n’est témoin. La seule attention que tu peux espérer avoir est qu’on te pousse hors de ses allées et venues quotidiennes. Ramper par terre : thérapeutique, quand ce sont elles/eux qui t’y plaquent pour t’immobiliser et t’endormir avec une piqûre ; pathologique, quand c’est toi qui le fais, pour te sentir chenille, pour disparaître, te prostrer ou prier. Je ne me suis jamais expérimenté chenille, mais il m’est arrivé d’être témoin de merveilleuses ou inquiétantes métamorphoses. Personne ne peut établir avec certitude si c’est de témoins qu’on a besoin à certains moments plutôt que d’une correction sonore ou d’une dose massive de tranquillisants. La seule chose qui est sûre, c’est que cette aide est plus difficile à donner, c’est celle qui nous implique d’une certaine manière dans la folie de l’autre et nous entraîne dans un territoire inconnu. Nous savons très bien utiliser nos mains pour frapper quelqu’un-e ou lui enfoncer une seringue dans le bras, mais très peu ou pas du tout participer à ce qui lui arrive. »
» L’expérience de Rosenham, conduite par des professionnel-le-s américain-e-s et citée plusieurs fois dans les textes de critique de la psychiatrie (cf.Antonucci 1986, Forti 1979), est une autre preuve de l’absurde prétention de la psychiatrie de savoir et pouvoir distinguer le sain du fou. Un groupe de professionnel-le-s se présenta dans une série de structures psychiatriques aux différentes orientations thérapeutiques en essayant de se faire interner. Tou-te-s affirmaient avoir entendu des voix qui de manière confuse prononçaient des choses comme » inutile » ou » vide « . Pendant l’entretien d’admission, les patient-e-s avaient répondu aux questions correctement par rapport à leur situation sociale, leurs expériences et leurs rapports. Tout de suite après leur internement illes avaient arrêté de se plaindre du symptôme pour lequel illes avaient été interné-e-s et illes avaient commencé à collaborer activement avec le personnel. Pour toute la durée de l’internement, aucun membre de l’équipe médicale n’a avancé de doutes sur leur maladie. Dans leur rapport, les acteurs et actrices de l’expérience citent le fait paradoxal que les seul-e-s à nourrir des doutes sur leur identité ont été d’autres interné-e-s, qui les ont accusé-e-s de ne pas être des patient-e-s, mais des personnes qui étaient là pour quelque recherche ou contrôle. Que les patient-e-s soient des observateurs et observatrices sensibles et attentifs/ves de la réalité ne doit pas nous surprendre, ce que nous devons plutôt nous demander, et que les acteurs/trices oublient de signaler dans leur rapport, c’est si ces interné-e- s qui les avaient reconnu-e-s et, probablement, dénoncé-e-s aux médecins du service, ont été soigné-e-s de ce délire. Et, dans le cas d’une réponse affirmative, qu’ont pensé ces thérapeutes quand il leur a été révélé que leurs patient-e-s avaient raison ? Comment ont-ils justifié cette erreur ? Et comment pouvait-elle être évitée ? Je crois n’avoir jamais entendu dans la bouche ou lu dans les écrits d’aucun- e psychiatre un seul mot d’auto-critique claire et sincère concernant les horreurs auxquelles il ou elle avait participé, parfois ignare et inconscient- e, d’autres fois conscient-e et sadique. Chaque lobotomie, castration, fièvre paludique, mitard, camisole de force, interdiction, électro-choc a été justifié comme le prix à payer sur l’autel de la recherche médicale pour combattre cette terrible maladie. Une maladie terrible au point que les gens n’ont jamais admis de l’avoir, une maladie qui n’a jamais été aussi terrible que les thérapies qui ont essayé de la soigner. En psychiatrie on ne se trouve pas face à des thérapies, mais à des expérimentations. Ce que font les psychiatres ne sert pas tant à soigner qu’à démontrer l’existence de la maladie mentale. »
» Aujourd’hui nous sommes peut-être sincèrement scandalisé-e-s par le fait que des innocent-e-s aient pu finir à l’asile. En réalité, qui a enfermé pour des décennies et considéré symptôme de maladie mentale l’adultère, la masturbation ou l’homosexualité, n’a rien fait de différent de qui aujourd’hui interne ou soigne Franck parce qu’il ne trouve plus son visage. A l’époque comme aujourd’hui les psychiatres sanctionnent, avec leurs soins, tous les comportements et opinions qui ne respectent pas l’Ordre mental, familial et social, constitué. »
» Bien sûr on peut toujours, pour l’expérience de Rosenham, soulever des doutes quant à la professionnalité des personnes qui ont signé les internements et élaboré les diagnostics. Beaucoup défièrent Rosenham, comme on peut le comprendre, de répéter l’expérience auprès de leur structure où certainement une erreur de ce genre ne pourrait pas être constatée. ( ) Rosenham répondit au défi de ses collègues en changeant l’énoncé de l’expérience. Des fausses patientes et des faux patients auraient tenté, dans les trois prochains mois, de se faire interner dans l’une de ces cliniques qui déclaraient user d’un diagnostic scientifique et sûr. Le défi, que leur relançait Rosenham, était d’essayer d’être capables de reconnaître les acteurs et actrices quand illes se seraient présenté-e-s. Durant la période de l’expérience un grand nombre d’internements furent refusés dans les différentes structures, et dans de nombreux cas, un ou plusieurs chef-fe-s signalaient des doutes quant à l’identité des patient-e-s. En réalité, aucun faux patient et aucune fausse patiente ne s’est présenté-e durant cette période auprès de ces structures. Cela ne veut pas dire qu’il existe de vrai-e-s patient-e-s, mais simplement que les psychiatres ne sont même pas capables de reconnaître avec certitude chez les gens les aspects qu’elleux-mêmes définissent comme symptômes de maladie. Les internements et les soins psychiatriques sont seulement en partie justifiés par les diagnostics, souvent les diagnostics mêmes sont justifiés par la tentative d’intervenir et de résoudre les conflits sociaux et relationnels dans lesquels nous sommes impliqués. Une injection de neuroleptiques n’est pas le soin d’une quelconque maladie, mais le moyen pour bloquer un individu qui est en train de mettre la maison sens dessus dessous à la recherche de son propre livret d’épargne, que nous lui avons thérapeutiquement soustrait et caché. Bien sûr il existe des situations dans lesquelles le conflit paraît impossible ou incompréhensible, comme dans le cas où Franco s’échauffe contre son père parce qu’il ne supporte pas sa manière de se tenir à table, ou dans le cas où Francesca accuse ses parents de vouloir l’empoisonner. Il y a le conflit entre Nino qui ne dort pas la nuit et traîne dans les rues du village en criant et ses voisin-e-s qui doivent retourner travailler le matin. Ce sont des conflits difficiles, bien sûr, mais pas des maladies. Les appeler ainsi sert seulement à les nier, à ne pas les affronter et les affiner. »
» Chaque fois que je tentais de dialoguer avec les infirmier-e-s et les chef- fe-s du service pour tenter de leur faire entrevoir les raisons de Giovanni, elles et eux me regardaient comme qui est en train de perdre du temps après des fantaisies et des philosophies utopiques. Cela semblait paradoxal, mais ces hommes et ces femmes ne l’avaient jamais écouté : juste gardé à vue. Illes étaient capables de me lister toutes les infractions à l’ordre de vie du service, même loin dans le passé, mais illes ne semblaient pas avoir jamais suivi un seul de ses discours ou écouté une seule de ses plaintes ou requêtes. Illes regardaient ses paroles et ses pensées comme illes gardaient un il sur ses actions. Illes regardaient seulement si ces paroles et ces pensées pouvaient être insérées dans le groupe de symptômes de la catégorie de l’amélioration ou de l’aggravation. Ce qu’il disait, à qui et pourquoi, semblait ne pas les intéresser. »
« C’est ce que Giovanni a fait (ou que les autres craignaient qu’il puisse faire) qui a convaincu ses parents d’appeler la police psychiatrique et de le faire interner. Mais c’est ce qu’il dit qui détermine le fait qu’il soit remis en liberté. S’il accepte de se sentir et d’être malade et d’avoir, en conséquence, besoin de ces soins, on le jugera amélioré et il pourra espérer une liberté surveillée. S’il insiste à considérer arbitraire son incarcération et à revendiquer son droit à la libre communication et au mouvement, ses conditions seront déclarées graves et il sera soumis à un durcissement des mesures restrictives. Le docteur Lorenzo Mandalari, psychiatre et premier directeur de l’asile de Messine, déjà au début du XXème siècle, vantait une moyenne de guérison de 40%. Les thérapies expérimentées ces années-là allaient de l’application de sangsues à l’inoculation de la malaria, de l’isolement à la camisole de force, de la castration à l’ablation des ovaires, et à d’autres tortures du genre. 40% de ses victimes guérissaient et ne revenaient plus pour un autre cycle de thérapies. Je crois que des pourcentages de ce genre sont semblables à ceux des personnes qui, parmi les victimes de la torture, dans différentes époques de l’Histoire et sous toutes les formes de régime totalitaire, se sont trahies elles-mêmes, ont renié leurs idées et accepté les idées de leurs bourreaux. Face au pouvoir de la psychiatrie nous ne pouvons faire beaucoup, même si ce qu’il y a à faire n’est pas peu. L’infirmier qui fait disparaître du service les instruments d’immobilisation fait certainement quelque chose de concret pour limiter la violence psychiatrique. Ainsi faisait Fiorenzo quand il s’élançait pour frapper les médecins et les infirmier-e-s dans la tentative disproportionnée de défendre les interné-e-s traîné-e-s de force et de manière violente dans le service. Qui le condamne devra essayer de m’expliquer ce qu’il ou elle ferait à sa place. Beaucoup d’entre nous croient avoir affaire à des personnes sensées quand ils ou elles pensent aux responsables des services psychiatriques. Des personnes avec lesquelles Fiorenzo pourrait parler et expliquer ses raisons. On l’a pensé aussi du docteur Mandalari, du docteur Ugo Cerletti expérimentateur de l’électro-choc, du docteur Moniz, prix Nobel de médecine, et du docteur Coda, psychiatre turinois qui dialoguait avec ses patient-e-s en leur appliquant des électrodes sur les testicules. En réalité, pour autant que cela puisse nous sembler paradoxal, c’est justement la volonté d’exposer sont propre point de vue qui détermine l’intervention psychiatrique. Les patient-e-s ne peuvent pas avoir des opinions ou exprimer des jugements sur elles/eux-mêmes ou sur le personnel : ils et elles doivent seulement partager les opinions et les jugements de leurs thérapeutes. Quand les opinions des un-e-s et des autres sont en conflit, la question est résolue par la sédation et la limitation de la capacité de pensée et de mouvement de la patiente ou du patient. Nous ne devons pas étonner du tout de la fréquence avec laquelle les psychiatres rencontrent chez leurs patient-e-s ce grave symptôme de maladie mentale que nous appelons « comportement autiste ». Une attitude de ce genre est prescrit, et est considéré comme leur devoir, aux prisonniers de guerre qui tombent en mains ennemies. Est-il si insensé de penser qu’une personne puisse choisir de ne pas parler avec qui la retient dans un lieu où elle ne veut pas être ? La faculté de ne pas répondre est un droit sanctionné par la loi. Est-il irrationnel de choisir de ne pas répondre parce que l’on est sûr- e que ce que l’on dit sera utilisé contre soi ? En définissant le comportement de Giovanni comme autiste, les psychiatres veulent dire en réalité qu’illes ne sont ni ses maton-ne-s ni ses accusateurs/trices, mais des médecins qui agissent en son intérêt. Il est pourtant difficile, si ce n’est pas impossible, de penser à une privation de liberté plus radicale que l’internement psychiatrique ou à des cruautés plus atroces que celles que les psychiatres, en plus d’un siècle d’histoire, ont infligé à leurs patient-e-s. »
« Matthew ne sait pas pourquoi le docteur lui a prescrit un traitement médicamenteux. Quand il en demande la raison à une infirmière elle lui répond qu’il est malade et que le médicament lui fera du bien. Matthew dit au personnel que ça ne doit pas être le bon médicament pour lui, vu qu’il se sentait bien avant de le prendre et que maintenant il se sent mal. Le médecin lui répond que le fait qu’il se sentait bien avant de prendre le médicament ne prouve pas qu’il n’était pas malade, parce que les patient-e-s en psychiatrie, souvent, ne se rendent pas compte d’être malades. Les infirmières, dans une réunion du service, lui disent qu’il devrait avoir confiance en son médecin, sachant que celui-ci est un expert dans ce domaine alors que lui ne l’est pas, et que la méfiance est un symptôme de maladie mentale. Il se sent confus. Il n’a pas confiance en celles et ceux qui lui disent qu’il était malade quand il se sentait bien et que le médicament qu’on lui donne peut l’aider à se sentir mieux alors même qu’il lui fait du mal. Il a encore moins confiance en elleux quand illes lui disent qu’il est malade s’il n’a pas confiance en elleux. Comment convaincre le médecin de changer le traitement et cacher son manque de confiance dans le traitement ? Il dit qu’illes sont en train de l’empoisonner. De cette manière il cache sa méfiance, et en même temps la révèle. Comme il ne sait pas que le docteur a fait un diagnostic de schizophrénie paranoïaque et a prescrit le médicament pour traiter cette maladie, il ne se rend pas compte qu’en disant être empoisonné il provoque ce dont il a peur, c’est-à-dire une augmentation de la dose du médicament. » (M. Shatzman)