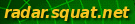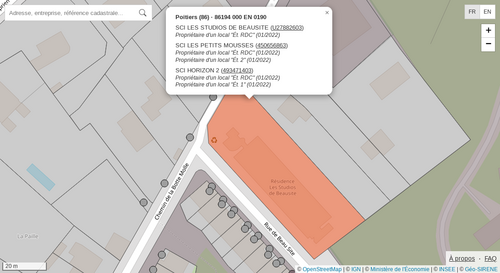L’envie d’écrire au Transfo, avec un grand T, me taraude depuis un moment. En rentrant d’un de ses monstrueux concerts, à une heure avancée de la nuit et chevauchant mon vélo sur le chemin du retour, j’orchestrais des bribes de phrases et de tournures qui annonçaient les premières lignes d’un article, d’une lettre, ou d’un éloge à ce lieu. Portée par l’exaltation du moment, la liesse de la fête, le cerveau embrumé, je vivais un de ces rares moments de plénitude, propice aux envolées lyriques.
J’arrive à Nation, mon cerveau tourne en rond. Point
Sur ce trajet, je me souviens avoir pensé à plusieurs reprises que je pouvais crever à cet instant, sans n’avoir rien à regretter. Parce que ce que je vivais là – au Transfo – c’était une expérience de construction collective inouïe qui me rattachait au monde, aux autres. Qui me suffisait pleinement. Qui seule valait la peine d’être vécue.
En rentrant chez moi ce soir là, j’ai gribouillé trois phrases sur un carnet et je me suis couchée, reportant au lendemain l’entreprise. En attendant, donc, je n’ai rien écrit du tout. Parce que j’en ai toujours terriblement peur. Parce que, finalement, le sens de mes pensées semble toujours s’évanouir à mesure que je les couche sur le papier. Trop de complexes resurgissent, hérités d’une éducation autoritaire, d’un éternel culte de la performance – peut-être. Quel sens ? Quelles formules ? Qu’en dira-t-on ?
Et puis merde. Combien de barrières faudra-t-il encore faire tomber ?
La lente agonie du Transfo me pousse à m’installer derrière mon ordinateur et à clapoter sur un clavier, sans prétention aucune, pour partager une expérience tout simplement. Peut-être aussi pour participer, modestement, à l’écriture d’une mémoire collective, non pas des vaincus, mais de ces lieux, qui vont, qui viennent, et qui pourtant façonnent la résistance active à un monde qui nous emmerde profondément. Que reste-il de ces lieux qui s’éteignent aussi vite qu’ils n’apparaissent ? Soupçon de sédition dans l’espace et dans le temps du capitalisme roi.
Le Transfo a bien trop changé ma façon d’appréhender le monde pour que je ne me réveille de ces deux dernières années, sans une gueule de bois, amère et pesante, que j’ai envie de soigner avant de partir sur d’autres chemins.
Je le concède volontiers, le Transfo a fait ou refait toute mon éducation politique. Pour des raisons qui m’appartiennent, il m’a fallu attendre 26 longues années pour rencontrer en chemin une pensée libertaire et autonome. Ce qui fut d’abord un intérêt et une curiosité infinie envers la différence, devint, très vite, la mise en route d’un mécanisme complexe de remise en question en chaîne ; un exercice mental de déconstruction, un à un, des piliers de notre système. J’ai finalement pu mettre des mots et le doigt sur une colère viscérale et intrinsèque, que je portais en moi mais dont je n’avais qu’une partielle perception des causes. Je me libère alors peu à peu du poids immense de l’éducation, de la culture et des codes, immanents et transcendantaux, pour prendre le temps de revenir librement aux origines de l’équation.
Ce qu’il y a de plus probant dans la rencontre du milieu libertaire, c’est son empirisme. Avant de la trouver « juste », je l’ai trouvée « belle ». Avant d’être un exercice intellectuel, ça a été une expérience de vie, rendue possible – pour beaucoup – par la rencontre d’univers et d’existences qui n’auraient sûrement jamais eu, ailleurs qu’ici, l’occasion de se croiser, de se parler, de se comprendre.
Si nous ne savions pas exactement où nous allions, ni ce que nous cherchions ; nous étions sûres de ce que nous faisions, comment nous le faisions et avec qui.
Le Transfo m’a donc permis de prendre possession de la chose publique et politique, ce que je n’avais jamais fait jusque là. Je pensais en être écartée car aucun parti, ni aucune idéologie, n’avaient trouvé quelconque écho en moi. J’étais, en effet, un de ces cas de dépolitisation absolue et assumée. Se contentant de panser des plaies béantes d’un monde qui va mal, notre système réduit la politique a de petites affaires de gestionnaires, de petits comptes d’apothicaires, réservés aux spécialistes. Elles nous interdisent de parler avec nos convictions ou nos tripes, pour mieux nous enfermer dans un système. Elles nous dépossèdent des vraies questions en les rendant inaccessibles au commun des mortels.
Déconstruire tout en édifiant, voilà la magie qui s’opère dans des lieux comme celui du Transfo. Ce que j’ai découvert là-bas m’a construit et a posé un jalon immuable et irréversible dans le cheminement de ma pensée.
J’aurais peut-être voulu qu’on se batte pour tout ça.
On l’a d’ailleurs scandé et annoncé en une : « ils veulent nous expulser, on ne se laissera pas faire ». C’est pourtant bien ce qu’il se passe.
Parce que nous sommes fatigués. Parce nous ne sommes jamais assez nombreux. Parce que beaucoup de notre énergie a déjà été dépensée dans la résistance à un système qui nous empêche d’exister. Parce qu’on a toujours essayé de faire autrement et que ça s’apprend, et que ça demande du temps, beaucoup de temps. Alors maintenant que justice a rendu son jugement – et quelle justice ! – plutôt que de défendre bec et ongle un lieu qui sera amené à être englouti un jour ou l’autre, on se sépare et on se mobilise ailleurs, dans d’autres lieux naissants.
C’est donc la fin et on abandonne le navire. Non sans émotion. Pour ma part.
Un soir, autour d’un de ces feux éternels, à Notre-Dame-des-Landes, un zadiste me promettait : « on sera tous là, à Bagnolet, pour le Transfo, le jour où… ». Ce jour ne viendra pas. Non que j’ai un penchant naturel pour le baroud ou le barouf, j’aurais aimé vivre ce moment. Je crois. Ne serait-ce que pour palper ces liens immatériels mais terriblement tangibles et hautement symboliques qui se sont construits entre ces différents lieux de résistances. Terrible envie d’entendre battre nos cœurs à l’unisson, de contempler cette constellation de luttes qui brille comme l’espoir d’un futur meilleur.
Ceci n’est pas pour autant une épitaphe ni moins un blâme. Au contraire. Je n’avais simplement pas envie que tout s’arrête comme ça. Sans bruit, sans expression. Sans qu’on se rappelle que c’était bien, qu’on s’est saoulé et qu’on a ri. Et je n’ai aujourd’hui plus d’autres occasions ni d’autres espaces que cette lettre ouverte pour le dire.
Un peu pour tout ça, et comme la moindre des choses, je remercie celles et ceux qui ont donné vie au squat et l’ont fait vivre – nuits et jours – les habitants, habitantes, les copains et copines, aux collectifs, nombreux, qui ont façonné le paysage politique de ce lieu, les gens qui étaient là tout simplement et qui ont fini par incarner et donner une âme à ce Transfo, au grand T, comme il me plait de l’appeler.
Parce qu’au bout du compte je me sentais un peu seule avec ma gueule de bois. Si les réseaux construits au Transfo survivront largement au démantèlement du lieu – j’en suis sûre – l’espace nous rattachait néanmoins les uns les autres. Car les amitiés qui se créent, les liens qui se tissent, dans ces lieux-ci, ont ça de particulier qu’ils ne s’intéressent finalement qu’assez peu à l’individu en tant que tel. Ce qui importe n’est pas tant ce que nous sommes mais ce que nous pensons, faisons et la manière dont nous agissons collectivement. Parce que les raisons qui nous poussaient à être ensemble étaient essentiellement ces luttes, ces pratiques, ou ces combats contre un ennemi commun mais immatériel et que, finalement, on se connaissait peu. La richesse des relations était ailleurs et il en est né une forme d’amitié collective, un amour pluriel et informel, auquel j’avais envie de m’adresser.
D’aucuns critiqueront la naïveté de l’écriture ; d’autres lui reprocheront d’avoir omis une certaine réalité vécue au Transfo. Effectivement, j’aurais pu insister sur les complexités multiples de l’auto-gestion et de l’expérimentation ou sur tous les doutes et questionnements, individuels et collectifs que nous avons eus et que nous avons toujours pour certains. Mais je n’en avais aucune envie. Tout simplement.
Je ne sais toujours pas où je vais mais je vais mieux après ça.
Longue vie à tous les Transfos naissants, et à tous les Transfos qui continuent d’exister, ici et ailleurs !
Témoignage d’une amie
P.-S. de Paris-luttes.info : pour info, aujourd’hui, le Transfo est expulsable mais pas encore expulsé. De moins en moins de collectifs s’y réunissent mais des habitants occupent encore les lieux. Il y a de grande chance pour que le lieu tienne encore l’hiver… Tout n’est pas encore fini !
[Publié le 8 octobre 2014 sur Paris-Luttes.Info.]