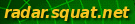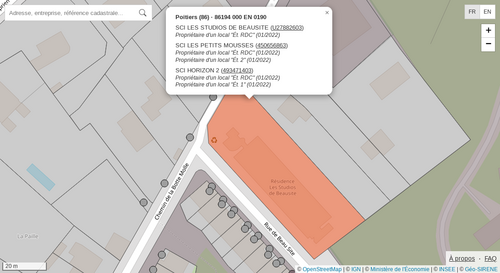L’hiver est rude à l’Est. Deux mois que les trottoirs de Berlin sont recouverts de neige. À la limite des quartiers de Mitte et de Kreuzberg, celui du numéro 137 de la rue Köpenicker n’échappe pas à la glace. Un matelas abandonné, un collecteur artisanal de fripes, des banderoles grignotées par l’humidité : c’est l’entrée du mythique Køpi, l’un des squats les plus connus d’Europe encore en activité, après l’évacuation de l’Ungdomshuset de Copenhague en mars 2007.
Il est bientôt 20 heures. Quelques fenêtres éclairent la façade de briques couverte de graffs et de tags. Passée la lourde grille, il faut encore franchir les portes de fer qui mènent aux étages, pour atteindre l’AG qui a lieu ici chaque dimanche soir. «Plenum!», crie une fille de la cour, après avoir sifflé un coup long. Une fenêtre s’ouvre, un ballot tombe : des clés empaquetées dans un chiffon. Le plénum se déroule d’habitude au Kino, la salle de cinéma en sous-sol. Mais il y fait trop froid en ce moment. Autour d’une pile de crêpes et d’une casserole de thé, une dizaine de personnes attendent dans l’une des cuisines collectives, au deuxième étage du squat.
Avant de régler les questions courantes, c’est le moment pour les invités de soumettre leur requête : demandes d’hébergement temporaire ou d’utilisation des salles collectives dévolues aux «activités». Car en parallèle du projet d’habitation, qui concerne aujourd’hui une quarantaine de personnes, le Køpi est aussi un véritable centre socioculturel autonome, qui draine une partie conséquente de la faune alternative locale et internationale.
Sur cinq étages et près de 1900 m2, on y trouve entre autres l’une des plus anciennes salles d’escalade de la ville, un atelier d’impression d’art et de documents, plusieurs salles de concert (le Koma F pour le rock, le Keller pour la techno), un studio de musique, un bar qui sert de réfectoire les mercredis soirs de «Vüku» (de Volxküche, la «cuisine populaire»), la cantine végétarienne ouverte à tous sur don, que proposent la plupart des squats berlinois. Chacune de ces activités est gérée par un comité indépendant. Et pour l’anniversaire des vingt ans du Køpi, tous ont eu de quoi de faire.
Du mercredi 24 au dimanche 28 février, une quarantaine de groupes et de DJ’s se sont produits essentiellement des artistes de la scène punk, mais aussi un peu de hip-hop et d’électro, et une nuit techno le samedi soir. Le tout conclu par un brunch végétarien le dimanche. Les «guests rooms» de la partie habitée affichaient complet depuis des semaines. En février 2009, la soirée des «19 ans» avait déjà attiré entre 2000 et 3000 personnes, venues des quatre coins du monde. Cette année encore, il y a eu du bruit, des odeurs et des couleurs pour fêter vingt ans à la marge, vingt ans de lutte pour préserver la créativité, la singularité et l’autonomie de ce lieu.
Le 23 février 1990, une poignée de squatters investissent ce qui fut au début du [?]e siècle «l’établissement Fürstenhof», un complexe hôtelier dont le raffinement et la modernité attiraient la bourgeoisie germanique en villégiature à Berlin, alors capitale de l’Empire allemand. Au sous-sol et au rez-de chaussée, les pensionnaires disposaient d’un bowling et d’une salle de sport, d’un petit théâtre et de salons dont les hauts plafonds moulés veillèrent dîners pompeux et saisons des bals. À l’étage, des chambres et des suites propices aux secrets d’alcôve.
À la fin des années 1980, il ne reste plus grand-chose du faste d’antan. Devenu propriété de la République démocratique allemande après la Deuxième Guerre mondiale, administré par la WBM, la direction municipale du logement de Berlin-Mitte, le bâtiment, dont une partie a été convertie en immeuble d’habitation, doit être détruit. L’arrivée des squatters quelques mois après la chute du Mur change la donne : à la pagaille administrative qu’engendrent les velléités de réunification, s’ajoute l’impuissance de la police à contrôler les cohortes de migrants qui se forment de part et d’autre de l’ancien Rideau de fer.
Quand des milliers de Berlinois de l’Est veulent à tout prix franchir l’ancien «mur de protection antifasciste» pour rallier l’Ouest, d’autres Allemands, venus de tout l’ouest du pays, se ruent sur les espaces libres abandonnés qu’ils découvrent à l’Est, au-delà du «mur de la honte». Ce sont les débuts du mouvement alternatif berlinois, dont les squats et autres «house projects» deviendront bientôt le symbole d’un autonomisme européen soumis à la coercition quotidienne des autorités. Au Køpi, à l’été 1991, la WBM finit par signer des précontrats individuels pour les occupants de la partie habitable, qui s’engagent de leur côté à entretenir les lieux. L’ancien jardin du Fürstenhof est progressivement envahi par des camions, qui forment aujourd’hui un village compact de roulottes autour du squat.
Le 1er mai 1993, la gestion du Køpi est transférée à un nouvel administrateur étatique, la GSE (Société de développement urbain), qui conclut des baux à vie avec les squatters. Un an plus tard, les lieux sont rachetés par Volquard Petersen, avec qui s’engage une féroce bataille judiciaire. Au mépris des contrats précédemment signés avec les habitants, le propriétaire privé veut récupérer les lieux pour y établir des bureaux et un parking souterrain. Il est plusieurs fois débouté par la justice. Et finit par faire faillite. Le bâtiment est saisi par sa banque, la Commerzbank, qui s’escrime à vouloir vendre le Køpi aux enchères durant la fin des années 1990.
Mais rien n’y fait, les ventes n’aboutissent pas, aucun acquéreur ne semble prêt à tolérer les habitants du squat. S’ils sont aidés d’un bon avocat, Moritz Heusinger, ancien squatter et porte-étendard des revendications alternatives, il leur faut aussi gérer l’entretien des locaux (de la réfection du toit à la maintenance du circuit d’eau potable et d’évacuation) ; ils se constituent en collectivité locative. Mais l’étau ne se desserre pas autour de la communauté. L’opinion publique est encore marquée par les événements qui ont accompagné l’évacuation de la rue Mainzer, dans le quartier de Friedrischain à Berlin, en novembre 1990, et par l’activisme de groupuscules telle la bande à Baader (les RAF, pour Rote Armee Fraktion, la Fraction armée rouge), qui prôna la guérilla urbaine durant les «années de plomb» (fin des années 1960-fin des années 1980).
La presse généraliste allemande soutient la campagne de dénigrement initiée par la banque, qui semble oublier que la validité des baux individuels a chaque fois été réaffirmée par la justice. Toutes les excuses sont bonnes pour décourager les habitants du Køpi, qui bénéficient de la solidarité des autres squats, lors d’événements festifs ou de manifestations. Encore récemment, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2007, une perquisition a lieu au Køpi. Près de 80 policiers anti-émeutes ont été mobilisés. Motif : la présence d’une boîte de nuit illégale. Un concert était donné dans une des salles, et des bières servies au bar. Comme chaque semaine depuis plus de quinze ans…
Le 8 mai 2007, une énième vente aux enchères, tenue secrète pour éviter une nouvelle mobilisation des squatters, aboutit : pour 835’000 euros, Besnik Fichtner devient propriétaire des lieux, à l’origine mis à prix à 1,8 million d’euros. Le personnage est connu pour ses affaires douteuses. Il clame au journal Berliner Zeitung qu’il veut construire un complexe de luxe, avec pont d’amarrage pour yachts privés… Ce qui fait aujourd’hui encore rire les occupants du Køpi, le bâtiment n’étant pas exactement au bord de l’eau. Fin du feuilleton judiciaire en mars 2008 : un bail de 30 ans est enfin signé entre Besnik Fichtner et les habitants.
Depuis deux ans, la communauté a retrouvé un semblant de calme: «La crise a été notre chance, souligne Tobe*, la trentaine. En ce moment, vu le contexte, les autorités ne tentent rien contre nous. Ils ont d’autres chats à fouetter.» Car si les démêlés judiciaires autour du Køpi ont été initiés en 1994 par un propriétaire privé, la municipalité de Berlin n’en a pas moins été complice au fil des rebondissements de l’affaire. En jeu : la pression immobilière croissante sur des zones considérées, au lendemain de la chute du Mur, comme des no man’s land sans valeur. Aujourd’hui, nombreux sont les spéculateurs à lorgner sur ces anciennes friches.
En refusant de céder la place, les squatters revendiquent non seulement la possibilité d’occuper un espace à prix réduit (le loyer individuel au Køpi ne dépasse pas plusieurs dizaines d’euros par mois), mais surtout de mener un mode de vie qui s’exempte des échanges marchands, en promouvant la libre pensée et l’entraide. Si les motivations de chacun divergent au moment de rejoindre la communauté, tous s’accordent sur le rejet de la «gentrification», l’embourgeoisement d’arrondissements autrefois populaires et ouverts à la diversité sociale.
Dans le quartier de Friedrischain, où la résistance à cette tendance ne désarme pas depuis une dizaine d’années, le squat du 14 de la rue Liebig est le dernier avatar de cette lutte éreintante contre la pensée monolithique. Les occupants du Liebig 14 ont récemment organisé une «soliparty» de plusieurs jours, afin de récolter des fonds et de sensibiliser les habitants du coin au sort que veulent leur réserver les autorités. «Leur but n’est pas savoir si nous avons un bail valide ou pas, mais de maintenir une pression et une surveillance constante sur nous», explique Hannes*, qui vit au Køpi depuis sept ans. Vidéosurveillance installée dans le bâtiment d’en face de la rue Köpenicker, policiers en civil lors des fêtes : la méfiance est de mise, quand il arrive que certains habitants n’aient pas de papiers valables ou un casier judiciaire complètement vierge.
L’autre problème à gérer, c’est celui du tourisme. Certains squats, sur le modèle du Tacheles, qui se trouve dans le centre de Berlin, critiqué par beaucoup pour son parti pris commercial, sont désormais recensés par des guides de voyage ou une carte fournie par la mairie, qui vante ainsi son «Berlin alternatif». «Parfois, le matin, tu es en train de te brosser les dents, tu regardes par la fenêtre et tu te prends un flash dans la face, s’exclame Britta*. Les bus s’arrêtent devant la grille, certains touristes rentrent dans la cour, prennent trois photos et repartent comme des voleurs, sans même essayer de nous parler.»
Le Køpi a en effet à pâtir de sa célébrité quand ce ne sont pas des armadas de badauds en quête de pittoresque, il arrive des visiteurs qui ne comprennent pas toujours pourquoi l’hébergement leur est refusé. Pour intégrer la maison, il faut s’impliquer dans son fonctionnement ; le Køpi n’a pas vocation à servir d’hôtel pour les errants de passage. C’est avant tout un projet d’habitat collectif. Où quelques milliers de fêtards se sont entassés la semaine dernière, pour célébrer quatre jours durant cette terre d’utopie. Pour l’occasion, le Kino, le cinéma des lieux, avait programmé une nuit spéciale avec trois versions différentes d' »Alice au pays des merveilles ». Il est encore permis de rêver.
Maïté Darnault
[Les prénoms* ont vraisemblablement été modifiés.]
Le Monde libertaire n°1586, 11 mars 2010.