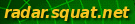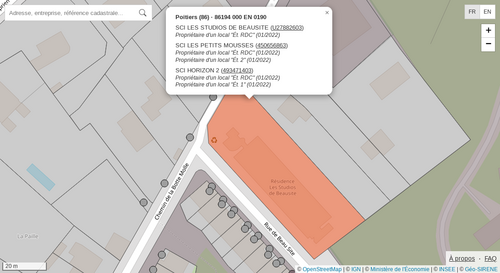Texte rédigé le 30 mars 2018, publié sous forme de brochure (28 pages A5) disponible en PDF cahier et page-par-page.
Les réflexions développées ici sont basées sur plusieurs mois de compagnonnage à la ZAD de Notre Dame des Landes. Elles se sont aussi élaborées collectivement, ce qui a abouti à l’organisation du festival « off » lors de la « Fête de la victoire », le 10 février 2018. La situation est si complexe et elle évolue si rapidement que tenter de faire entrer une analyse dans le cadre de quelques pages est une gageure. Ceci n’est donc qu’un point de vue partiel et partial.
Cette lutte a marqué les représentations de nombre de militant·e·s depuis une dizaine d’années, d’autant que beaucoup de clichés sur l’organisation ont été créés, de l’intérieur de la ZAD, pour en faire une lutte modèle. C’est d’ailleurs appâté·e·s par ces clichés que nous sommes venu·e·s sur la ZAD y voir de plus près.
Nous essayerons de proposer quelques clés pour comprendre ce qui se passe à NDDL, mais aussi dans d’autres luttes du moment.
Contexte : une lutte – historique
Après l’annonce le 17 janvier 2018 de l’abandon du projet de l’aéroport de NDDL, par le premier ministre, Edouard Philippe, beaucoup ont fêté la victoire après cinquante ans de luttes plus ou moins intenses. Vue de loin, cette lutte est perçue comme exemplaire, par sa durée d’abord, et son issue « victorieuse » ensuite. Nous ne parlerons pas des raisons de cette issue, ni sur le sens que certain·e·s donnent à cette victoire, plusieurs textes y reviennent[1]. Comme le dit un occupant : « La zad est utilisée en porte-voix pour des pratiques et des stratégies qui serviront d’exemple pendant des décennies » [2].
Les forces en présence
Rappelons brièvement les principales forces en présence. D’une part, les composantes citoyennistes : la Coordination des opposants (qui regroupe une soixantaine de partis, de syndicats et d’associations dont la plus présente sur le terrain est l’ACIPA)[3], COPAIN, qui regroupe essentiellement des paysans, dont les plus influents sont adhérents à la Confédération Paysanne, qui ne vivent pas sur la ZAD[4], les paysans « historiques » regroupés dans l’ADECA , installés sur la ZAD et qui n’ont pas vendu leurs terres à VINCI, les naturalistes en lutte. Ces groupes, bien que non homogènes, ont comme ligne d’action de s’adresser à l’État dans un cadre légal et plutôt juridique. Ces composantes étaient en lutte contre l’aéroport.
Dès 2009[5] à l’appel de certain·e·s habitant·e·s, des jeunes sont venu·e·s de tous les horizons : squats, libertaires, autonomes, écologistes, ou sans bagage politique. Vu·e·s d’un œil suspicieux au début, ils et elles furent finalement accepté·e·s par les autres composantes grâce à leur détermination face aux violences des gendarmes mobiles lors de la tentative d’expulsion (opération César en 2012). Ces occupant·e·s ont rajouté au slogan de l’ACIPA « contre l’aéroport » : et son monde.
Se sont aussi créés environ 200 comités de soutien où se jouent souvent les mêmes divergences que sur la ZAD et dans les autres composantes. Au sein des occupant·e·s se sont formées peu à peu des mouvances très marquées. Pour simplifier, on peut parler de deux modes d’organisation sous-tendus par deux visions des luttes : les anti-autoritaires et féministes d’un côté, et les autonomes et « appellistes » [6], regroupés depuis environ deux ans au sein du CMDO (Comité pour le maintien des occupations) de l’autre. Entre ces deux pôles, se sont constitués des groupes plus ou moins durables tentant des voies différentes. D’autres occupant·e·s, ne se retrouvant pas dans ces formes d’organisation assez structurées, se sont toujours tenu·e·s à l’écart des réunions et actions officielles. Il n’empêche que ces derniers, appelés à NDDL « les gens de l’Est » parce qu’ils ont construit leurs habitations plutôt à l’Est de la ZAD, ne restent pas inactifs ou inorganisés. Entre autres, ils ont imposé aux agriculteurs une zone non motorisée. Pour continuer dans la description à grands traits, on peut dire que les occupant·e·s des groupes organisés sont majoritairement issu·e·s de la petite bourgeoisie intellectuelle en voie de déclassement, et que les gens dit « de l’Est » sont plutôt issus des classes populaires paupérisées[7].
Les mythes à l’épreuve des faits : unité, horizontalité, consensus
Si vous avez réussi à vous repérer dans ce paysage social, vous avez compris que le mythe propagé, en particulier par les textes officiels de la ZAD (« en vrai si on a gagné, c’est parce qu’il y avait tellement de modes d’actions différents avec tellement de gens différents, que les keufs ont jamais su comment réagir, et c’était trop stylé ») ou les livres écrits par le collectif Mauvaise Troupe[8], ce mythe de « l’unité dans la diversité » est une tromperie qui profite aux dominants. Pour les citoyennistes, il était impensable de remettre en question l’État ou le système capitaliste. Il s’agissait juste de défendre le domaine agricole et foncier contre le projet d’aéroport. Pour les occupant·e·s, l’aéroport était certes important, mais il était inconcevable de lutter contre ce Projet Inutile sans remettre en cause l’État et le système capitaliste qui en sont à l’origine. Les premiers ont dû néanmoins s’arranger avec les seconds tant que le maintien du projet d’aéroport, avec la menace d’une expulsion militarisée violente, était brandie par les différents gouvernements Hollande.
Ce mythe de l’unité dans la diversité a fait et continue à faire des dégâts. A l’intérieur du Mouvement « anti-aéroport », il a muselé les occupant·e·s, organisé·e·s ou non, mais critiques sur le mécanisme de confiscation de la lutte. Ils et elles ne voulaient pas risquer de briser l’unité qui « fait la force du Mouvement ». A l’extérieur, ce mythe de l’unité dans la diversité a créé des imaginaires de lutte idyllique. Idéalisation et culpabilisation sont encore aujourd’hui le lot de bien des soutiens à cette lutte qui pensent n’être pas capables de faire pareil.
Le 1er août 2017, en AG du Mouvement, la Coordination testa, par une mise en scène théâtrale, la force de ce mythe. Elle prit prétexte de trois actes d’hostilité lors de rassemblements[9] qu’elle avait organisés et dont elle tint l’ensemble des occupant·e·s pour responsables. Elle demanda aux occupant·e·s de condamner les auteur·e·s de ces « incivilités ». Devant le refus de l’assemblée, les membres de la Coordination quittèrent l’AG, courroucé·e·s. Quelques membres du CMDO leur emboîtèrent le pas. Ils laissèrent seul·e·s les occupant·e·s, semblant briser ainsi la sacro-sainte unité du Mouvement, pour mieux recomposer une unité de façade qui exclura, sans jamais l’assumer publiquement, les occupant·e·s les moins intégrables.
Autre mythe à qui la réalité s’est chargée de tordre le cou, c’est celui du fonctionnement « horizontal » des réunions. Vous connaissez le fonctionnement plutôt vertical classique des associations ou collectifs, avec un conseil d’administration ou du moins avec des prises de décision au vote majoritaire. Les occupant·e·s, pour leur part, ont cherché à mettre en œuvre un fonctionnement horizontal dans les réunions.
Cette organisation aurait dû faciliter la prise de parole. Mais l’horizontalité est aussi un leurre, chacun-e ne l’abordant pas avec les mêmes caractéristiques.
La prise de parole ne dépend pas seulement d’un donneur de parole, mais surtout de la capacité de chaque participant-e à s’exprimer avec les codes en vigueur dans l’AG, du fait de se sentir légitime pour intervenir, y compris contre la majorité du groupe, de la capacité à passer outre les ricanements, les humiliations voire les intimidations. Ces compétences, qui dépendent essentiellement de la possession, ou non, d’un certain capital culturel, ne sont pas également réparties entre les participant·e·s à une AG[10]. Quelles que soient les techniques de conduite d’un groupe, ce seront toujours les mêmes qui seront plus à l’aise, excluant, même sans le vouloir, celles et ceux qui en réaction ne prendront plus la parole, puis ne viendront plus à ces réunions. Ce seront toujours les mêmes qui auront la possibilité de porter leurs intérêts en avant.
Et comme on ne prête qu’aux riches, ce capital culturel va de pair avec un capital social plus ou moins conséquent, qui permet de faire fonctionner ses réseaux à l’extérieur, réseaux politiques, de soutien[11]. C’est ainsi que certains lieux de vie sur la ZAD se sont trouvés à la tête de moyens matériels mis à leur disposition pour mener à bien leurs projets : machines agricoles ou matériel de construction, par exemple, qui ne furent pas souvent mis à la disposition de toutes et tous. Peut-on parler d’horizontalité si on ne veille pas, au sein du Mouvement, à la redistribution égale des moyens matériels et financiers venus de l’extérieur ? [12]
Autre ressource inégalement répartie au sein des occupant·e·s, c’est le temps disponible pour lire, écrire, se documenter, rechercher les informations et les diffuser, organiser les réunions, etc. Et ce temps est d’autant plus disponible qu’on habite une maison en dur ou un habitat auto-construit confortable, sans le souci d’aller à la recherche d’eau ou d’une machine à laver, où on a accès à l’électricité et au chauffage, ressources dont tou·te·s les habitant·e·s de la ZAD ne disposent pas. Plutôt que de parler de diversité, il serait ainsi plus juste de parler d’inégalité au sein du Mouvement. Inégalité qui, si elle a été combattue par certain·e·s, persiste et fait toujours sentir ses effets.
La prise de pouvoir est d’autant plus aisée si un groupe doté de tous ces types de capital, matériel, social et culturel décide de prendre en main le fonctionnement des réunions, pour allier efficacité et défense de ses intérêts, au nom de l’intérêt commun, bien entendu. Et l’on peut s’interroger sur la « bienveillance » de ce groupe quand il décide de boycotter, comme l’a fait le CMDO à l’automne, la réunion hebdomadaire des Habitant·e·s, plus anti-autoritaire, sous prétexte qu’elle ne sert à rien. D’autant que dans le même temps, le même groupe mettait en place de nouvelles instances dirigeantes. Notons encore une fois les positions inégales entre la stratégie du CMDO qui construit ce pouvoir et prend de vitesse la majorité des habitant·e·s, et une partie des occupant·e·s qui continuent d’affirmer publiquement que le Mouvement doit avancer « au rythme de ceux qui trébuchent » (discours élaboré en réunion des habitant·e·s, dont le CMDO est officiellement absent, et prononcé à la tribune du 10 février).
Sur la ZAD, le mythe de « la recherche du consensus » a eu la vie dure. Il était clamé haut et fort que les décisions étaient prises au consensus. Ce qui faisait râler les composantes plus verticales qui estimaient que c’était une perte de temps. On voit bien, par l’analyse de l’horizontalité, qu’il ne peut y avoir de consensus si tou·te·s les participant·e·s n’abordent pas une réunion à égalité, encore moins si une bonne partie s’exclut d’un fonctionnement qui les exclut de fait. Mais le 18 janvier, au lendemain de la « victoire », les composantes extérieures, n’ayant plus en vue que la nouvelle phase de la lutte, c’est-à-dire les futures négociations[13] avec le gouvernement, ont jeté les masques. Ces négociations ayant pour enjeu la redistribution de la propriété privée (les terres et les fermes), il ne fut plus question de consensus ou de décisions prises par tout le Mouvement.
La Coordination et COPAIN, suivis par le CMDO, ont informé l’AG qu’ils allaient détruire les cabanes et les chicanes qui avaient été construites après l’opération César sur la D281 et maintenues depuis, ceci sous prétexte que le gouvernement le demandait. Ces composantes étaient soucieuses de lui montrer leur capacité à maîtriser la situation en interne.
D’autres coups de force ont eu lieu, comme rajouter en catimini une phrase pouvant susciter une opposition au communiqué commun de « victoire » adopté en AG [14] ; comme la menace de quitter le Mouvement et de laisser les occupant·e·s de la fraction dominée, les « perdant·e·s », comme certain·e·s se nomment alors, seul·e·s devant les forces de gendarmerie mobile ou la préfecture si les réfractaires refusaient les compromis.
Chronique d’une bureaucratisation en cours [15]
Il est toujours plus facile de comprendre les processus au début de leur mise en place quand ils sont encore visibles parce qu’ils se heurtent à des résistances, que lorsqu’ils sont bien huilés, qu’ils ont forcé l’acceptation de toutes et tous. Les différentes options encore possibles lors des prémisses ont disparu, et les processus installés ne sont plus remis en cause.
Le processus de bureaucratisation assurant la prise de pouvoir des fractions dominantes du Mouvement (essentiellement COPAIN, la Coordination et le CMDO [16]) fut lent et d’autant plus insidieux qu’il fut le fait de potes avec qui s’étaient nouées des connivences et des amitiés complices dans le partage de la vie quotidienne au fil des années. La ZAD a ceci de particulier, qu’y sont étroitement imbriqués les lieux de vie et les lieux de lutte. Ces liens affectifs ont affaibli la vigilance des occupant·e·s anti-autoritaires, pourtant au fait de ces processus. Le flou dans lequel restent volontairement les membres de groupes organisés au sein du Mouvement ne permet pas de nommer clairement les adversaires. L’autocensure vint aussi de la réaction de proches s’exclamant « t’es chiant·e ! » à la moindre remarque critique. L’isolement et le sentiment d’être « parano » et de se l’entendre dire a impuissanté nombre d’occupant·e·s. Celles et ceux qui étaient lucides sur la tournure de la situation, lassé·e·s d’être seul·e·s à la dénoncer, ont souvent quitté définitivement le Mouvement.
Bureaucratisation par le haut
Ce fut d’abord le contrôle des positions clés, comme le groupe presse ou la com’ externe qui centralisaient les informations, sans les redistribuer intégralement, et qui diffusaient la fable de la ZAD unie et consensuelle sur le site zad.nadir et les listes mails. Ce furent les mandats, non rediscutés, empêchant le contrôle par tou-tes des positions de pouvoir. Ce fut la spécialisation des fonctions, empêchant la rotation des tâches. Ce fut les réunions préparatoires aux AG, soit annoncées mais difficilement rejoignables par des individus non organisés au sein de groupes structurés, soit carrément non annoncées et donc non ouvertes, ce qui permettait aux élites de faire adopter en AG des décisions qui leur étaient favorables par une stratégie de groupe pré-définie.
Ces manipulations des décisions se font également à travers un lobbying informel : chantiers, « ateliers stratégies » : « Il s’agit d’inviter des gens de COPAIN, des comités, probablement de l’ACIPA, à un repas où les discussions se font de façon soi-disant informelle. Ma théorie, c’est que ces repas sont organisés quand il y a une idée à faire passer […] pour préparer le terrain et influencer les prochaines décisions. » [17]
Ce fut surtout, durant l’automne 2017, la création par le CMDO appuyé par les autres composantes, de nouvelles instances décisionnelles : l’AG des Usages, venant dans les faits concurrencer la vieille AG du Mouvement, mensuelle, où tout le monde peut venir débattre et participer aux décisions. Dans l’AG des Usages, certes le consensus est toujours de façade, mais les positions sont préalablement discutées au sein de chaque composante qui en informe l’AG.
La validation de ces décisions par l’AG prend l’aspect d’une farce dès lors qu’elles ne peuvent être contredites que par un texte, dûment argumenté, porté par un collectif ou un lieu de vie, dans un délai d’un mois.
Procédure sélective excluant bien des occupant·e·s n’ayant pas accès à internet, ne maîtrisant pas suffisamment l’écrit ou l’art de l’argumentaire, ou ne s’organisant pas en collectif interne.
Cette AG de référence est adossée à des commissions, ouvertes à toutes et tous en façade, mais requérant des disponibilités et des connaissances dont tout le monde n’est pas doté. Commission « Hypothèses pour l’avenir » devant étudier les possibilités juridiques du partage du foncier, dont les différents types de bail pouvant être négociés avec l’État, et les statuts d’une Association ayant vocation à signer les accords éventuels et à gérer les terres que l’État laisserait au Mouvement. Commission pour régler les conflits qui ne manqueront pas de survenir, et commission « bienvenue » devant accueillir les postulant·e·s à une installation sur la ZAD, et les mettre au parfum des conditions d’entrée. C’est maintenant au sein de ces commissions que s’élaborent les structures de l’avenir. En février, ces commissions se sont muées, par un processus resté opaque pour beaucoup, en un ensemble de groupes de travail dont les droits d’entrée sont restés les mêmes.
Bureaucratisation par le bas
De nombreux·ses occupant·e·s, ne faisant pas partie de la fraction dominante, sont néanmoins séduit·e·s par la redoutable efficacité mise en place dans ces structures, et s’embauchent ou se font recruter pour faire des recherches et présenter en AG les différentes options juridiques envisagées. Par là, ils et elles acceptent de travailler dans le seul cadre autorisé. Progressivement ils et elles se mettent à penser ce que, quelques semaines auparavant, ils et elles n’auraient jamais imaginé penser, et endossent des rôles de responsabilité gratifiants qu’ils et elles n’imaginaient jamais être en situation d’accepter. De part cette position « entre deux », ils et elles consentent ainsi à jouer un rôle d’intermédiaire avec les autres occupant·e·s, tentant une sorte de conciliation impossible vu le sérieux des enjeux, sauf à persuader encore une fois les plus « anti-système » d’évoluer vers les plus modérés.
Cette dynamique est-elle propre à la ZAD de NDDL ?
Peut-être vous demandez-vous si ces « dérives » bureaucratiques sont le fait d’individus opportunistes qui sévissent sur la ZAD ? Peut-être avez-vous en tête des exemples personnels de luttes confisquées de la même manière par un groupe organisé ?
Nous ne reviendrons pas sur la dynamique de bureaucratisation des luttes sociales, sur les lieux de travail. Il sort de ce cadre de décortiquer les rôles des dirigeants syndicaux, politiques ou associatifs dont la fonction est très souvent de prendre le train en marche pour mieux en contrôler la direction, et d’essouffler la machine avant d’actionner le frein. Nombre de textes et de témoignages dénoncent ces bureaucraties associatives, politiques et syndicales, à l’œuvre contre les salarié·e·s ou les habitant·e·s de quartiers de relégation.
Nous nous intéressons ici aux luttes dites de territoire, assez nouvelles dans le panorama des mouvements de contestation.
La lutte italienne NO-TAV, contre la construction du TGV Lyon / Turin dans le Val di Suza, est emblématique. Elle est mythifiée par Mauvaise Troupe, comme une lutte sœur à celle de NDDL, notamment dans le livre Contrées, 2016.
Ce serait une lutte populaire dans laquelle les anarchistes se sont retrouvés, dit-on, à lutter aux côtés des grand-mères et des députés. Anarchistes prêt·e·s à des actions de sabotage illégales, et qui une fois arrêté·e·s, ont été désavoué·e·s par une grande partie du mouvement No TAV optant pour une « composition » respectable de la lutte.
« Le rituel de légitimation de l’opposition au TAV est celui des « assemblées populaires », sorte de (prétendus) moments de démocratie directe. »
Mais ce mythe de l’assemblée, faussement horizontale, porte un tas d’éléments politiques. Il laisse le champ ouvert au leadership des meneurs de foules, il bride le plus souvent de façon implicite, mais parfois aussi de façon explicite l’initiative individuelle ou de petits groupes, il endosse le centralisme « valsusin » (l’opinion portée par les « gens de la vallée » prime sur celle des autres, du seul fait de leur origine géographique) et le compromis constant avec les composantes autoritaires (pour la plupart issues de l’Autonomie) ou légalistes (un bon nombre de comités, les pacifistes, parfois des partis) du « mouvement aux mille âmes ». Tous ces éléments sont effacés devant le seul aspect qui importe : celui de chercher une investiture dans les « masses » [18].
A Bure, où les expulsions de février n’ont pas sonné le glas de la résistance, les militant·e·s les plus aguerri·e·s sont aussi en butte aux difficultés de l’unité et du consensus. Peu de textes émanant de Bure ont été écrits analysant ces problèmes, mais dans les conversations informelles, les militant·e·s se disent souvent conscient·e·s que l’unité entre activistes politiques, habitant·e·s du lieu et associations ou groupes affinitaires est un leurre. Dans les assemblées, ils et elles rencontrent les mêmes limites du fonctionnement horizontal qui n’interroge pas les intérêts défendus par chacun·e. Mais, la lutte, dans sa phase activiste, étant plus récente, les mêmes processus ne sont pas aussi poussés. Le risque est cependant grand de voir, là aussi, les plus radicaux obligés d’en rabattre pour préserver l’unité jusqu’à un hypothétique « abandon du projet ».
Dans les luttes contre l’extractivisme, en France ou ailleurs [19], on rencontre aussi ces compositions inter-classistes. Ne pas faire le tri dans les résistances qui défendent un territoire, toutes classes confondues : péones et propriétaires terriens, de même que bénévoles de base et militants organisateurs soi-disant côte à côte, maintient une confusion idéologique au bénéfice des seconds. Il y a une corrélation sociale à ne pas occulter entre ceux qui encadrent les luttes et ceux qui sont en mesure d’en tirer le plus de bénéfices. Les États-majors ne sont jamais perdants.
Dans les luttes contre les extractions minières, comme dans toutes luttes environnementales, ceux qui sont aux commandes n’ont aucune motivation à lutter contre le monde capitaliste, dans lequel ils arrivent à défendre leurs intérêts. Par ailleurs, ils ont les moyens d’imposer une « bienveillance entre les différentes composantes », reportant ainsi la responsabilité des conflits internes sur les personnes dont l’engagement dans cette lutte est essentiellement basé sur des positionnements politiques anti-capitalistes ou « anti-système » : leur radicalité peut être instrumentalisée pour des actions ou des menaces d’actions illégales, dans lesquelles la partie citoyenniste refuse de s’impliquer. Cette « bienveillance » est en réalité une sorte d’eau bénite pour chasser cette maudite « lutte de classes ».
Si ces luttes de territoire sont nouvelles, les mécanismes décrits ci-dessus ne sont pas nouveaux. Marc Ferro [20] analyse leur mise en place dans les premières années de la révolution soviétique. En particulier, il détaille, textes à l’appui, les processus de bureaucratisation par le haut et de bureaucratisation par le bas. « […] le phénomène de capture bureaucratique n’est pas l’entrée de droit de deux membres de chaque organisation au Comité exécutif, car cette proposition fut librement discutée et votée par l’assemblée générale. Le phénomène bureaucratique apparaît dès lors que le choix des deux délégués n’est plus du ressort de l’assemblée mais des organes dirigeants de chaque organisation, de leur Bureau. L’assemblée générale a perdu son droit de contrôle. » A NDDL, c’est selon cette procédure que furent désignés les membres de la Délégation inter-composantes qui auraient voulu négocier avec l’État ainsi que les membres du Collège de l’Association.
« Ainsi, la bureaucratisation par en haut apparaît comme une des formes de la lutte que les institutions se livrent pour la conquête du pouvoir. Elle constitue une des procédures employées par un pouvoir, quel qu’il soit, pour se renforcer en subvertissant les pratiques électives, démocratiques en leur principe, mais constamment faussées. Ces traits sont corroborés par les caractères spécifiques de la bureaucratisation par en bas. » (Marc Ferro).
Territoires en lutte et lutte de classes
Les luttes environnementales dans lesquelles s’engouffrent bien des activistes ont pour but de s’opposer à l’aménagement étatique du territoire, mais elles laissent de côté les problèmes de l’exploitation salariale et de la propriété privée, dont l’abolition est fondamentale pour l’avènement d’une société égalitaire. Occultant ces aspects sur lesquels tous les mouvements sociaux actuels se sont cassés les dents, les activistes et leurs alliés citoyennistes estiment que la lutte des classes n’est plus d’actualité. Seulement, qu’on le veuille ou non, elle fait rage, même dans les luttes de territoire. Travestir les rapports de classes en relation de voisinage, les inégalités sociales et économiques en complicités locales est une perversion, dénoncée dans la lutte NO TAV, qui a permis aussi sur la ZAD de faire accepter la destruction immédiate de la route des chicanes « pour rassurer les voisins ».
Refuser de voir ces antagonismes, mis sous le coude un temps mais qui ressurgissent dès que possible, sous prétexte que « ces luttes nous les avons gagnés ensemble, toutes sensibilités d’action confondues, et nous les finirons ensemble. » [21], c’est se préparer à des désillusions qui n’auraient pas lieu d’être si ces dynamiques de réformisme et de bureaucratisation étaient dénoncée dès le début pour tenter de les enrayer.
Nous n’avons pas traité tous les aspects de cette lutte (les nécessités matérielles subordonnées aux tâches d’organisation, par exemple [22]), et certains considérés ici auraient mérité plus d’approfondissement. Espérons que ces quelques clés vous permettront d’ouvrir des discussions sur NDDL, et plus généralement sur les prises de pouvoir dans les luttes que nous vivons les un·e·s les autres.
Cette bureaucratisation de la lutte à NDDL fait d’autant plus rager que l’occupation de la ZAD a permis des expériences passionnantes d’agriculture hors normes, d’habitations auto-construites, d’artisanat et d’activités artistiques hors contrôle, de tentatives de relations sociales sans domination sexiste ou raciste pendant près de dix ans. Cette lutte est aussi intéressantepar les réflexions de celles et ceux qui subissent ces dynamiques de prise de pouvoir, qui en prennent conscience progressivement voire tardivement, puis qui tentent de s’y opposer sans grande efficacité jusque-là, mais qui ne baissent pas les bras.
Laissons la parole à une occupante de la ZAD : « Je crois que c’est la chose la plus passionnante que l’on puisse faire ici, inventer de nouvelles formes d’organisation, ne pas se laisser faire et trouver à s’adapter quand on a l’impression de se faire marcher dessus, réfléchir collectivement à ce qu’on rêve de construire ici. » [23]
Une rébellion en voie d’intégration
Acceptation et pacification : cas pratique : la D281
Ce qui a été décrit plus haut sont des mécanismes qui se sont mis en place progressivement depuis de longs mois. Certain·e·s vous diront dès le début des occupations, pratiquement. Puisque la lutte est passée à une autre phase le 17 janvier, qu’en est-il maintenant (mars 2018) ?
Pour les composantes qui étaient prêtes à négocier, il n’y avait plus de temps à perdre. Depuis la mise en place de la nouvelle AG des Usages et de ses commissions satellites, les discussions de fond étaient écartées sous le prétexte bien connu de l’urgence du moment. Le 18 janvier, il n’y eut plus d’hésitations. Au cours de l’AG exceptionnelle du soir, COPAIN et la Coordination, suivis par le CMDO, ont annoncé que, puisque l’État le demandait, ils allaient commencer le démantèlement de la route « des chicanes » dès le lundi 22 janvier. Pas de discussion possible, pas de concessions envisageables. Les occupant·e·s, sous le choc de ce coup de force qu’un paysan de COPAIN a reconnu un mois plus tard être « merdique », n’ont pu qu’obtempérer sous la menace à peine voilée de se retrouver seul·e·s et d’être stigmatisé·e·s s’ils s’opposaient. Tout le monde avait en mémoire le précédent de l’AG du 1er Août (voir plus haut).
Les réfractaires à la libre circulation sur la route des chicanes (pour maintenir une pression en cas de menace d’expulsion) avaient été amenés durant l’hiver à réfléchir à un possible aménagement de cette route. Non pas à la normalisation ou non de cette route, notez bien, mais à la manière de la normaliser. Des « cercles de qualité » ont été mis en place au cours desquelles ces modalités ont été discutées. Peu à peu, il ne fut même plus pensable de la garder en l’état. Il fallait la rendre à l’État…
La semaine qui suivit fut cruciale pour la suite. Les comités de soutien, appelés en renfort, comprirent sur le tas que le « tous ensemble » dont leurs organisateurs les avaient bercés ne résistait pas à l’épreuve des faits. Les initiateurs de cette destruction, appuyés par les tracteurs, redoutèrent que des oppositions tournent à la violence. Ils étaient si conscients de la tension interne au Mouvement qu’ils bloquèrent la presse hors de la route, alors qu’ils sont si friands de ces relations médiatiques depuis des années. Tranche par tranche, les chicanes furent détruites, les pneus et carcasses de voitures emportés au loin. Beaucoup d’occupant·e·s eurent à cœur de le faire proprement puisqu’il fallait le faire. D’autres occupant·e·s jouèrent le rôle d’intermédiaire auprès des réfractaires, pour « apaiser », pour tenter contre toute évidence de réduire le fossé qui se creusait entre les différentes fractions du Mouvement. Il fut patent pour toutes et tous que désormais, certaines composantes étaient à la manœuvre et useraient à l’avenir de ces stratagèmes pour faire valoir leurs intérêts liés à la propriété privée [24], et que d’autres seraient les dindons de la farce, et que leurs intérêts (dont le principal était de vivre sur la ZAD, dans la zone non motorisée, mais pas que) ne seraient pas pris en compte. Entre ces deux pôles, des individus isolés se radicalisaient, voyant l’irrémédiable créée par ce coup de force, ou au contraire faisaient concession sur concession pour pallier les conséquences.
Depuis, la route est officiellement « ouverte ». Les ouvriers se sont relayés pour la nettoyer (élagage des haies, curage des fossés, busage des entrées de champs ou de chemins, travail sur le revêtement). La préfecture qui contrôle ces travaux ne tint aucun compte des demandes (peut-on parler de revendications devant un rapport de force si disproportionné ?). Les naturalistes en lutte ont été un des rouages d’apaisement en négociant des travaux « respectueux de la biodiversité ». A la fin des travaux, force a été de constater qu’ils avaient été des plus destructeurs : il ne reste pas une plante entre la chaussée et les haies rendues translucides tellement elles ont été massacrées. Mais c’est fait : la terre est à nue, et les « voisins » viennent en famille y faire leur promenade dominicale…
La route est donc ouverte aussi à la présence des forces de l’État. Compagnies de gendarmerie, de renseignement, anti-terroristes aussi, accompagnèrent tous les jours les ouvriers. Officiellement pour les « sécuriser ». Mais en réalité pour capter tous les renseignements possibles : fichage des personnes, repérage des lieux, et même fouille d’habitations à proximité en l’absence des occupant·e·s. Cela demanda une énorme énergie de surveiller les flics en permanence pour éviter les intrusions, de jouer encore une fois l’apaisement pour éviter qu’un dérapage puisse servir à la répression. D’autant que les personnes qui veillèrent à ce que les flics restent sur la route furent seules. Pas de relais, aucune solidarité. Les fractions dominantes du mouvement firent ainsi payer la rébellion de la partie précaire et méprisée du mouvement. Tout en préparant les négociations, ils obtinrent, par la fatigue et la démoralisation, une acceptation et pacification qu’eux seuls pouvaient obtenir grâce au travail des occupant·e·s en position intermédiaire.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de résistance. Dans un pré limitrophe à la route, Lama Fâché a été reconstruit : un bel hangar offert par une voisine, une cantine fonctionne avec du matériel et des aliments donnés par certains lieux de vie de la ZAD (mais pas tous). Et certains travaux de la DDE sont sabotés aussitôt finis. Seulement, fin février, la solidarité avec les expulsés de Bure a été difficile à mettre en place. Ces occupant·e·s méprisé·e·s et laissé·e·s seul·e·s face aux flics (« C’est de votre faute, si les flics sont sur la zone ») ne voient pas pourquoi ils dépenseraient de l’énergie à une solidarité dont eux-mêmes ne bénéficient pas.
Délégation et négociation
Le problème de la délégation pour aller négocier avec l’État est une autre voie d’intégration de cette rébellion « zadiste ». Si la perspective d’aller négocier avec l’État, qui avait été combattue pendant des décennies jusqu’à l’obtention de l’abandon du projet d’aéroport, était préparée de longue date par les composantes citoyennistes, il n’en allait pas de même pour une partie des occupant·e·s qui avaient lutté contre l’aéroport mais qui entendaient bien continuer à lutter contre son monde. Les paysans de la Confédération Paysanne mettent désormais en avant la satisfaction de leurs intérêts : ils attendent d’une négociation le gel des terres, le temps de s’organiser.
« Foncier droit devant » dit la plaquette signée par le CMDO, le 10 février [25]. Ils ont montré leur bonne aptitude à gérer les « Zadistes » et à les maintenir dans un cadre acceptable pour l’État. Leur lutte est maintenant dirigée contre la FNSEA et ils espèrent que l’État sera sinon de leur côté, du moins un arbitre « bienveillant ». Les élites des occupant·e·s, en particulier le CMDO et ses proches, attendent de cette négociation une reconnaissance en tant qu’interlocuteurs, pour la pérennité de leur présence sur la zone, afin de garder leurs ressources matérielles et sociales qui permettraient « d’assurer le rayonnement de la lutte de la zad à l’international ».
Pour garder cette image de démocratie qui prend soin de toutes et tous, il fallait convaincre le maximum d’occupant·e·s anti-autoritaires et anti-capitalistes de participer à cette négociation. Ce n’est pas rien pour des gens, qui ont refusé pendant des années d’avoir des porte-parole, de désigner des délégué·e·s. Ce n’est pas rien non plus pour des gens qui ont vécu les violences policières de 2012, de Sivens ou de Bure, les violences étatiques d’exclusion sociale de toutes sortes, d’accepter de reconnaître l’État comme interlocuteur.
Pour cela, il y eut moult réunions, de différentes formes, pour amener les gens à réfléchir dans le cadre. Réunions bien contrôlées par des « facilitateurs et facilitatrices » chevronné·e·s qui savaient couper la parole des importun·e·s ou recadrer les indécis·e·s. Par exemple, on pouvait discuter de ce qu’on allait demander à la négociation ou de ce qu’on n’accepterait jamais comme compromis. Mais on ne put jamais remettre en cause l’opportunité même de cette négociation. On put réfléchir aux compétences demandées aux délégué·e·s, et de leur nombre, mais pas de savoir si les occupant·e·s en voulaient. Peu à peu, les réticences s’amoindrirent. Et les occupant·e·s les plus critiques s’adaptèrent aux contraintes imposées. Même l’expulsion militarisée des occupant·e·s de Bure, en lutte contre le projet d’enfouissement de déchets nucléaires, qui a fait 15 arrestations, n’a pas remis en cause le processus de négociation. Solidarité avec Bure certes, mais que cela ne trouble pas nos affaires à venir.
Il faut noter, pour la petite histoire, que le CMDO, qui est constitué d’occupant·e·s, a décidé d’envoyer un délégué uniquement pour son groupe, et qu’il ne représente donc pas les autres occupant·e·s. A noter aussi qu’au bout du compte, il reste une bonne partie des occupant·e·s qui n’a pas joué le jeu de ces réunions longues et fastidieuses, et qui est restée sur le bas-côté. Ils et elles ne se sentent nullement représenté·e·s. Ils et elles ne sont nullement pris·e·s en compte : « ils n’ont que ce qu’ils ont cherché ! ».
Le 28 février, la préfète a opposé une fin de non-recevoir à la délégation : elle ne veut pas entendre parler de l’association, ni du gel des terres, ni d’amnistie. Elle a lancé un préavis pour les expulsions « des gens qui sont contre l’Etat de droit mais qui touchent le RSA ». Elle entend mener des discussions avec tous les « partenaires » (FNSEA, Chambre d’agriculture…) au sein d’un Comité de pilotage et pas des négociations bilatérales (avec seulement la délégation du Mouvement). Le 20 mars, S. Lecornu, bras droit de N. Hulot, a confirmé les mêmes positions.
Du coup, les têtes pensantes ont pris le principe de réalité de face. Ils accusent le coup en disant : « on l’avait prévu, l’Etat nous teste au premier rendez-vous ».
Les appellistes tentèrent de mettre la barre plus haut en organisant un rassemblement (« excessivement tranquille » pour rassurer l’ADECA qui va siéger au Comité de pilotage) devant la préfecture le 19 mars et en appelant toutes les associations à manifester contre toutes les expulsions le 31 mars, fin de la trêve hivernale, à Nantes. Ils espèrent encore forcer la porte de la préfète et amorcer des négociations avec l’Etat. D’autres occupant·e·s espèrent toujours, après cet échec, retrouver l’unité perdue, en se lançant dans des actions contre les expulsions.
Légalisation et expulsions
La légalisation en vue d’éviter l’expulsion promise par E. Philippe à la fin de la trêve hivernale est une des perches tendue par le gouvernement pour sortir la tête haute de ce conflit. Lui non plus n’a pas envie de ternir son image de marque en se lançant dans un processus d’expulsions hasardeux. Les occupant·e·s ont bien souvent l’expérience de ces situations, et s’ils ne les recherchent pas, ils seront des clients difficiles à mater.
Le gouvernement propose de péréniser la présence d’une bonne partie des occupant·e·s, à la condition qu’ils et elles acceptent de légaliser leurs activités « illégales ». Entendez par activités illégales, les habitations auto-construites sans permis, les activités forestières ou agricoles hors normes, la résidence de personnes sans papier ou hors contrôle, par exemple.
Combien d’occupant·e·s seront prêt·e·s à être fiché·e·s, combien auront les moyens de se mettre aux normes, de payer les diverses taxes ? Combien seront d’accord pour vivre une vie normalisée alors que de nombreuses expériences artisanales, agricoles, sociales, artistiques foisonnent sans demander aucune autorisation à personne (sauf aux proches concerné·e·s) ? Ce sont des questions qui sous-tendent bien des conversations, mais qui ne sont jamais débattues en réunion. Trop délicates, pas le temps…
Les paysan-nes de la CLIC (occupant·e·s ayant des activités agricoles pourleur propre compte) entendent bien profiter de la main tendue par la préfète et se légaliser, sans tenir compte de leur ancienne lutte « hors cadre », c’est-à-dire « hors normes » en parole.
Pour ce qui est des expulsions, on comprend un peu plus à chaque réunion la filouterie de la fraction dominante du mouvement. La délégation, malgré le mandat reçu, n’est pas partie du bureau de la préfète lorsqu’elle les a envoyés bouler : « il y aura des expulsions ciblées ». Forcément, l’ADECA, l’ACIPA et la Conf’ venaient de recevoir leur invitation pour le Comité de pilotage. Les occupant·e·s n’ont pas rompu l’unité en sortant seul·e·s du bureau… Plus se rapprochait l’heure des expulsions, plus les positions des composantes devenaient cyniques : « d’accord pour s’opposer aux expulsions au sein du mouvement mais les saboteurs sur la route se sont mis eux-mêmes hors du Mouvement. »
Et il se dit maintenant qu’il n’est pas possible de s’organiser en amont des expulsions : impossible à prévoir, puisqu’elles sont ciblées. Mais on s’engage « à reconstruire les cabanes en plus joli », avec un mépris et un paternalisme qui font froid dans le dos. Les fractions dominantes ont l’art de ne pas voir la capacité de reconstruction des « gens de l’Est » qui ne les ont pas attendu pour reconstruire Lama Fâché. Et ces interventions sont faites par des gens « de l’entre-deux » qui font de plus en plus mouvement vers les dominants.
Intégration de la rébellion
Bien qu’averti·e·s de la manière dont les prises de pouvoir se sont déroulées dans le passé et dans les luttes contemporaines, nous en avons subi les effets sur nous. Nous revenons quelques instants sur une sorte « d’auto-analyse » politique pour tenter de comprendre les mécanismes mis en œuvre. Ceux décrits ci-dessous ne sont pas les seuls, il y en a de plus violents qui permettent de ramener les plus récalcitrant·e·s à la raison, en particulier les insultes, les attaques personnelles, les chantages, les menaces ou la réalisation des menaces.
Nous avons été étonnés de nous rendre compte, après coup, que nous avions « cru » à la fable de la préfète acceptant qu’une « cabane de punk-à-chien » (Lama Fâché) se pérennise au milieu d’une départementale normalisée à 90km/h. C’était rationnellement inconcevable. Mais on a fini par y croire. Juste, on n’a pas été surpris quand COPAIN annonça que « la préfète voulait sa destruction ». Autre exemple : nous étions sûrs, expériences (des autres) à l’appui, qu’une négociation avec l’Etat ne pouvait se faire sans mise en place d’un rapport de force. Mais nous avons « cru », portés par l’illusion collective, que cette délégation pourrait obtenir un petit quelque chose, même insuffisant. Nous n’avons cependant pas été surpris de la fin de non-recevoir de la préfète. Ce redoutable mécanisme psychologique de double pensée, qui consiste à retenir à la fois deux pensées qui s’annulent tout en niant leur opposition, inhibe toute résistance. Cette double pensée est encore à l’œuvre dans la tête de bien des occupant·e·s qui, malgré les preuves d’inégalités et de dominations qu’ils et elles avaient sous les yeux, ont continué à croire de façon irrationnelle à « l’unité du Mouvement ».
Un premier mécanisme à l’œuvre dans cette lutte a été la mise en place de moult réunions internes aux occupant·e·s, pas fermées mais pas ouvertes, appelées souvent par message d’urgence, où les occupant·e·s étaient amenée·e·s à se positionner dans un cadre imposé. Nous les appelons des « cercles de qualité » : tout comme chez Toyota où les exécutant·e·s se réunissent pour améliorer les conditions de leur exploitation, les occupant·e·s furent amenées à réfléchir sur l’acceptation de ce qu’ils et elles refusaient. Ce fut le cas tout d’abord pour la destruction de la route, puis pour l’idée d’aller négocier avec l’Etat, puis pour désigner sans voter des délégué·e·s.
Après l’échec de la délégation, ce fut le cas pour les manières de ne pas s’opposer aux expulsions, mais de reconstruire derrière « en plus joli ». Dans un premier temps, l’idée même révulse, puis comme les potes mettent un neurone dans l’engrenage, on se fait soi-même au cadre imposé et on se surprend à se débattre dans les rets de cette pensée embarquée. Du coup, cet engluement bureaucratique empêche une pensée autonome approfondie. Pour ou contre, elle se définie toujours par rapport à ce cadre.
Un deuxième mécanisme qui déstabilise la réflexion est le pilonnage idéologique via des personnes différentes, un tir croisé en quelque sorte. Il y a le délire de toute puissance dont la plaquette « Zad will survive » publié à des milliers d’exemplaires pour la kermesse du 10 février est un des derniers exemples (« nous sommes les plus forts et nous allons leurrer l’Etat »). D’autre part, le mouvement de personnes critiques vers les positions dominantes déstabilise réellement, alors qu’elles avaient eu des positions ou qu’elles avaient écrit des textes avec lesquels on était d’accord par le passé. C’est le rôle des « entre deux », il est très efficace. D’autant que ce mouvement n’est pas un brusque retournement, mais un pas à pas insidieux qui témoigne aussi de la déstabilisation de ces personnes. Se retrouvant ainsi à réfléchir avec des personnes mouvantes (comme on dit des sables qu’ils sont mouvants), on se met à douter de la pertinence de nos analyses et même de la radicalité de nos positions. La vigilance est d’autant plus affaiblie que ces personnes nous sont proches.
Un troisième mécanisme est celui de la division du travail de domination. Au cours des mois précédents, de nombreuses commissions mutées en groupes de travail ont accaparé l’énergie de toutes sortes d’occupant·e·s : depuis les têtes pensantes jusqu’à des intermédiaires soucieu-ses d’être reconnu·e·s dans leur compétences, en passant par les leaders de composantes ayant un réseau extérieur qu’ils disaient puissant. Cette hiérarchie dans l’élaboration du futur, laissant sur le bas-côté un grand nombre d’occupant·e·s, dépossèdent ces derniers d’un savoir qui se construit sans eux. Nous sommes dès l’école conditionnés à éprouver une certaine fascination, pour ne pas dire soumission à toute procédure, à tout règlement. Ces figures d’autorité qui s’auto-proclament les plus compétentes et qui sont celles qui, dans les faits, ont les cartes en main, désarment celles et ceux qui ne siègent pas dans ces instances. Comme toujours, on se sent inférieurs à ces experts, on inhibe toute critique, on s’autorise tout juste une question timide.
C’est ainsi que se met en place le travail d’assimilation de la ligne dominante.
En s’appuyant sur les travaux de Pierre Bourdieu, on peut décrire trois formes. La forme objectivée, qui prend l’aspect très concret de documents et de textes. On pense ici à Sursis ou sursaut, paru dans le ZadNews, à l’été 2017, ou Le manteau et le corps, paru quelques semaines plus tard. Ces textes portent l’analyse du CMDO dans toutes les cabanes, et les têtes qui y vivent. Il prend aussi la forme institutionnalisée, de nouvelles commissions et AG des usages, qui ont été créées avec des règles qui verrouillent les oppositions […]. Ces procédures bureaucratiques éliminent bien des opposant·e·s qui se retranchent dans un entre-soi peu efficace. La forme incorporée est la plus redoutable. Cette forme n’est pas imaginaire. C’est le cerveau qui travaille réellement. On en arrive à dire, par un renversement psy- chologique redoutable : « l’AG des usages pense comme moi ». Et on se conforme, sans s’en rendre compte, à ce qui a été validé dans cette chambre d’enregistrement des décisions prises en amont.
C’est ainsi qu’on arrive à penser comme incontournables des situations qu’on jugeait impensables.
A l’instar de ce qui s’est passé en URSS, toutes proportions gardées, les op- posant·e·s à la fraction dominante qui prenait progressivement le pouvoir se sont tu. Vers l’extérieur : pour ne pas ternir l’image du « Mouvement » et amoindrir la solidarité indispensable pour atteindre le but fixé : l’abandon du projet d’aéroport. Vers l’intérieur aussi : l’autocensure a été puissante. Et il a fallu des semaines, après l’annonce de cet abandon le 17 janvier 2018, pour que les paroles se libèrent et que des textes d’analyse critique soient publiés. Comme au sujet de l’URSS, les premiers à dénoncer cette situation n’ont pas été crus, ils ont même été traités de « menteurs », de « paranos », de « diviseurs »… Comme en URSS, les opposant·e·s ont, dans un premier temps, tout fait pour assurer la pérennité du groupe. L’idée de rupture était inacceptable. Les intérêts du collectif passaient avant ses intérêts personnels. Nombre d’entre elles et eux ont participé pleinement à la préparation de manifestations qu’ils et elles critiquaient [26], estimant que leur devoir était de « faire fonctionner la ZAD même si on n’est pas d’accord », culpabilisant même de ne pas être à la hauteur du rythme de travail imposé.
Conclusion ? l’expulsion de la conflictualité
Il n’y a pas de conclusion possible. L’histoire n’est pas finie. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la date de l’ultimatum pour les expulsions n’a pas encore été dépassée. Gageons que ce sont les plus précaires, les plus « border-line », celles et ceux qui seront désignés par l’Etat, ou qui ne pourront pas ou ne voudront pas se plier aux diktats de l’État qui feront les frais de la normalisation. Beaucoup ne verront plus aucun sens à vivre dans une zone devenue une réserve touristique ou écologique[27], et s’en iront d’eux-mêmes. D’autres, par bravade ou parce qu’ils et elles n’ont nulle part où aller attendront de se faire expulser, par petites vagues.
Pour dire vrai, les expulsions ont commencé depuis bien longtemps, avec le départ des opposant·e·s qui ne voyaient plus de sens à rester alors qu’ils et elles voyaient se profiler une normalisation dévastatrice que peu de monde voulait ou pouvait combattre.
Les expulsions ont pris une autre tournure dès le 1er juin 2017, quand le premier ministre a nommé une médiation et que les composantes de la lutte (sauf les occupant·e·s, alors) se sont précipités pour être entendues. Puis en février et mars, quand les délégué·e·s (y compris les occupant·e·s) sont allés en préfecture, dans l’espoir d’une négociation que l’Etat leur refuse. Ce fut l’expulsion de la conflictualité qui a eu lieu alors. En douce, évacuée dans le coffre de voiture des délégué·e·s… Depuis, elle n’a jamais pu revenir.
I. M., 30 mars 2018.
Notes:
[1] En particulier : Mouvement où est ta victoire ?
[2] Le « mouvement » est mort. Vive… la réforme !
[3] Pour en savoir plus sur la « Coord ».
[4] Pour en savoir plus sur COPAIN.
[5] Note de zz de Squat!net: les premiers squats de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes datent de 2007.
[6] Pour en savoir plus : Revue Tiqqun (1999), L’insurrection qui vient (La Fabrique, 2007), À nos amis (2014), entre autres.
[7] Note de zz de Squat!net: où et comment peut-on réussir à tirer un classement sociologique aussi schématique ? La plupart des gens qui forment les « groupes organisés » de la ZAD ne sont pas issu·e·s de la petite bourgeoisie (qu’il faudrait définir, par ailleurs… parce qu’un peu comme « classe moyenne » ça sert souvent de fourre-tout plus ou moins méprisant basé la plupart du temps sur des préjugés plutôt que sur une analyse sociale sérieuse). S’il y a certainement parmi les « appellistes » une proportion plus élevée d’enfants de bourgeois·es que dans le reste du mouvement, je ne serais pas étonné qu’il n’y ait pas que des enfants de prolos dans l’est de la ZAD, car les choses sont souvent plus compliquées que les discours réducteurs qu’on peut asséner. Dans le vaste mouvement squat/anar/zadiste, il y a des enfants de prolos, des enfants d’employés intermédiaires, des enfants de profs ou instits, des enfants de bourges, et tou·te·s ne se retrouvent pas forcément dans des tendances politiques correspondantes, les choses sont plus compliquées que ce que les discours des un·e·s et des autres prétendent.
[8] Constellations, Ed. de L’Eclat, 2014. Contrées, Ed. de L’Eclat, 2016. Saisons, Ed. de l’Eclat , 2017.
[9] « Fête des bâtons », octobre 2016 : bousculades de journalistes. Campagne électorale, avril 2017 : jet de purin sur le pare-brise d’une voiture de journaliste lors d’une conférence de presse d’une candidate de la France Insoumise au hangar de la Vache Rit. Fête de la Coordination, juillet 2017 : altercation contre les experts de Nexus qui y tenaient un stand après avoir participé à un colloque du Front National.
[10] Note de zz de Squat!net: cette assertion me paraît aussi fausse que maladroite; il y a un bon paquet de grandes gueules qui sont des ignorants finis, et un bon paquet de gens avec une culture générale/personnelle/politique énorme qui n’osent pas prendre la parole en public. Présumer du capital culturel des gens en fonction de leur niveau d’étude ou de leur origine sociale, c’est caricaturer le réel, et faire passer les gens qui se taisent pour des incultes… Il y a bien d’autres raisons/blocages/peurs/envies qui font que les gens osent ou non prendre la parole en public.
[11] Note de zz de Squat!net: là aussi, c’est omettre que des gens très cultivé·e·s (à tous points de vue) peuvent vivre dans la solitude, le dénuement, loin des rapports de pouvoir et d’oppression. Ensuite, que des gens s’organisent matériellement, ça semble logique et important. Que ça se fasse de manière pas du tout égalitaire parce que certain·e·s bénéficient de l’apport financier de leurs bourgeois de parents, on est bien d’accord, mais autant dire les choses franchement plutôt que de faire croire que les plus cultivé·e·s sont forcément les plus bourgeois·es et privilégié·e·s.
[12] Note de zz de Squat!net: le texte ne les mentionne pas, mais de nombreux outils collectifs ont été mis en place sur la ZAD sans pour autant être restreints à des « bandes » particulières. Par exemple, le ZadNews a beaucoup servi à combler les écarts entre ceux-celles qui parlent au nom de la ZAD et ceux-celles qui n’ont pas les moyens matériels pour diffuser facilement leurs idées et leurs points de vue.
[13] On sait maintenant que la délégation a été éconduite par l’Etat le 28 février puis le 20 mars. Les négociations rêvées par les composantes ne sont plus d’actualité. Par contre les expulsions ciblées sont maintenues. L’échec des délégué·e·s n’a pas l’air de les inciter à se remettre en cause.
[14] Pour en savoir plus : Contre l’aéroport – et pour son monde, ou quoi ?
[15] Pour une vision approfondie : Le « mouvement » est mort. Vive… la réforme !
[16] « La lutte fondamentale aujourd’hui est entre, d’une part, la masse des travailleurs – qui n’a pas directement la parole – et, d’autre part, les bureaucraties politiques et syndicales de gauche qui contrôlent – même si c’est seulement à partir des 14% de syndiqués que compte la population active — les portes des usines et le droit de traiter au nom des occupants. Ces bureaucraties n’étaient pas desorganisations ouvrières déchues et traîtresses, mais un mécanisme l’intégration à la société capitaliste. » Comité pour le maintien des occupations (l’original pas la copie), Paris 22 mai 1968.
[17] De la bile sur le feu et autres états d’âme anti-autoritaires (ZAD, 2017).
[18] Pour en savoir plus : No-TAV, défendre un territoire ou détruire le vieux monde ?
[19] Pour en savoir plus : Extractivisme, exploitation industrielle de la nature, Anna Bednik, Le passager Clandestin, 2016.
[20] Pour en savoir plus : Des soviets au communisme bureaucratique. Les mécanismes d’une subversion, Marc Ferro, Folio, 1980, réédition 2017.
[21] Soutenir Bure, toujours.
[22] L’aspect pyramidal des luttes même horizontales : il y a toujours moins de personnes qui font des propositions que de gens requis pour les mettre en œuvre, il serait important d’analyser les racines de cette différence numérique. Par ailleurs, il y a des gens qui surfent sur les luttes surtout longues pour faire carrière. Tant qu’on n’aura pas analysé et résolu ce problème, il sera difficile d’avancer. La division entre travail manuel et travail intellectuel dans chaque groupe et à différentes échelles est un autre thème.
[23] De la bile sur le feu, op. cit.
[24] Pour en savoir plus : Déchicanisons : comme un malaise.
[25] Pour en savoir plus : ZAD will survive.
[26] Comme la Fête des bâtons, le 8 octobre 2017 ou la fête de la victoire le 10 février 2018.
[27] Pour en savoir plus : Ça y est, on a gagné.