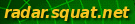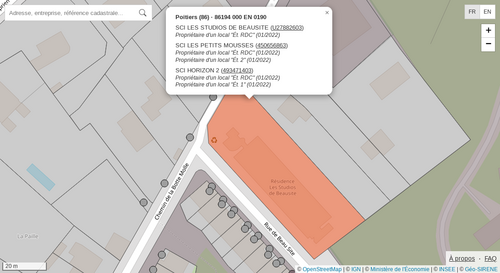« Demain s’ouvre au pied de biche »
« Demain s’ouvre au pied de biche »
À Rennes, dimanche 1er mai, quelques centaines de manifestants investissaient la salle de la Cité. Après deux nuits d’occupation, la mairie renonçait à l’évacuation – non sans avoir préalablement menacé de mandater ses flics pour vider les lieux. Mercredi 4 mai, la salle de la Cité était ainsi rendue (semi-)officiellement à sa fonction et à sa dénomination première : elle était, pour une nouvelle fois, la Maison du Peuple.
A la suite de ce texte, nous relayons aussi l’appel de la Maison du Peuple : « Occuper devient vital ! ».
Petite histoire de la Maison du Peuple
La Maison du Peuple de Rennes a subi, depuis sa construction en 1925, le nivellement du temps et l’érosion des processus historiques. Erosion matérielle, érosion symbolique : d’une époque à l’autre, les noms changent. La salle de la Cité a ainsi éclipsé la Maison du Peuple dont elle était seulement une partie. Née des mouvements ouvriers de la fin du XIXe siècle, la Maison du Peuple, emmenée par les syndicats, avait pour double fonction l’instruction et le divertissement. La salle a ainsi constitué, durant plusieurs décennies, le corps de rassemblements politiques et syndicaux. Elle sera ensuite un cinéma, une salle de théâtre, puis un lieu de concert. Mais la corruption des mots a simultanément accompagné la déchéance matérielle de l’espace.  De la Maison du Peuple ne subsiste aujourd’hui que des reliquats, reliques, foliations d’un temps passé. On s’émerveillera encore de l’inscription « Maison du Peuple » sur le fronton du bâtiment, visible depuis la rue d’Échange. On éprouvera même un léger frisson historique devant la fresque de la salle de la Cité, représentant divers métiers du bâtiment. Expérience de luttes qu’on espérerait encore vivantes, mais que la mairie s’active depuis plusieurs années à renvoyer au statut de témoignages historiographiques. En 2013, Rennes Métropole a écrit sur son site : « la Maison du Peuple ne sera plus qu’un tas de gravats en fin de semaine ». La partie située rue Saint-Louis, qui abritait notamment les bureaux de la CGT, est rasée pour construire, à l’horizon 2016, un « équipement de quartier intergénérationnel », s’entend : une crèche et une maison des associations. La gentrification et le nettoiement du centre-ville parachève ainsi l’éclipse d’un lieu autrefois lié au mouvement ouvrier et aux luttes sociales, qui ne devrait subsister que dans un regard nostalgique et mythographique porté sur une époque que certains souhaiteraient définitivement révolue. On comprendra ainsi que l’occupation de la salle de la Cité, dans la manière qu’elle a eu d’interrompre une lente débâcle historique, prenne un sens particulier.
De la Maison du Peuple ne subsiste aujourd’hui que des reliquats, reliques, foliations d’un temps passé. On s’émerveillera encore de l’inscription « Maison du Peuple » sur le fronton du bâtiment, visible depuis la rue d’Échange. On éprouvera même un léger frisson historique devant la fresque de la salle de la Cité, représentant divers métiers du bâtiment. Expérience de luttes qu’on espérerait encore vivantes, mais que la mairie s’active depuis plusieurs années à renvoyer au statut de témoignages historiographiques. En 2013, Rennes Métropole a écrit sur son site : « la Maison du Peuple ne sera plus qu’un tas de gravats en fin de semaine ». La partie située rue Saint-Louis, qui abritait notamment les bureaux de la CGT, est rasée pour construire, à l’horizon 2016, un « équipement de quartier intergénérationnel », s’entend : une crèche et une maison des associations. La gentrification et le nettoiement du centre-ville parachève ainsi l’éclipse d’un lieu autrefois lié au mouvement ouvrier et aux luttes sociales, qui ne devrait subsister que dans un regard nostalgique et mythographique porté sur une époque que certains souhaiteraient définitivement révolue. On comprendra ainsi que l’occupation de la salle de la Cité, dans la manière qu’elle a eu d’interrompre une lente débâcle historique, prenne un sens particulier.
La profanation par l’exemple
Depuis le début de ce mouvement, on nous a interdit le centre historique pour qu’il ne fasse plus l’histoire et qu’il reste à l’état de « bulle autistique », petit Hummer bien garé, indemnisé du présent. Avec la prise de la Cité, il aura suffi d’une foule rapide pour redonner au centre ville quelque chose d’historique. Ce qu’on appelle d’ordinaire gentrification est une longue gouttière dans laquelle coulent nos villes transformées en métropole. L’expérience sensible qu’il nous restera bientôt d’elles est à peu près celle que l’on peut faire actuellement dans un musée. Ne pas toucher, ne pas crier, ne pas boire, ne pas s’asseoir par terre, ne pas écrire sur les murs. Toute une série de « ne pas » qui font reculer les choses sous nos pas. Le symbolique gagne du terrain sur le réel et met toute chose à bonne distance de l’humain. Pendant que la possibilité du commun se retire, les services communication tournent à plein régime et produisent des brochures en papier glacé pour être bien sûr que tout le monde a compris que sa ville était la première quelque part (la plus belle, la plus fleurie, la plus jeune, etc). La métropolisation n’est à penser que comme un vaste processus de sacralisation de l’espace social : elle sépare la ville du monde des hommes pour la faire exister dans l’espace virtuel national-européen-mondial. Métropole est le nom que l’on donne aujourd’hui à une ville sacrifiée et le sacrifice se lit dans une multitude d’appellations (parc urbain, centre des congrès, eurogare, etc). L’État nomme actuellement aménagement ce qui est en vérité la production du sacré. Et qu’il y ait quelque chose de fondamentalement religieux dans ce phénomène n’est pas une surprise. Il revient à Giorgio Agamben d’avoir explicité tout cela avec la plus grande clarté.
« On peut définir la religion comme ce qui soustrait les choses, les lieux, les animaux ou les personnes à l’usage commun pour les transférer au sein d’une sphère séparée. Non seulement il n’est pas de religion sans séparation, mais toute séparation contient ou conserve par devers soi un noyau authentiquement religieux »
 Tout ce que touche le capitalisme, et donc l’État, devient parfaitement intouchable : la muséification du monde semble être son point final. Tout, aujourd’hui, revêt une dimension sacrée – est soustrait à la possibilité de l’usage. Dans nos vies quotidiennes, les exemples pullulent : « ne déplace pas cette chaise de la bibliothèque municipale, elle est réservée à la consultation d’ouvrages anciens », « je suis désolé mais vous ne pouvez pas jouer avec vos skateboards ici, c’est un espace réservé à la vie piétonne », « ce rond-point n’est pas un jardin monsieur ». On rencontrera de tel pape partout où le sacrifice a lieu : les banques, les mairies et la majorité des lieux publics. Avec la prise de la Cité, nous avons assisté à un acte de profanation tout à fait exemplaire, la profanation étant à comprendre comme la restitution à l’usage commun de ce qui avait été séparé dans la sphère du sacré. La salle de la Cité, en tant que lieu soumis à la programmation d’événements culturels, appartenait bien malgré elle à cette sphère séparée. Car si plaisante et agréable soit-elle, elle n’en restait pas moins un lieu public soustrait à la possibilité de l’usage. Aujourd’hui, avec les amis, « on va à la Cité » quand on en a envie, on prend les chaises à l’intérieur pour s’installer dehors, on fait la sieste sur l’estrade et parfois on y va même avec son pyjama. Lors du concert qui a eu lieu vendredi, un long et large étendard flottait au centre de la salle. Y était inscrit : « Demain s’ouvre au pied de biche ». Il faut prendre cet énoncé comme une invitation à profaner. Car les moments de joie partagés en cet espace ne peuvent que nous rappeler ce graphe posé à Rennes pendant le mouvement, et qui, inspiré, annonçait : « on n’entre pas dans un monde meilleur sans effraction ». On comprendra alors tout l’intérêt des gestes profanateurs en tant qu’ils permettent de redonner au sacralisé les horizons dont il avait été privé.
Tout ce que touche le capitalisme, et donc l’État, devient parfaitement intouchable : la muséification du monde semble être son point final. Tout, aujourd’hui, revêt une dimension sacrée – est soustrait à la possibilité de l’usage. Dans nos vies quotidiennes, les exemples pullulent : « ne déplace pas cette chaise de la bibliothèque municipale, elle est réservée à la consultation d’ouvrages anciens », « je suis désolé mais vous ne pouvez pas jouer avec vos skateboards ici, c’est un espace réservé à la vie piétonne », « ce rond-point n’est pas un jardin monsieur ». On rencontrera de tel pape partout où le sacrifice a lieu : les banques, les mairies et la majorité des lieux publics. Avec la prise de la Cité, nous avons assisté à un acte de profanation tout à fait exemplaire, la profanation étant à comprendre comme la restitution à l’usage commun de ce qui avait été séparé dans la sphère du sacré. La salle de la Cité, en tant que lieu soumis à la programmation d’événements culturels, appartenait bien malgré elle à cette sphère séparée. Car si plaisante et agréable soit-elle, elle n’en restait pas moins un lieu public soustrait à la possibilité de l’usage. Aujourd’hui, avec les amis, « on va à la Cité » quand on en a envie, on prend les chaises à l’intérieur pour s’installer dehors, on fait la sieste sur l’estrade et parfois on y va même avec son pyjama. Lors du concert qui a eu lieu vendredi, un long et large étendard flottait au centre de la salle. Y était inscrit : « Demain s’ouvre au pied de biche ». Il faut prendre cet énoncé comme une invitation à profaner. Car les moments de joie partagés en cet espace ne peuvent que nous rappeler ce graphe posé à Rennes pendant le mouvement, et qui, inspiré, annonçait : « on n’entre pas dans un monde meilleur sans effraction ». On comprendra alors tout l’intérêt des gestes profanateurs en tant qu’ils permettent de redonner au sacralisé les horizons dont il avait été privé.
Mort au public. Vive le commun
Cette profanation aura eu, sur quelques-uns d’entre nous, d’étranges effets. Elle nous aura d’abord (ré)appris à faire l’expérience concrète du commun – et de son irréductible écart à la chose publique. De cet écart, la théorie n’a pourtant cessé, ces dernières années, de nous dispenser la leçon. Nous le savions : restituer au commun ce qui en avait été soustrait par l’autorité publique, c’est rétrocéder à ceux qui en font usage la capacité concrète de s’impliquer et de se transformer dans ce commun. C’est, par exemple, leur rendre la capacité de décider ensemble, sans titre ni compétence particulière pour le faire, de ce qu’ils veulent faire de cette salle, de l’heure à laquelle ils désirent la fermer pour laisser ses occupants y dormir, de la manière dont ils souhaitent y organiser les tâches nécessaires à la préservation du lieu, des « règles de sécurité » qu’ils veulent ou ne veulent pas y instaurer, etc. C’est aussi rendre à chacun l’occasion de se tenir à hauteur de ces décisions – pour soi et avec les autres. C’est, en bref, révoquer le grand partage des compétents et des incompétents pour restituer à chacun la possibilité de se redécouvrir dans l’égalité concrète des êtres.
Tout cela, nous le savions déjà. Et pourtant. Quelque chose s’est découvert dans cette expérience qu’on avait pas encore lu dans les livres. La joie de déserter ensemble des règles et des habitudes édictées par d’autres. Et, dans la débâcle qui s’en est suivi – quoi faire ? comment le faire ? pourquoi le faire ? avec qui le faire ? etc. – la stupéfaction de pouvoir encore nous surprendre. La profanation de la Maison du Peuple aura ainsi eu des vertus imprévues. Elle nous aura, bizarrement, désappris à voir et à parler. Et, nous laissant étonnés d’être encore là sans y avoir rien compris, nous aura simultanément délivré de cette insupportable certitude : que nous aurions à savoir ou à comprendre le réel pour nous y élancer. Le 1er mai restera, pour beaucoup d’entre nous, le souvenir confus d’un joyeux vertige. Et, par ce vertige, une leçon d’organisation politique.
Des vertus du désordre
Le quotidien nous conduit parfois à accepter l’inacceptable : que l’action politique doive, par une sorte de bizarre nécessité, se soumettre aux formes macabres de la transparence, de l’anticipation, de la planification et de la distribution sinistre des petites responsabilités. Il aurait ainsi dû en être de la profanation de la salle de la Cité comme il en va usuellement à l’usine, au bureau, à l’université ou à Pôle emploi : d’un espace lisse continument quadrillé par la certitude de savoir quoi y faire, comment le faire, et avec qui le faire – d’un espace lisse soumis à l’ordre assurantiel. Or de ce qui a été fait entre dimanche et mercredi à la Maison du Peuple, rien n’était anticipable, planifiable ou attribuable à quiconque. L’initiative de l’occupation a trouvé son origine dans la fertilité propre aux joyeux bordels. Après le défilé du 1er mai, quelques centaines de manifestants décidèrent d’investir le Gaumont – pour dire « nique ta mère » au grand-oncle Seydoux, mais aussi (un peu) pour profiter de ses terrasses et y tester la qualité des confiseries. Dans l’AG qui s’y improvisa, quelqu’un lança : « au fait, il y a une intersyndicale à la salle de la Cité ». La réponse fut vite trouvée : « ben faut la prendre, maintenant ! » L’énoncé eu quelque chose d’une évidence. De celles dont on se demande comment on a fait pour ne pas y penser avant. De celles, aussi, qui convertissent instantanément l’être-là-ensemble-sans-savoir-trop-quoi-en-faire en une incroyable puissance collective – ou encore : de celles qui ne peuvent opérer qu’en s’adressant précisément à un être-là-ensemble-sans-savoir-trop-quoi-en-faire. Ce qui, pour la plupart d’entre nous, n’avait même pas pris jusqu’ici la simple forme de l’idée, était en train de mettre nos corps en mouvement. La foule ne tarda donc pas à se rassembler en cortège et prit le chemin de la salle de la Cité. Arrivée au parlement, la flicaille tenta de s’interposer. Mais la flicaille est lente, et la foule légère. La foule accéléra donc le pas. Certains, qui avaient testé moins de confiseries que les autres, trouvèrent même la force de courir. Le cortège se transforma ainsi en une horde rapide, continue. Non pas une masse menaçante. Mais une comète invisible traversant le centre historique comme une vague imprenable. CRS, BAC-eux, et autres sadiques en peine de vilenies constatèrent leur retard. C’est là, peut-être, la puissance des hordes : tracer dans le présent des lignes passionnelles imperceptibles par le pouvoir. C’est donc le cœur léger, au son de « c’est nous les casseurs, vous voyez qu’on fait pas peur », qu’un joyeux fatras de manifestants investit la place Saint-Anne, sous les rires étonnés et bienveillants des badauds attablés aux crêperies.
Parvenue devant la salle de la Cité, cette joyeuse troupe fit face à deux techniciens barricadés derrière les barreaux d’une fenêtre. Elle parlementa d’abord pour obtenir l’ouverture des portes. Puis les CRS arrivèrent à leur tour sur la place Saint-Anne – qui eut l’intelligence sobre de les huer. Inquiétée par l’ennemi, la horde troqua, pour sa propre sécurité, la parole contre le geste : elle attrapa de vieilles planches qu’elle convertit en pieds de biche. Quelques tentatives d’effraction plus tard, les agents de sécurité esseulés, désormais gardiens du devenir de cette foule, durent faire un choix : ouvrir pour stopper le saccage de leur porte (et faire taire l’horreur possible) ou ne rien faire et rester identique à soi – un soi désormais menacé par la culpabilité. La spéculation peut (ou pas) nous permettre d’approcher ce qui s’est passé, à cet instant, dans la tête de ces deux là : au milieu du chaos, une nécessité à prendre parti, à se positionner. Car se débrouiller dans le chaos, c’est toujours rejeter et sélectionner, dans l’instant, des options possibles. L’imposition du désordre est, pour celui qui le subit, un problème posé à soi, auquel il s’agit de trouver une solution. Eux ont choisi d’ouvrir les portes. Prendront part à la révolution ceux à qui de tels problèmes seront posés – c’est à dire imposés : créer des situations d’urgence, forcer les autres à quitter le scepticisme dans lequel ils sont traditionnellement englués. Nous n’avons pas besoin du peuple pour atteindre au désordre des perceptions. Que des hordes l’imposent ici ou là et les autres devront bien se situer vis-à-vis d’une certaine ligne de partage – se situer voulant dire ici : devenir l’ami ou l’ennemi de quelque chose par la force de cette chose. Il en va de même pour le mec de la sécu que pour la mairie de Rennes. Ce graphe que l’on retrouve un peu partout depuis le début du mouvement et qui déforme le patronyme de la mairesse pour se dire sous la forme d’un « Nathalie Apeurée » est, en ce sens, prophétique. Nathalie Apeurée, c’est le mec de la sécu qui, dans le chaos qui lui a été imposé, a dû concéder pour au moins 7 jours la salle de la Cité. Conclusion de cette séquence : c’est par la formation de hordes que nous éviterons cette activité chronophage qu’est l’attente d’un peuple.
La grâce des grands nombres
Le dimanche soir, certains de ceux qui avaient momentanément composés cette horde étaient déjà partis, quand des centaines d’autres – dont personne ne sait au juste d’où ils venaient – arrivaient en masse. Mardi matin, quelques-uns parmi nous qui n’avions pu dormir sur place recevaient, peu avant dix heures, un message : les flics étaient en train d’encercler la Maison du Peuple pour – croyait-on – procéder à son évacuation. Dix minutes plus tard, nous étions quelques dizaines devant la Maison du Peuple, barricadée. À 11h, des centaines d’autres arrivaient par la place Saint-Anne, en forçant les gendarmes mobiles à une étrange opération tactique, consistant à entasser encore plus de corps devant la Maison du Peuple – et à en rendre ainsi l’évacuation encore plus improbable. La destinée de la situation fut dès lors rendue au charme anonyme des grands nombres. Quelques-uns prirent l’initiative d’aller chercher de quoi nourrir la centaine de personnes barricadées depuis la veille dans l’enceinte de la salle. D’autres s’occupèrent de les ravitailler en eau, en clopes et autres produits de première nécessité. D’autres encore s’occupèrent de sonoriser l’attente. Certains allèrent même jusqu’à improviser une bataille navale – par mégaphone – entre les occupants retranchés sur les toits et les soutiens rassemblés en bas. De ce grand désordre d’initiatives – dont personne, sans doute, n’est aujourd’hui capable de restituer entièrement le détail – s’éleva une habileté anonyme et inattendue, excédant de loin la somme de nos habiletés individuelles. Une habileté que toute organisation (trop) formalisée se prive d’atteindre. Et pour cause : cette habileté-ci tire sa force du désœuvrement auquel l’absence de tâche collectivement assignée nous livre, et de l’étonnement qui frappe chacun d’y être encore – et peut-être même plus que jamais – capable de quelque chose. Mieux encore : cette habileté-ci nous parvient de l’indétermination que la situation, soustraite aux habituels plans tracés pour en contrôler les possibles, inscrit dans le réel – invitant chacun à s’y risquer.
Embrasser la nuit et l’incandescence de ses possibles
La salle de la Cité est depuis devenue le lieu de rassemblements quotidiens. Chaque jour, des centaines de précaires, de chômeurs, d’étudiants, de travailleurs et de syndicalistes s’y rencontrent et s’y organisent – on y a même vu passer quelques élus locaux publiquement positionnés contre l’évacuation ! La profanation de la salle de la Cité a ainsi produit une situation si inhabituelle que personne ne peut savoir exactement ce qui en sortira. Sans doute la plupart de ces âmes ne sont-elles d’ailleurs pas d’accord sur tout. Nous n’en savons rien. Et ne voulons pas le savoir. Il importe plutôt que, dans le silence de ces désaccords et les interstices qu’ouvre l’intelligence de ne pas toujours chercher à les objectiver, effleurent des possibilités nouvelles – dont personne ne peut présager. Se retenir de vérifier sans cesse, par des mots trop étroits et des discussions trop formelles, la compossibilité de nos désirs et de nos perceptions ; livrer à l’opacité des situations, des initiatives et des rencontres la destinée de notre commun : voilà peut-être une manière de laisser les mondes venir à nous – et de nous y retrouvés débordés. L’inconnu (le « ne-pas-savoir ») est, pour beaucoup de nos contemporains, la source d’une terrible angoisse, dont notre civilisation ne sait plus quoi inventer de dispositifs et de dispositions pour la conjurer : crédit, plan de carrière, liste de courses, etc. Peut-être l’acte de profanation tire-t-il sa force de la capacité qu’il manifeste à convertir cette indétermination en une puissance commune : ce sentiment incandescent que, dans la nuit de ce non-savoir, quelque chose peut encore arriver – quelque part entre nous. Aujourd’hui, par les rencontres qui s’y font, les rires qui y résonnent et les amours qui s’y nouent, la Maison du Peuple ne cesse de multiplier la possibilité d’un joyeux départ de l’être, pour tout ceux qui veulent bien y passer, y rester, y dormir.
Appel de la Maison du Peuple Occupée au Monde Entier ! Occuper devient vital !
C’est le premier mai dernier à Rennes que l’occupation de la Maison du Peuple à commencé. Ce jour là, le cortège a envahi le Gaumont pour une assemblée. C’est là que la décision fût prise de rejoindre l’intersyndicale qui devait se tenir à la salle de la Cité (Maison du Peuple).
Pendant que le cortège s’y rendait avec une partie des syndicalistes (Sud Solidaires, SLB, CNT), le préfet paniqué demanda à l’intersyndicale de s’enfuir et d’annuler son assemblée. C’est de manière surprenante que nous avons pu atteindre le bâtiment, face à une police désorganisée. La menace de forcer les portes suffit à nous y faire entrer. Les syndicats ont été appelé à revenir. Victoire, l’occupation était lancée.
Mardi, la maison du peuple fût assiégée pendant près de 6 heures, barricades, présence sur les toits et dans la rue, banderoles de soutien déployées par les voisins, divers syndicats appelant à soutenir. Nous étions déterminés à nous défendre et à rester. En parralèle le conseil municipal fût chahuté pour rappeler à la Maire de Rennes sa responsabilité dans les violences policières des derniers mois.
Depuis nous avons obtenu un bail de sept jours, pile le temps de s’organiser pour la suite, de faire consister quelque chose dans ces lieux. Si nous convenons que l’occupation de la Maison du Peuple à Rennes a été rendue possible par un concours de circonstance pratique, nous devons cette victoire surtout pour une grande part à la conflictualité assumée largement dans les rues depuis deux mois, contre les volontés politiques d’étouffer le mouvement sous une pression policière, contre la volonté du préfet de nous interdire le centre ville.
Il était clair qu’il nous fallait un lieu pour le mouvement, un endroit duquel partir pour que toutes les forces politiques, que tout ceux qui prennent part à la lutte puissent se trouver en dehors des secteurs et des catégories : étudiants, lycéens, chômeurs, travailleurs, enfant des foyers, mère, fils, etc…
Dans cet endroit nous constituons une force, multiple, capable de prolonger la lutte engagée depuis deux mois et de maintenir le rapport de force.
Cela se matérialise dans l’organisation de blocage économique, d’action, de manifestations, de perturbations, de grèves…
Nous avons trouvé en cette occupation la possibilité de se rencontrer en dehors des rendez-vous des manifestations et des AG. Une vie commence a s’y installer. 50 à 100 personnes y dorment chaque soir, des textes y sont rédigés, une radio pirate a été mise en place, le ravitaillement quotidien s’organise, une cuisine collective se monte, les Ags du mouvement et des débats s’y tiennent. Ensemble nous apprenons à faire nous même, à nous organiser en dehors des rapports économiques existants.
Le mouvement a besoin de tels lieux, il a besoin de ce type de victoire : celle d’arracher des espaces comme il a fallu arracher la rue à chaque manifestation.
Pour que ce qui se passe à Rennes ne reste pas circonscrit à une exception locale, pour que le mouvement s’épaississe, pour que les différentes forces puissent se rejoindre, nous invitons à répéter notre geste, à ce que naissent des occupations partout où les conditions sont réunies.
Nous appelons à ce que les forces qui ont pris la rue, les facs, les lycées, les lieux de travails, les places lancent des occupations communes là où ils se trouvent.
A Rennes cela fait deux mois que l’on nous confisque le centre ville, nous n’avons rien lâché, et nous avons réussi à nous y installer, nous faisons désormais partis de son paysage et on ne peut plus nous rater.
Nous avons vitalement besoin d’espaces.
Vive la Commune, Vive la grêve, Vive l’Occupation !
Des squats en France https://radar.squat.net/fr/groups/country/FR/squated/squat
Des groupes (centres sociaux, collectifs, squats) en France https://radar.squat.net/fr/groups/country/FR
Des événements en France https://radar.squat.net/fr/events/country/FR
Lundi Matin #60, le 9 mai 2016. Crédits photos : Gaspard Glanz & Vincent Feuray https://lundi.am/Rennes-occupation-de-la-Maison-du-Peuple