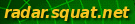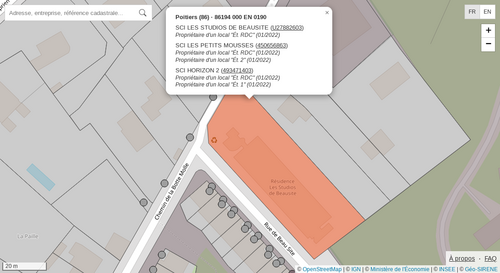L’interview ci-dessous a été utilisée (et publiée en annexe) pour le mémoire de maîtrise de Sébastien Schifres « La mouvance autonome en France de 1976 à 1984 » (Université Paris X, Nanterre, Histoire contemporaine et socilogie politique, 2004).
Le mémoire en question est disponible en intégralité sur http://sebastien.schifres.free.fr/
—–
ENTRETIEN AVEC BRUNO
(pseudonyme, 16/04/2002)
Bruno est arrivé dans la mouvance autonome fin 1978, au moment où celle-ci va s’écrouler. Il est alors âgé de 14 ans et vit chez ses parents en banlieue parisienne. Son père est lui-même un communiste d’extrême gauche. Bruno, lui, se définit à ce moment là comme un autonome inorganisé. Bruno est donc bien représentatif de cette seconde génération d’autonomes, celle des années 80. Il participe activement en mai 1980 à l’organisation des émeutes qui se déroulent autour de l’université de Jussieu. Il est aussi présent à Chooz, dans les Ardennes, en 1982. Son témoignage est particulièrement intéressant pour sa description du mode vie des squatters du 20e arrondissement de Paris.
BRUNO : Dans la fin des années 70, il y a une politisation générale. Dans tous les lycées, il y a des comités de lutte, il y a des grèves, tout le temps : même les gens qui ne veulent pas s’impliquer se retrouvent impliqués là-dedans. Il y a un niveau de politisation bien plus fort que maintenant. Quand je suis arrivé au lycée, quinze jours après, c’était la grève : on se mettait pas en grève pour des gommes et des crayons.
Est-ce que c’est le fait que tous les lycéens se mettent en grève et que tu suis les autres qui t’as poussé à faire de la politique ?
BRUNO : Moi, c’est particulier, j’ai toujours fait de la politique, même quand j’avais huit ans.
Est-ce que c’est lié à tes parents ?
BRUNO : Ouais, je pense… C’est un truc de l’époque : toute la mystique sur 68 : la barricade, la baston, l’émeute ! Quand j’ai commencé à faire de la politique, j’avais douze-treize ans, c’était aux Jeunesses Communistes.
Pourtant, tu ne l’as pas marqué cela, sur le questionnaire ?
BRUNO : Parce que c’est pas intéressant : j’ai jamais milité, c’est rien. Pour moi, au départ, c’est un truc de purs fantasmes. C’est surtout l’incohérence des autres : il y avait le même discours révolutionnaire de partout : « flics-salauds, CRS-SS… » On parle de révolution et quand les flics sont là, on s’assoit par terre ! C’est incohérent, c’est absurde : « CRS-SS », on fout la main dans la gueule, c’est plus logique, non ? A l’époque, il y avait une ébullition : comme par exemple le FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) : des gens comme ça étaient très drôles : c’était un truc de la mouvance autonome, c’était pas un truc de gauchistes !
Pourtant, Daniel Guérin était membre du FHAR…
BRUNO : De toute façon, moi j’étais jeune : on allait dans les trucs, on cherchait pas à comprendre. Dans la baston, ils faisaient des trucs rigolos : ils chargeaient des flics avec des confettis, avec des casques et des cagoules. Il y avait des manifs tout le temps : je faisais une baston par semaine : affrontements avec les flics toutes les semaines. Quand j’étais môme, c’était mon activité : tous les mercredis, tous les samedis.
Est-ce que tu as participé à la manifestation du 23 mars 1979 ?
BRUNO : Oui et non. Le 23 mars, on s’était mis en grève avec le lycée, on était parti en cortège à la manif du lycée. On était parti à pas nombreux : à 70, avec les copains du lycée : les Jeunesses Communistes, même les mecs de LO… Tout le monde était parti pour aller à la baston : tout le monde allaient rejoindre les rangs des autonomes. Les mecs de ma cité, c’était des blousons noirs, ils y sont allés. Tout le monde y est allé à cette manif. Et nous, on arrive avec notre drapeau noir, comme des imbéciles : on a fait 50 mètres, on s’est fait lynché par le Service d’Ordre, par les dockers : on s’est fait éclater la gueule direct par le SO de la CGT : on est rentré chez papa et maman… Ils voyaient un drapeau noir, ils t’éclataient la gueule. De toute façon, on s’est plus battu avec le PC ou l’OCI qu’avec les flics. Est-ce que ton père était membre du PCF ?
BRUNO : Non.
A quelle organisation appartenait-il ?
BRUNO : Il était rien… syndicaliste-gauchiste…
Lorsque tu es arrivé dans la mouvance, est-ce que les Assemblées Générales des Groupes Autonomes se tenaient encore à l’université de Jussieu ?
BRUNO : En 79, nous, le groupe qu’on était, c’était le groupe des habitués de manifs : on était des mômes et on allait à toutes les manifs : on se connaissait pas, on venait de partout : trois-quatre copains, des fois cinq-six, des fois dix, et on retrouvait plein de gens comme nous : assez jeunes, des lycéens ou zonards, ou lycéens et zonards, des collectifs de mineurs en lutte, des mineurs-fugueurs qui occupaient à l’époque des salles à la fac de Vincennes pour dormir… On se retrouvait sans se connaître : à la fin, on se connaissait très bien de vue, on avait des surnoms, mais on se connaissait pas. Et on était 100-200 personnes comme ça : les inorganisés, c’était nous. On était des gamins : notre spécialité, c’était le pillage de boulangeries : on rentrait dans une boulangerie, on jetait les gâteaux. Des fois, on cassait la vitrine d’abord, ce qui faisait que les gâteaux étaient pleins de bouts de verre, c’était pas très malin… Les autres autonomes nous appelaient les pilleurs de boulangerie. On était des fous furieux. Mais, pour nous, on faisait la révolution : des mômes assez barjots : des cocktails Molotov, des petits explosifs qu’on jetait sur les fins de manif… On faisait la révolution, on était prêts à mourir : des vrais barjots… assez inconscients… Moi, tout le temps quand j’allais dans les manifs, je partais à la manif avec un sac de barres avec trente barres de fer, ou avec dix casques. Il y avait plein de gens qui faisaient comme ça. Il y avait toujours cinq ou six personnes qui ramenaient du matos comme ça : ils distribuaient et puis ça y allait. Mais des fois, dans les manifs il ne se passait rien : on y allait pour n’importe quelle manif. Mais je pense qu’on était vraiment dangereux : c’est bizarre qu’il n’y ait pas eu plus de blessés !
Que se passe-t-il autour de l’université de Jussieu en 1980 ? Est-ce qu’il y a un mouvement étudiant ?
BRUNO : Oui, il y a un mouvement étudiant mais nous on est pas tellement au courant du mouvement étudiant. On est tout le temps dans toutes les manifs : à l’époque dans Libération il y a la rubrique Agitprop où il y a la liste de toutes les manifs : on regarde dans Libération et on sait pour quelle manif on va tous se retrouver là : on nous dit, il y a un rendez-vous à Jussieu à 18H00, on y va. On est 50-70. Il y a des autonomes-des vrais (parce que nous on est des faux), c’est à dire des gens de Camarades… Il y avait des espèces de regroupements de collectifs qui étaient concurrents et qui pouvaient pas se sentir… Il y avait ce que nous on appelait l’autonomie organisée autour de Camarades qui était plus Marxiste-Léniniste, il y avait l’autonomie désirante qui changeait de nom tout le temps mais qui s’appelait à l’époque « Eventail contingent » : une espèce de revue de compilation… C’était des espèces de coordinations autonomes mais il n’y avait pas UNE coordination autonome, il y en avait deux ou trois, par tendance. C’était encore plus compliqué que ça parce qu’il y avait des magouilles internes entre les différents collectifs. Il y avait deux ou trois tendances de l’autonomie. L’autonomie organisée (pour le parti, autour de Camarades), l’autonomie désirante (plus spontanéiste)…
Est-ce que ces gens sont déjà des squatters à cette époque-là ?
BRUNO : J’en sais rien. On avait des relations avec les gens où tu les vois que pour faire des trucs précis : tu sais pas qui c’est, tu sais pas ce qu’ils font, ça te regarde pas. Enfin, avec notre mode de fonctionnement à nous : nous, les mômes, on fonctionnait comme ça. Je pense que des gens un peu plus sérieux ne fonctionnaient pas comme ça. Nous, on était pas sérieux. On s’en foutait de tout : baston, baston… Mais même nous on fonctionnait avec des coordinations éphémères comme ça : trouver des modes de fonctionnement qui font que les gens se coordonnent, qu’on va avoir les capacités à faire des choses mais on cherchait pas d’accords politiques : on cherchait les accords pratiques. Il n’y avait pas d’accords politiques où on va discuter de ceci, de ça… C’était une optique assez militariste : pas militaire du tout, mais centrée sur l’efficacité des actes.
A propos de militarisme, comment étaient perçus les attentats d’Action Directe par cette mouvance ?
BRUNO : Jusqu’en 1981, il y avait entre 300 et 400 attentats par an en France : tout le monde faisait des attentats.
Est-ce que cela passait inaperçu ?
BRUNO : Non : Action Directe, c’était un groupe autonome parmi d’autres, qui était le plus militariste. Il y avait des critiques du militarisme mais nous on parlait pas de ça : le débat c’était les Brigades Rouges. Il y avait là réellement une grosse organisation. Tout le monde faisait des attentats. Le point de vue justement du mouvement autonome, c’était la propagande par le fait et la guérilla diffuse. Action Directe était dans la logique de la guérilla diffuse. D’ailleurs AD se disait n’être qu’un sigle que tout le monde pouvait reprendre : ce n’était pas une organisation qui se disait avant-gardiste. Ils ne se sont jamais présentés comme ça…avant 1982. Mais tout le monde faisait des attentats. Sinon, t’étais pas un autonome. Etre autonome, c’était aller foutre un cocktail Molotov dans l’agence intérim du coin, ou l’agence immobilière… Ca voulait dire ça. Ou n’importe quoi : au lycée, être autonome, c’est faire du sabotage, bloquer les serrures… Il y a vraiment la culture du sabotage. C’était la grosse différence entre les autonomes et les autres. C’était un truc très axé sur la violence, sur la fin. Avant non, puisque je me rappelle des premières manifs que j’ai vu fin 78-début 79 : il y avait le mouvement autonome antinucléaire qui n’était pas forcément violent, le mouvement autonome féministe, le mouvement autonome homosexuel, un mouvement autonome dont les critères n’étaient pas la violence. Après, autonome ça voulait dire violent. Après c’est devenu comme ça.
Les gens plus âgés que j’ai interrogé m’ont dit : « Après le 23 mars 1979, l’Autonomie c’est fini, il n’y a plus rien, c’est la répression, ça s’arrête là. » Ce qui est intéressant en ce qui te concerne, c’est que tu arrives à ce moment-là…
BRUNO : Oui, j’ai bien conscience d’avoir vécu la fin, quand ça s’écroulait : c’était plus un mouvement. Il y avait des groupuscules autonomes, une pratique qui survivait : même pas une pratique : une espèce de culture. Une culture de la violence systématique. Et ce n’est pas une critique : je pense que la violence systématique est plutôt une bonne chose. Ca sert à rien de défiler dans la rue. En plus, ce n’est pas de la violence systématique : c’est cette non-croyance en la démocratie. C’était évident qu’être autonome c’était aussi ne pas croire en la démocratie, ne pas croire que le fait de défiler dans la rue et de dire « Non, non, non ! » ça va changer quoi que ce soit. Parce que l’Etat n’est pas là pour dire : « Ah, ils sont mécontents, on va leur donner ce qu’ils veulent. » C’est un rapport de forces. Mais ça je pense que c’était un truc assez clair pour tout le monde, même pour les gauchistes. C’est pour ça qu’ils étaient pas conséquents. La violence, c’était une évidence. Ca l’est toujours d’ailleurs. Il n’y a rien d’autre en dehors du rapport de forces. Les actions non-violentes étaient des choix tactiques assez rares. Et la forme de non-violence qu’on avait à l’époque c’était quelque chose qui aujourd’hui ne passerait peut-être pas pour de la non-violence : c’était des sabotages cools ou des manifs non-violentes comme celles du FHAR où on était avec des casques et des cagoules et où on chargeait les flics en leur jetant des confettis dans la gueule… ce qui leur faisait dix fois plus peur ! D’ailleurs, ils ont reflué, ils ont vraiment paniqué ! Mais c’était encore la fin des années 70 : nous on avait pas compris ça mais c’est-à-dire que les gens quand ils faisaient de la politique, ils avaient une volonté de faire la révolution : tu faisais pas de la politique pour montrer des désaccords ou quoi que ce soit, on était encore dans une logique révolutionnaire. Moi, je pensais que je faisais la révolution. Je pense que les gens, tout ce qu’ils faisaient, et même les gauchistes, même le PC, même le mec de base du PC, ils pensaient qu’ils allaient faire la révolution.
Que c’était proche ?
BRUNO : Pas forcément que c’était immédiatement proche mais qu’en tout cas, à moyen terme, il y avait des possibilités de renverser le système, de changer le système.
A cette époque-là, est-ce que tu pensais que tu allais vivre la révolution ?
BRUNO : J’en étais sûr et certain ! C’est même pas que je pensais que j’allais la vivre, je pensais que je la faisais ! C’est pour ça en plus : avec le recul, c’est un truc assez difficile à comprendre…
Pourtant, aujourd’hui, c’est quelque chose de totalement incompréhensible !
BRUNO : Mais c’est la fin des années 70 ! Il y avait des grèves ouvrières, la marche des sidérurgistes : les sidérurgistes, tous les jours ils tiraient sur les flics avec des armes à feu ! Ils avaient incendié les locaux de la CGT, ils étaient des dizaines de milliers ! Il y avait des luttes antinucléaires à Plogoff… Je sais pas, on était peut-être à côté de la plaque… Mais c’était encore l’après-68, c’est-à-dire la fin de l’après-68… T’avais un journal comme Libération : c’était un journal révolutionnaire… jusqu’en 79…
Pourtant, il y a une rupture assez claire quand les autonomes occupent le siège de Libération en 1977…
BRUNO : Quand les autonomes occupent Libé en 77, ils occupent Libé parce que c’est le journal du mouvement, parce que c’est le journal de l’Agence de presse Libération, qui est écrit par ses lecteurs, par des gens en lutte partout en France : c’est des ouvriers en lutte qui écrivent les articles…
Justement, la réponse de la direction de Libération est assez claire : ils s’étonnent qu’il y ait encore des gauchistes !
BRUNO : Oui mais Libé, c’est le journal révolutionnaire quotidien dans les kiosques ! Il y a des comités de lutte… Moi, j’arrive au lycée, il y a un comité de lutte, des panneaux d’affichage où l’administration n’a pas le droit de toucher aux affiches que tu mets parce que c’est ton droit et que tu mets ce que tu veux, t’affiches ce que tu veux… La manif du 23 mars, c’est des dizaines de milliers de personnes qui mettent Paris à feu et à sang, les sidérurgistes et les autonomes coude à coude, c’est l’attaque du siège du PC, de l’Humanité, des barricades de dix heures du matin jusqu’à quatre heures du matin le lendemain… Et puis il y a aussi cette logique individuelle quand tu rentres pour faire de la politique et que tu te dis révolutionnaire, ben tu te dis révolutionnaire ! C’est-à-dire que tu rentres dans une logique où tu sais que l’emploi des armes va être inévitable et incontournable. Si t’es révolutionnaire, tu penses ou tu dis : « Moi je vais finir en taule ou mort ou je vais gagner »… Mais même le connard qui rentrait dans un groupe trotskiste, je pense qu’il avait ça dans le crâne. C’était une évidence : la révolution, ça se fait comme ça. A la Ligue, il y avait encore l’entraînement paramilitaire, ils avaient des pseudos, des caches d’armes… Et même au PC, je pense qu’ils avaient encore des armes. C’est pour ça, en 80 à Jussieu, la première action qu’on fait, nous (nous, c’est-à-dire le groupe des inorganisés), on a rendez-vous tous les soirs à 18H00, notre but est clair : notre but c’est que les flics rentrent sur le parvis. On veut que les flics rentrent sur le parvis de la fac parce que s’ils rentrent sur le parvis de la fac, c’est la grève générale étudiante. Parce que c’est encore ça la culture à l’époque : les flics, s’ils rentrent sur un parvis de fac, il y a la grève générale. Donc on se donne rendez-vous sur le parvis et on va cramer une banque en face. Et on se retranche dans la fac, et on attend les flics. Le lendemain, on y va, et on pille… je sais pas, pareil : on pète les vitrines dans le quartier, on crame le truc et on se replie sur la fac où on a barricadé et où on a préparé du matériel pour accueillir les flics. Comme ça : et au bout d’une semaine, les flics, ils rentrent : et il y a un copain qui meurt. Et ça nous semble logique. Nous, ça nous a pas effrayé, on y était psychologiquement préparé. On savait… je sais pas… c’est bizarre d’ailleurs… la première action que nous on a fait, on a laissé un pote sur le carreau… mais ça nous a pas ému plus que ça… puisqu’on pensait qu’on faisait la révolution et que certainement la moitié d’entre nous allaient y rester… Moi je sais pas, j’avais 16 ans à l’époque. J’avais 16 ans et j’étais pas le plus vieux. Dans le groupe, sur 70 qu’on était, on a eu trois arrestations : deux de 14 ans, un de 13 ans : les plus jeunes, la moyenne c’était 16 ans. Et on savait tous faire des explosifs… qui marchaient la moitié du temps, qui marchaient rarement. On bricolait tous ça parce que c’était la logique du truc : tu te disais pas révolutionnaire si tu savais pas faire un cocktail Molotov, si tu savais pas faire des explosifs, si t’es pas capable avec trois copains d’aller faire une action… une action… une action directe. Et encore, moi je pense que notre culture à nous était en dessous de celle qui nous précédait puisque d’après ce que j’ai entendu, il n’y a pas un groupe autonome ou des squats de la période 77-79 où les mecs ne braquaient pas des banques. Ils braquaient tous des banques : le mode de financement habituel de tout le monde. Et nous on était déjà en deçà puisque c’est des trucs qu’on faisait pas. On était môme…
Es-tu sûr de cela ? Est-ce que ce n’est pas un mythe que les plus âgés véhiculaient ?
BRUNO : Non, c’est pas un mythe. Et le 23 mars 79, normalement ce qui était prévu par l’autonomie organisée (sauf qu’il y a eu 200 autonomes qui se sont fait arrêtés le matin), c’est que, parallèlement au cortège, il devait y avoir 40 mecs armés avec des flingues qui devaient suivre le cortège sur les rues parallèles et braquer tous les commerces, absolument tous. C’était ça la logique. Mais jusqu’en 81, il n’y avait pas de séparation entre les autonomes (y compris hyper violents du type AD) et la gauche : il y avait plein de passerelles.
Y compris le PS ?
BRUNO : Y compris le PS. C’était pas des passerelles individuelles mais, par exemple, si t’étais arrêté dans une manif en train de péter une vitrine ou de jeter un cocktail Molotov, t’étais défendu par des avocats du PS. T’avais immédiatement le PS qui demandait ta libération. A l’époque, Mitterrand était pour la fermeture des centrales nucléaires, pour les droits des homosexuels… C’était ça la gauche ! C’est pour ça qu’en 81 il y a eu aussi tout cet effondrement. En 81, ça a été l’effondrement total. Les gens ne sont pas rentrés au PS, mais ils sont rentrés dans la parano, ils sont rentrés dans le rang parce qu’il y avait plein de passerelles : au niveau boulot ou quoi que ce soit, les gens avaient des postes… C’était un truc très très anti-droite : il n’y avait pas eu de gouvernement de gauche depuis le Front Populaire ! Il y avait aussi ça : cette espèce de culture de gauche… même chez les autonomes. Même si c’était très très critique, c’était quand même un truc de gauche. Le pire ennemi c’était le PC. Les seuls gens avec qui on était en guerre, c’était le PC. Mais le PS, ils ont toujours soutenu. Le PS soutenait les autonomes mais pas le contraire. Ils avaient un discours bien plus à gauche que le PC : un discours soixante-huitard.
Ne penses-tu pas que ce discours soixante-huitard était en fait un discours libéral ?
BRUNO : Non, libertaire ! Il y avait aussi toutes ces luttes là : les luttes féministes, homosexuelles, antinucléaires, écologistes… Et le PS était dans toutes ces luttes là.
Quand la gauche arrive au pouvoir, il y a les luttes autour de Chooz dans les Ardennes. Est-ce que tu y as participé ?
BRUNO : J’ai jamais loupé une manif à Chooz ! Pareil, le côté militaro : j’y allais pour la baston. J’ai jamais discuté sérieusement avec les ouvriers de là-bas. J’ai discuté mais jamais sérieusement : j’ai jamais été à aucune réunion… alors qu’il y avait des gens qui avaient des contacts, qui étaient en contact avec…
Comment vous rendiez-vous là-bas ?
BRUNO : Moi j’y allais en bagnole avec l’OCL à partir de Reims. Il y a des gens qui partaient de Paris… Mais c’était quand même des actions de soutien à une lutte ouvrière. C’était pas une expression du mouvement autonome.
Combien étiez-vous de Paris à vous rendre à Chooz tous les mois ?
BRUNO : Une cinquantaine. Il y avait AD (c’est l’époque où ils étaient légaux), les Fossoyeurs du Vieux Monde, des squats du 20e… Mais le gros truc c’était les squatters du 20e.
Pourrais-tu décrire les relations entre les autonomes et les ouvriers ?
BRUNO : On était accueilli à bras ouverts. C’était une vraie émeute, plus que l’émeute, un sentiment insurrectionnel. T’arrives dans une ville qui est insurgée, les gens t’amènent à bouffer… On partait faire des guets-apens aux flics : on partait à trois-quatre squatters (on était plus un petit peu lookés punks) : tu pars avec deux-trois ouvriers, tu prépares des rochers en haut d’une falaise pour jeter sur le camion de flics quand ils passeront… Et puis tu passes ta journée comme ça… A discuter avec les ouvriers mais en discutant de tout, de rien : tu parles pas politique, tu parles de conneries… Et t’es avec des gros beaufs d’ouvriers ! C’est-à-dire, vraiment, moi, j’ai été surpris. Au début ça me choquait, et puis après je trouvais ça plutôt sympathique… Des réflexions la pire que j’ai entendue, c’était : « Ah ! Qu’est-ce qu’on se marre ! Ca me rappelle l’Algérie ! » On était là : on lâchait pas un mot ! Tu vois, c’est quand même assez étonnant !
Quel âge avaient ces ouvriers ?
BRUNO : Quarante-cinquante ans.
Est-ce qu’il y avait des jeunes aussi ?
BRUNO : Il y en avait certainement mais…
Est-ce que l’on peut dire que c’était « l’ouvrier-type » ?
BRUNO : Oui l’ouvrier-type, le sidérurgiste-type : quarante-cinquante ans, chasseur, dans un village pedzouille…
Mais au début, tout de même, est-ce qu’ils ne se sont pas un peu méfiés de voir des jeunes de Paris arriver comme cela ?
BRUNO : Non, c’est eux qui ont lancé l’appel. Au départ, il y avait une lutte antinucléaire. Parce qu’ils construisaient une nouvelle tranche de la centrale nucléaire. Tous les derniers samedis du mois, il y avait un rendez-vous, l’appel des antinucléaires du coin pour aller marcher sur la centrale. Vu qu’ils construisaient la centrale, ils en profitaient pour vider toutes les usines : c’était des phénomènes complètement liés, ils faisaient une zone complètement militarisée. Il y avait des missiles Pershing des deux côtés de la pointe de Givet (côté Belgique) : une zone complètement militaire. La pointe de Givet est le siège des commandos parachutistes. Ils voulaient faire de la région une zone pratiquement interdite, entièrement militarisée : donc ils viraient toutes les usines. Ils viraient aussi les usines dans le cadre d’une restructuration : il y avait plusieurs facteurs. Mais pour les ouvriers, c’était lié : donc, ils étaient dans les trucs antinucléaires. Un jour, on était parti sur une manif antinucléaire : les ouvriers ont bloqué la route et ont occupé l’usine. La lutte des sidérurgistes est alors devenue l’aspect principal avec l’occupation permanente de l’usine et l’affrontement permanent : de toute façon, ils démantelaient l’usine ! C’est exactement les mêmes conflits qu’il y a maintenant à Cellatex (Cellatex, d’ailleurs, c’est dans la pointe de Givet : ce n’est pas un hasard, c’est évidemment la mémoire de Vireux). Dans l’usine, il y avait deux ou trois groupes clandestins de sabotage dont un qui s’appelait « Vireux vivra ». Les mecs arrivaient avec des cagoules et le tee-shirt « Vireux vivra ». L’usine continuait à marcher au ralenti : on ne peut pas arrêter un haut-fourneau. On faisait les barricades avec des bulldozers ou avec les fenwicks (1): les barricades, c’était des lingots d’acier de deux tonnes empilés les uns sur les autres. C’était des barricades qui faisaient 500 tonnes : avec des bouteilles de gaz au milieu, des produits chimiques devant… C’était sérieux, quoi ! On arrivait pour la manif, les sidérurgistes posaient des palettes de cocktail Molotov (qu’ils avaient préparé la veille), des palettes de barres de fer, des palettes de masques à gaz… C’était tout le village ! Sur tout le village, il y avait peut-être trois personnes qui étaient considérées et identifiées comme traîtres. Quand les flics arrivaient, le maire coupait l’éclairage de la commune : tu courais dans la rue, tu rentrais chez n’importe qui, pas de problème : t’es poursuivi par les flics, tu poussais une porte, t’arrivais chez les gens et ils disaient : « Ah ! Tu veux manger ? Tu veux un petit coup à boire ? » La grand-mère sortait sur le pas de la porte pour voir si les flics étaient partis…
Une véritable guerre civile, en quelque sorte ?
BRUNO : Une vraie insurrection, ouais ! Mais pas un moment d’insurrection, une insurrection qui s’instaure. Il y avait la manif du dernier samedi du mois mais le reste du temps, eux, ils faisaient des actions. Ils louaient des cars, ils allaient au siège d’EDF du coin et le détruisaient.
Dans la mouvance autonome parisienne, cette année-là, est-ce que les gens ne font que passer leur temps dans les Ardennes ou est-ce qu’il se passe aussi des choses à Paris ?
BRUNO : Le gros truc c’est les squats du 20e. C’est-à-dire surtout des jeunes (plus punk qu’autre chose : on peut dire tendance punk, mais c’est pas les punks comme maintenant : « J’suis à la mode… », new look… c’était une mentalité à l’époque), des concerts, et des trucs basés entièrement sur la gratuité. Les gens passaient aussi vachement leur temps dans la guéguerre contre « les sales traîtres » des squats alternatifs du 19e : les squats d’artistes. Et c’était des trucs de survie : c’est-à-dire, fallait bouffer tous les jours. Donc, les gens allaient piquer en bande : on allait récupérer des meubles, des chauffages… Il y avait un bar gratuit, des grillades gratuites au moins une fois par semaine… Les gens n’avaient même pas le RMI : il n’y avait pas le RMI, il n’y avait rien à l’époque. Donc, fallait se procurer tout gratos.
Est-ce qu’il n’y avait que des jeunes dans ces squats ?
BRUNO : Il y avait quelques gens plus âgés qui étaient d’ailleurs des vendeurs de journaux à la criée. C’est les premiers collectifs de travailleurs précaires. C’était entre 17 et 35 ans.
Est-ce qu’il y avait aussi bien des garçons que des filles ?
BRUNO : Ah oui ! De toute façon, dans tous les trucs dont je te parle : même le côté militaro qui était un truc hyper machiste, c’était un truc qui était partagé par les filles aussi. Dans tous les groupes, il y a toujours eu moitié fille-moitié mec. En gros, peut-être j’exagère, disons au moins un tiers de filles. Et il n’y a jamais eu de différences. J’ai jamais vu, moi, faire des différences entre les filles et les garçons : dans le sens où tout le monde tapait la virilité. C’était un peu bizarre. En tout cas dans les pratiques politiques, c’était la baston. Les nanas, elles assuraient : elles tapaient, elles sortaient la barre de fer, elles te mettaient un coup sur la tête : poing américain dans la poche… On se tapait, on se tapait tout le temps ! Les pratiques politiques étaient vachement quotidiennistes : aller aux concerts gratuitement, forcer les entrées de concert… C’était pas vraiment des trucs politiques. C’était vraiment des trucs de la vie quotidienne. C’était des trucs qui étaient faits en groupe. Quand on se déplaçait quelque part, on se déplaçait à cinquante, très vite on se retrouvait à cent, on imposait la gratuité, ou il y avait des fachos, des flics, on se tapait, etc.
Est-ce qu’il y avait des enfants dans ces squats ?
BRUNO : Non.
Dans l’entretien que j’ai eu avec Philippe Tersand, celui-ci m’a dit qu’à partir de 1983, dans ce milieu-là, il y avait selon lui aussi bien des gens d’extrême-droite que des anarchistes qui se mélangeaient…
BRUNO : Je comprends pas du tout de quoi il parle.
Philippe Tersand m’a parlé d’un concert à Montreuil où les gens auraient fait le salut nazi et où cela aurait déclenché une bagarre générale…
BRUNO : Ca c’est un truc de mélanges. Jusqu’en 1984, il n’y avait pas de salles de concert à Paris. Les groupes qui voulaient jouer venaient dans les squats.
Est-ce que tu veux dire, pas de salles de concert pour cette culture-là ?
BRUNO : Les squats étaient les seuls endroits où il y avait des concerts. Donc, tous les skins traînaient dans les squats.
Est-ce qu’il y a déjà des redskins (2) à ce moment là ?
BRUNO : Il n’y avait pas DES redskins : il y avait trois, quatre redskins qui lançaient la mode…
Est-ce que « skinhead » signifiait « nazi » à cette époque ?
BRUNO : Non ! C’était vachement plus compliqué que ça ! Skinhead, ça voulait pas dire nazi. Il y avait des redskins mais c’était ultra minoritaire. Le premier groupe redskin dont j’ai entendu parler, c’était en 82. Mais je parle au niveau mondial. Dans cette période là, les mouvements autonomes et punks sont complètement imbriqués.
Le terme de « punk » signifiait-il que tout le monde était coiffé avec une crête de cheveux sur la tête ?
BRUNO : Ca voulait aussi dire tout le monde avec une crête. Mais les gens qui étaient complètement punks n’étaient pas non plus dans ce milieu politique. Mais tous les gens qui étaient squatters, autonomes, étaient un petit peu punk. C’était deux trucs qui allaient de pair mais c’était pas une mode comme maintenant : c’était pas un uniforme, tu pouvais être punk et être habillé comme tout le monde. Et donc, dans ces trucs là, il y avait effectivement des fachos mais ce n’est pas vrai que ça ne se passait pas bien.
Philippe Tersand dit justement : « C’était politiquement pas clair ».
BRUNO : C’est sûr que c’était politiquement pas clair. Il suffit d’écouter le groupe skin La Souris Déglinguée… Le mouvement facho a commencé avec les skins du forum des Halles. A un moment, ils étaient liés à la FANE (Faisceaux d’Action Nationaliste Européens, des nazis). En même temps, c’était relativement complexe puisque dans ces gens là, qui étaient des banlieusards qui traînaient au forum des Halles, qui étaient en skinheads (c’était les débuts de la mode skin), il y avait de tout : des Noirs, des Arabes, des Juifs, de tout ! Et c’était eux les nazis ! C’était eux les skins fachos !
Comment peut-on être Noir et nazi ?
BRUNO : Justement, c’est ça qui était complètement confus ! Le plus connu des skins fachos qui était un peu leur chefaillon, c’était un rebeu (4), un mec de Colombes !
Est-ce que tu parles de Serge Ayoub (3) ?
BRUNO : Non, Serge Ayoub, il n’a jamais traîné dans ces trucs là, c’est un politique. Et justement, le mouvement autonome n’était pas politique ! C’était pas un mouvement politique du tout ! Mais ce n’est pas un mouvement social non plus ! C’est un mouvement presque culturel… je sais même pas comment définir ça : c’était un mode de vie, presque. Mais les skins fachos, c’était moitié de la provoc, et puis ils étaient payés pour faire ça : c’était des zonards. C’était un milieu vraiment très très zonard, très pauvre, très prolo. Et les fachos payaient les gens pour militer : donc, les gens y allaient !
Je ne te crois pas ! Il ne pouvait pas y avoir de Noirs dans les Faisceaux d’Action Nationaliste Européens ! Ce n’est pas possible !
BRUNO : Si, si ! Des noirs, des Arabes… Moi, j’en connais ! Les mecs qui traînaient avec les fachos c’est des gens avec qui j’ai eu des embrouilles parce qu’ils traînaient avec les fachos. C’est pour ça que c’était compliqué : c’était des mômes, des gens qu’ont entre 17 et 22 ans.
Quel était alors le discours ? S’agissait-il d’une défense de la culture européenne ?
BRUNO : C’était un discours de provos ! Le mouvement skin, au départ c’est un mouvement de provos : les mecs se disent fachos parce que tout le monde est gauchiste ! Ils se disent fachos pour emmerder les gauchistes ! C’est de la provocation mais il y avait un fond politique : les gens avaient un discours : la France, les conneries de skin… Et ça a été résolu par un putsch au forum des Halles par un collectif autonome, qui s’appelait « Les Citrons Mécaniques » (des maoïstes), qui ont mis tout le monde au pas à coups de tartes dans la gueule. Ils ont montré aux skins qu’ils pouvaient être encore plus tarés qu’eux, plus violents, et plus sanguinaires. Et les skins, du jour au lendemain, ont arrêté d’être fachos. Sauf les gens qui étaient militants. Dans les skins, il y avait quelques militants fachos qui faisaient de l’entrisme dans le mouvement skin mais, la plupart des skins, quelques années ensuite, je les ai vus dans des manifs : c’était les premiers à avoir éclaté les fachos. Mais le mouvement autonome était lié au mouvement des squats qui lui-même était lié aux mouvements musicaux (concerts alternatifs). Ca produisait une situation où tout le monde se connaissait : on connaissait tous les skins et les skins nous connaissaient tous : c’était le même milieu. On traînait tous dans les mêmes types de concert, on traînait au forum des Halles : c’était un truc de zonard. C’est petit Paris : tout le monde se connaissait. Mais j’ai jamais entendu tenir des discours fachos : les skins qui venaient ne tenaient pas de discours fachos… il y a eu pas mal de bastons… mais de toute façon, on se tapait tout le temps ! Tout le monde se tapait avec tout le monde ! De toute façon, un concert sans bagarre, c’était pas un concert : « Oh, on s’est fait chier, y’a pas eu de bagarre ! »
En mai 1983, la presse de l’époque parle d’un « Mai 68 à l’envers » où l’extrême-droite tient la rue…
BRUNO : En 83, il y a eu effectivement deux tendances. Il y a eu le mouvement des étudiants contre les lois Savary : une loi qui supprimait la sélection à l’entrée de la fac. Les étudiants des écoles un peu élitistes ont fait des mouvements de grèves avec l’UNI en tête. Il y a eu deux positions : une partie du mouvement, et encore, c’est difficile de dire un mouvement, parce que c’est pas beaucoup de monde et c’est déjà le bordel : une partie des gens, qui allaient faire les barricades, qui disaient : « Droite, gauche, on s’en fout : puisque de toute façon on va bien faire des barricades avec des abrutis de gauche qui sont nos ennemis, pourquoi on irait pas faire des barricades avec des abrutis de droite qui sont nos ennemis ? C’est de la révolte… » C’était une tendance. Moi, j’étais dans une autre tendance où on allait les éclater. Et, effectivement, on a attaqué ces manifs là, on a fait des carnages. Il y avait deux groupes : ceux qui étaient plus du côté des situs qui disaient « Faut y aller », et ceux qui se disaient fondamentalement antifascistes : c’était nous. Et nous on tapait dans le tas : on leur balançait des cocktails Molotov dans la gueule. Attaquer une manif au cocktail Molotov, c’est assez méchant.
Dans ce genre de situation, est-ce que vous ne vous retrouviez pas de fait du côté des policiers ?
BRUNO : De fait, on s’est aperçu que les flics nous laissaient faire…
Est-ce que vous chargiez en même temps que la police ?
BRUNO : Non, ils chargeaient par devant, nous on chargeait par derrière ! Géographiquement, on était pas au même endroit. Mais on les carnageait : on leur a fait des massacres ! Mais ça a duré quinze jours : c’est un non-événement, ça n’a pas tellement d’importance, c’est pas un truc qui m’a marqué.
(1) Véhicules de manutention
(2) Skinheads communistes
(3) Militant d’extrême-droite dirigeant les Jeunesses Nationalistes-Révolutionnaires (JNR) et connu sous le surnom de « Batskin »
(4) « Beur »
—
Interview menée par Sébastien Schifres