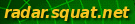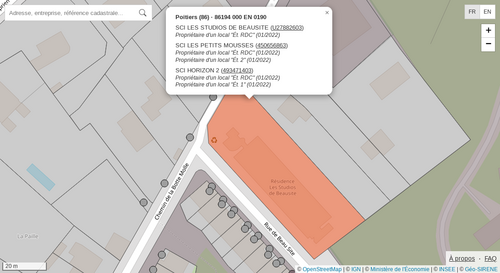Texte publié le 30 juin 2015 sur le site de Contretemps. Nadir Djermoune, architecte-urbaniste et enseignant au département d’architecture à l’université de Blida, revisite ici le débat récent sur Le Corbusier en présentant une lecture critique de sa vision utopique pour la ville d’Alger.
Le Corbusier vient d’être revisité par la publication en France de trois ouvrages [1] qui soulignent, au grand damne des ses adeptes et disciples, ses accointances avec le fascisme et ses offres de service au maréchal Pétain ! Faits qui ne sont pas nouveaux et qui ne sont pas extraordinaires pour autant. D’autres grands penseurs du 20e siècle, sans pour autant les qualifier de fascistes, ont hésité ou ont des ambigüités et des complaisances dans leur positionnement politique ou idéologique vis à vis du nazisme. Ce fut le cas par exemple du philosophe allemand Heidegger, ou encore de son compatriote et compagnon de route de Le Corbusier, l’architecte Mies Van Der Rohe. Ce dernier a lui aussi tenté de vendre son savoir faire architectural et urbain à Hitler. En effet, peu de gens se souviennent, ou savent, que Mies Van der Rohe a promis aux autorités nazies la réouverture de l’école du Bauhaus expurgée de ses « éléments hébraïques, hautement nuisibles » (!!!) et qu’il n’avait décidé d’émigrer aux Etats-Unis qu’en 1938 uniquement par dépit, après qu’Hitler lui eut préféré Albert Speer pour la reconstruction de Berlin [2]. Mais peut-on pour autant qualifier ces personnages de fascistes ou plutôt dissocier leurs idées et leurs engagements politiques de leurs productions scientifiques et de leurs œuvres ?
Il y a dans ce débat, du moins à l’endroit de Le Corbusier, trois dimensions qui suscitent notre intérêt. La première est directement liée aux ambitions de la personne, métaphoriquement comparable à la démarche personnelle d’Hendrick Hoefgen , personnage du film Méphisto [3]. La deuxième dimension est relative aux hypothèses de projets dites « Modernes» qu’il a défendues. La troisième est dans son expérience algérienne, et plus exactement algéroise.
Fascination pour l’autorité
Les écrits sur Le Corbusier (1887-1965) sont nombreux et ont suscités beaucoup de critiques, mais aussi des mythes et des légendes. Lui-même ne fait rien pour les dissiper. Né dans le Jura Suisse, Charles Edouard Jeanneret deviendra Le Corbusier en empruntant à un de ses ancêtres le nom Lecorbézier pour l’utiliser comme pseudonyme dans ses premiers écrits sur l’art et l’architecture. L’un des mythes qu’il s’est construit concerne tout d’abord une affirmation de sa construction intellectuelle en dehors de l’école qu’il prétend avoir quitté à l’âge de treize ans ! Une sorte de « fils de prolo », autodidacte, qui se serait débrouillé tout seul et formé grâce à l’école buissonnière! Il a oublié de souligner que lorsqu’il dessinait les boîtiers de montres à la Chaux-de-Fond en Suisse, ce n’est aucunement en tant qu’ouvrier, mais bien en qualité d’élève de l’Ecole des arts décoratifs. Cette école avait été fondée pour former des graveurs destinés à l’industrie horlogère naissante. Le Professeur L’Eplattenier y créa en 1906 un cours supérieur où les étudiants les plus compétents allaient s’initier à la décoration et à l’architecture. Le futur Le Corbusier s’inscrit dans ce cours à 17 ans [4], où il y commence ainsi son enseignement artistique qui fera de lui l’architecte que l’on connaît.
Faute de trouver du travail comme architecte dans ses premières années d’expériences professionnelles, il exercera d’abord les métiers de peintre et écrivain critique d’art. Il édite en 1923 Vers une architecture, qui deviendra un classique dans l’art et l’architecture modernes. On retrouve dans ce livre toutes les idées du moment, celles du Werkbund, du De Stjil, de Tony Garnier ou encore du Cubisme. On lui reprocha cependant d’avoir pillé les idées des autres. Parmi les critiques d’art, Michel Ragon défend son honnêteté intellectuelle, en soulignant le fait qu’il cite quand même toutes ces sources ! « Il en a fait une synthèse. Ce qui est parfois confus, en tout cas disparate, il l’a rassemblé, étiqueté, numéroté. Ce qui était théorie devient chez Le Corbusier doctrine rigide » [5]. Des critiques les plus dures, même si elles restent idéologiquement lucides, sont formulées par Pierre Francastel dans Art et technique. Il lui reproche tout bonnement d’être un simple disciple de Cézanne et de Bergson. Mais il lui reproche surtout son idéologie mécanicienne et militariste. « dans le monde rêvé par Le Corbusier », écrit Francastel, « la joie et la propreté seront obligatoire. L’univers de Le Corbusier c’est l’univers concentrationnaire » [6].
Toutefois, la plus cruelle des critiques reste celle de Françoise Choay :
« … C’est quelqu’un d’assez frustre et naïf, sur le plan intellectuel, mais doté d’un réel talent de plume. Ces textes sont tous des manifestes, vifs, emportés, provocateurs, avec des excès, des formules qui font « tilt », on les lit sans indifférence. Cela est certain. Mais le contenu, au fond, est assez primaire, embourbé dans l’air du temps. Le Corbusier fait feu de tout bois, il pille sans citer ses sources, entremêlant le lyrisme au rationalisme le plus exacerbé. Mais son message n’est guère original. Quant à son architecture, elle dépend de ses chefs d’agence : il y a une période Pierre Jeanneret, une autre Iannis Xenakis, etc., ce qui pose une fois de plus le statut d’œuvre et celui d’auteur en architecture. Le vrai Le Corbusier se trouve certainement enfoui dans ce fatras, mais l’on ne peut accepter les présupposés anthropologiques de sa démarche. La théorie des besoins à laquelle implicitement il se réfère est discutable, tout comme sa compréhension de l’enjeu technique. C’est extraordinaire que quelqu’un qui se pensait à l’avant-garde n’ait pas perçu ce qui se tramait au cœur des villes. La Ville radieuse, qu’il imagine en 1935, est déjà en retard par rapport aux attentes des citadins et au développement de l’économie et des innovations technologiques. N’oublions pas qu’il était fasciné par la technique, mais qu’il avait du mal à la comprendre. (…) Le Corbusier est scientiste mais sans une solide culture technique, il est dans « son temps » sans réussir à en dégager les virtualités. C’est cela qui explique pourquoi la Tourette est si peu « fonctionnelle », si peu « rationnelle », et qu’à côté de cela il imagine précisément La Ville radieuse qui s’éparpille dans l’espace, qui fait l’apologie des circulations « lourdes » – les réseaux d’aujourd’hui – et qu’il nomme pourtant « ville »… » [7].
Voilà qui est clair et précis pour Françoise Choay.
Dans ses rapports au pouvoir, ce qui est rappelé par cette actualité éditoriale, les multiples critiques soulignent sa fascination pour le pouvoir. Toute sa vie, il restera fasciné par le pouvoir et l’autorité, même si, comme lui-même l’avoua dans un documentaire diffusé par la chaîne franco-allemande Arte [8], la politique dont il se fait une idée assez floue, ne l’intéresse pas. Ce qu’il a toujours cherché en réalité c’est une autorité qui lui permette de construire sa ville radieuse. Et quand il croit avoir trouvé l’occasion de la réaliser, il adhère aveuglément au régime qui est près à l’écouter. C’est pourquoi il sera fasciné par l’URSS sous Staline et « attendra pendant quelque temps, à l’hôtel Carlton de Vichy, que Pétain l’appelle », note Michel Ragon [9]. Mais ni Staline, ni Pétain n’ont été convaincus par ses théories. Seul Nehru l’a pris au sérieux et il l’a introduit pour diriger la construction de la ville de Chandigar.
Les idées et le projet : contradictions et impasse
Le deuxième questionnement que soulève cette invitation de Le Corbusier au débat à titre posthume n’est pas tant centré sur ses pérégrinations mégalomaniaques. Mais bien plus sur les idées qu’ont véhiculé ses projets et ses théories. Vu sous cet angle, nous ne pouvons pas associer d’une manière bête et méchante les ambitions, les choix politiques et idéologiques de l’architecte et la valeur de ces projets et leurs portées culturelles ou même idéologiques.
Le Corbusier appartient à un courant de pensée qui a marqué une bonne partie du 20e siècle. Si l’attitude d’un Le Corbusier ou Mies Van Der Rohe est plus comparable au personnage de Méphisto, ce n’était pourtant pas le cas de Walter Gropius [10] ou de Hans Meyer [11] qui ont toutefois porté les mêmes idées sur le plan architectural. Le premier a fui Hitler pour les Etats-Unis. Le deuxième a choisi la Russie soviétique car plus proche de ses orientations idéologiques. Séparons donc la critique du personnage et la critique des idées qu’il a portées.
Le Corbusier appartient donc à un courant de pensée urbaine et architecturale appelé « Mouvement Moderne » ; une modernité qui prône l’unité de l’art et de la technique, la fusion entre la peinture, la sculpture et de l’architecture, l’élimination de la distinction entre l’artisan et l’artiste. Ce sont là les principales idées qui se cristallisent dans l’enseignement de l’école allemande du Bauhaus et tout le « Mouvement Moderne » qui font une offre de service à l’entreprise et instaureront leur hégémonie sur la production urbaine et architecturale en Europe et partout dans le monde.
C’est le triomphe du capitalisme industriel avec son corollaire d’idéologie du progrès et de la croissance qui deviennent une sorte de religion scientifique. Au capitalisme de la libre concurrence succède un capitalisme de monopole. L’économiste américain Keynes propose de booster la consommation pour trouver un débouché au surproduit industriel. C’est aussi l’hégémonie de la culture européenne derrière le leadership esthétique allemand et nord européen. Même la révolution soviétique dans ses années pré-staliniennes intègre le même projet dans le sillage du constructivisme russe et que résume Moïsseï Guinsbourg dans son ouvrage Le style et l’époque [12], l’équivalent de Vers une architecture de Le Corbusier. Le peintre Mondrian et le Stijl hollandais poussent l’abstraction esthétique prônée par le Mouvement jusqu’à son paroxysme. Le Corbusier les expérimente dans ses villas, notamment la Villa Savoie. Plus tard, le Brésilien Oscar Niemeyer réalise la prophétie d’éliminer toute distinction entre architecture et sculpture à l’image de ses universités algériennes de Constantine et de Bab Ezzouar à Alger et d’une manière simpliste et caricaturale à l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (EPAU) [13].
Ces hypothèses qui tentent de construire une « esthétique industrielle », ou plus exactement une esthétique au service de l’industrie organisant désormais la vie humaine, vont être initiées au niveau urbain par ce même Gropius, suivi de près par Le Corbusier.
En urbaniste, l’architecte allemand voulait, tout comme Le Corbusier en France, donner aux hommes le maximum de soleil, d’air, d’espace, de verdure tout en tenant compte de l’expansion démographique et du « droit à la ville » aux paysans et aux classes populaires. Pour cela, il mit au point, dans la construction d’un ensemble résidentiel à Berlin en 1929, le principe qu’il appelle « immeuble lamelliforme », construction étroite de huit à dix étages, bâties non pas parallèlement à la rue comme le veut la pratique urbaine jusqu’alors, mais transversalement, orientés en fonction du soleil et isolés par des zones de verdure.
C’est l’ancêtre des immeubles collectifs construits parallèlement ou perpendiculairement aux courbes de niveaux à Alger par les architectes modernes dans les années 1950, (les Asphodèles à Ben Aknoun, cité des Annassers à Kouba, Diar Echemes… ou encore Diar ElMehssoul, Diar Essaada et Climat de France de F. Pouillon). C’est aussi l’ancêtre des « grands ensembles », une application universelle, simpliste et aberrante, de ce principe « lamelliforme » ; « grands ensembles » qui continuent d’être le modèle de production du logement en Algérie. Ce n’est évidement pas le caractère de masse ou la dimension sociale dans la production de ces logements qui sont problématiques, comme le préconise la critique actuelle, c’est surtout la méthode préconisée qu’il faut interroger.
Cette méthode née théoriquement avec le Bauhaus, tente de régler la confrontation entre l’idéal du progrès, machiniste et technologique et les exigences démocratiques des populations ouvrières et paysannes en plein processus d’urbanisation. De cette méthode, Le Corbusier se fera le héraut qui aboutira aux CIAM [14] et à la Charte d’Athènes [15].
Le Corbusier à Alger : limites de l’utopie techniciste
En quoi consiste cette méthode ? C’est ici le troisième aspect de cette réouverture du dossier « Le Corbu » qui nous ramène aux contradictions d’aujourd’hui.
En 1930, Le Corbusier entame une série de grands voyages. Après Moscou, c’est l’Amérique Latine (Argentine, Brésil, Uruguay) en 1929-1930 ; puis l’Algérie en 1931, enfin les Etats-Unis en 1935-1936. De ces voyages, il élabore des plans expérimentaux de l’ordre de l’utopie qui le conduiront au plan Obus d’Alger. A Rio, il dessine une cité linéaire sinuant le large de la baie de la ville. Il invente sa « ville radieuse », ou plutôt sa méthode qu’il proposera pour Paris (plan Voisin), pour Anvers ou Barcelone ou pour Alger (plan Obus).
A Alger, Le Corbusier exploite comme à Rio les données du site, la morphologie du terrain très escarpé, les hauteurs autour du « Fort l’Empereur », la Casbah et la courbe de la baie. Il en fait des matériaux bruts disponibles et exploitables. Il propose une structure à échelle gigantesque formée de bâtiments très longs, d’un seul bloc, perpendiculaires à l’horizontale de la ville, formant une sorte de promontoires, surplombés par des viaducs servant pour la circulation. Les bâtiments sont construits sur pilotis, libérant ainsi le sol pour la circulation et l’aménagement du parc. Pour Jean-Louis Cohen, « les premières hypothèses tracées du pont du navire sont en effet une sorte de plan Voisin (…) mais, très rapidement, une autre stratégie est formulée, prolongeant celle élaborée en 1929 pour Rio, tout autant que l’émoi plastique devant le paysage de la baie d’Alger celui de la capitale brésilienne deux ans auparavant » [16]. L’auteur souligne par ailleurs que les formes longitudinales des bâtiments semblent être le fruit de « la surenchère » à l’endroit des ses concurrents du moment, notamment Maurice Rotival. À la place des gratte-ciels du projet de celui-ci, jugés démesurés, Le Corbusier les dessine longs et horizontaux pour en « tirer une grande horizontale de l’aire », note-il dans un dessin tracé depuis le bateau [17].
Puis les esquisses pour le projet continuent à partir de son atelier parisien « sans enquêtes sur le terrain » [18]. La cité des affaires, dénommée « poste de commandement » – pour rester dans la terminologie de la « cité radieuse » – est d’abord placée dans l’axe du square Bresson (aujourd’hui square Port Said) reprenant une figure de son propre projet pour Montevideo. Ensuite le même projet change de place pour aller vers la Marine qui sera reliée au « Fort l’Empereur » par un viaduc. Enfin, dans son plan directeur de 1942, ce même projet émigre au pied du boulevard Laferière (actuel Khemisti, au lieu-dit Parking Tafoura) afin, dira-t-il, de respecter la Casbah « patrimoine d’art unique au monde ».
Cette méthode de projet, qui relève plus de l’utopie, a pour Le Corbusier valeur d’expérience de laboratoire. Or il est absolument impossible de faire passer un modèle de laboratoire dans la réalité.
Le Corbusier appartient de fait à un courant de pensée qui se veut universaliste, où le monde entier va désormais être façonné par le moule industriel. L’espace est pensé selon les normes du mobilier urbain ou domestique fabriqué à la chaîne dans des usines : des parkings pour les mêmes voitures, des trottoirs pour les mêmes mobiliers urbains et des cuisines pour les mêmes cuisinières. On va jusqu’à vouloir parler la même langue, dira-t-on (l’esperanto).
Or, comme l’écrit Manfredo Tafuri sur le sujet, « l’objet industriel ne présuppose aucune situation univoque dans l’espace. La production en série implique au départ le dépassement radical de toute hiérarchie spatiale. L’univers technologique comme l’avaient déjà compris les cubistes, les futuristes et les élémentaristes, ignore l’ « Ici » et le « Là ». C’est tout le lieu humain- comme simple champ topologique- qui est le lieu naturel de ses opérations » [19].
Mais avec tout ce bruit autour de Le Corbusier, ces théories et projets urbanistiques ne se sont concrétisées que dans deux réalisations : la cité Pessac à Bordeaux et le plan directeur de Chandigarh. Pourtant ses théories ont dominé toute l’utopie urbanistique du 20e siècle. Comment se fait-il que son projet pour Alger, ses plans pour les villes européennes et sud-américaines et ses propositions théoriques n’ont pas abouti ? Il y a ici son échec personnel en contradiction avec sa notoriété ! D’autant plus que son projet, comme le souligne Tafuri, est « considéré comme l’hypothèse la plus avancée et la plus achevée de l’urbanisme moderne » [20].
Laissons M. Tafuri répondre à cette question : « il est impossible d’interpréter correctement l’échec du projet d’Alger – et plus généralement la faillite de Le Corbusier – si on ne le relie pas à la crise internationale de l’architecture moderne, autrement dit, à la crise de l’idéologie du Neue Welt » [21]. Ici s’ouvre un débat qui ne peut être traité dans les limites de cet article.
Pour Tafuri, les conditions les plus générales de rationalisation de la ville et du territoire ne sont toujours pas remplies. Mais la nécessité de cette rationalisation continue néanmoins à servir de stimulant indirect, pour des réalisations compatibles avec des objectifs partiels, fixés au coup par coup [22].
C’est ce qui se passera à Alger. En effet, l’ombre de Le Corbusier et de ses réflexions ont continué à façonner l’urbanisme d’Alger après la deuxième guerre au « coup par coup ». La problématique urbaine de Le Corbusier façonne ses « Amis d’Alger » et ses disciples modernes. C’est le cas de Zehrfuss au champ de manœuvre dans la cité appelé « les groupes ». C’est ostentatoirement le cas du bâtiment « aéro-habitat » sur les hauteurs de Telemly de l’architecte Louis Miquel. On retrouvera son ancien dessinateur Gérald Hanning en collaboration avec Pierre Dalloz au sein de l’agence du plan et leur projet phare inachevée « la cité des Annassers » à Kouba [23].
Mais dans les années 1950, Alger est devenue une agglomération immense dont l’étalement signalait un développement alarmant que J. Berques [24] décrivait comme un attentat topographique et une menace sociale liée à l’invasion de la ville par l’habitat précaire et une vie puissante et misérable. C’est la revendication des « indigènes » au droit à leur ville et la montée du mouvement national pour l’indépendance. Dans le sillage de Le Corbusier, les « Modernes » d’Alger vont constituer un groupe CIAM-Alger qui traitera essentiellement de la question des bidonvilles [25]. Parmi les plus illustres de cette action, l’architecte Roland Simounet. Puis vint le « plan de Constantine » du général De Gaulle qui se construira sur les avatars de la « charte d’Athènes » rédigée par Le Corbusier.
Ce sera la matrice du développement urbain de l’Algérie indépendante !
Notes: