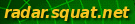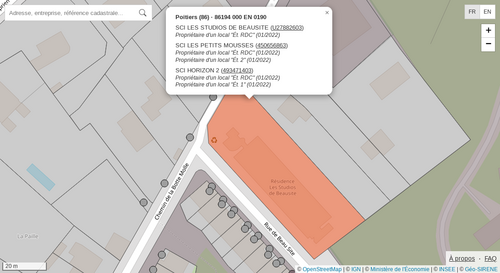À Berlin, socialiser la propriété pour lutter contre la gentrification.
À Berlin, socialiser la propriété pour lutter contre la gentrification.
Le 23 février dernier, pour freiner la flambée du prix du logement provoquée par la gentrification de Berlin, les loyers de la capitale allemande ont été gelés pour une durée de cinq ans. Mais cette mesure cache mal le moteur principal de la gentrification, c’est-à-dire la place grandissante de l’immobilier dans la stratégie de croissance mondiale du capital. Représentant aujourd’hui 60 % des actifs mondiaux, l’immobilier façonne désormais l’espace urbain dans une seule optique : engendrer toujours plus de profit. Face à cette déferlante, les militant·es berlinois·es du logement luttent pour l’expropriation des propriétaires immobiliers. Pour sortir définitivement le logement de sa logique marchande et se réapproprier nos villes comme nos vies.
C’est un samedi exceptionnellement chaud à Berlin – si cela a encore du sens de qualifier une météo d’« exceptionnelle ». Je me réveille tôt, lis un peu, réponds à mes mails, change quelques couches-culottes, puis je sors retrouver des ami·es au café avant la grande manifestation. La manif « contre l’indécence des loyers » ou Mietenwahnsinn est un rassemblement annuel de dizaines de milliers de Berlinois·es à Alexanderplatz pour dénoncer la hausse prétendument inéluctable des loyers dans la capitale allemande. Et comme dans toutes les grosses manifs ici, on se croirait à une fête.
Tout du long de la Karl-Marx-Allee, un immense boulevard construit dans le style stalinien à Berlin-Est, 40 000 personnes défilent : jeunes, vieux et vieilles, parents, colocataires, co-workers, étudiant·es, locataires et militant·es. Tou⋅tes dérivent dans une joyeuse ambiance de concert itinérant et clament des slogans à propos des propriétaires-requins, du coût élevé de la vie et, surtout, de l’expropriation.
Le mot est sur toutes les lèvres, et en particulier chez les élu·es municipaux·ales, les grand·es propriétaires et les agents immobiliers, les locataires en difficulté et toutes celles et ceux qui ont lu le journal, regardé les informations ou parcouru les rues où sont omniprésentes les affiches, les banderoles et les graffitis appelant à l’expropriation du géant immobilier allemand Deutsche Wohnen & Co.
Dans la plupart des villes, des slogans aussi radicaux seraient ignorés ou considérés comme des fantasmes infantiles de la gauche radicale. Mais pas ici. L’expropriation des plus grands propriétaires immobiliers de Berlin – en d’autres termes, la mise en commun de plus de 200 000 appartements privés – est une revendication sérieuse qui pourrait bien se concrétiser. Comment cela a t-il été rendu possible ?
L’État immobilier
Les villes du monde entier étouffent sous l’effet d’un afflux massif de capitaux excédentaires lié à une baisse des investissements productifs. Les super-profits de la finance spéculative captés par les 0,000001 % de la population mondiale ne peuvent pas croupir dans des banques avec des taux d’intérêts proche de zéro, sinon ils meurent prématurément. Comme un cancer, le capital doit circuler, se reproduire et se développer pour continuer à exister.
Il le fait en trouvant de nouveaux investissements, en particulier en achetant, en négociant et en vendant des marchandises, de la main-d’œuvre et des moyens de production, puis en se muant en cours de route en devises, en actions, en biens, en titres, en salaires, en intérêts, en loyers et en profit. Mais avec l’assèchement mondial des taux de profit dans le secteur industriel, de nouveaux dépotoirs sont nécessaires pour rentabiliser les pétaoctets de capital arrachés sur le dos des travailleur·euses.
Et c’est ici que la valeur des biens immobiliers privés réapparaît dans toute sa splendeur. « L’immobilier mondial vaut maintenant 217 000 milliards de dollars, écrit le géographe urbain Samuel Stein. Trente-six fois la valeur de tout l’or jamais extrait. Il représente 60 % des actifs mondiaux, et la grande majorité de cette richesse – environ 75 % – se concentre dans le logement (1). »
Les retours sur investissement dans l’immobilier sont sûrs, stables et très juteux. Ainsi, lorsque les fonds spéculatifs, les sociétés de capitaux, les banques d’investissement et autres organisations perverses de la bourgeoisie mondiale ont besoin d’un cloaque pour y déféquer leur surplus de richesse, ils peuvent toujours en dénicher un dans les maisons, les appartements, les bureaux, les immeubles et les terrains – bref, dans tous les espaces de vie et de travail des êtres humains.
En retour, toutes celles et ceux qui ne peuvent suivre l’escalade des coûts d’achat ou de location de quatre murs sont méprisé·es, expulsé·es, abandonné·es, prié·es de rejoindre une population qui se déplace de plus en plus vers des endroits où le prix de l’immobilier leur permet encore de respirer.
Dans Capital City de Samuel Stein (2019), le nouveau livre indispensable sur la gentrification, l’immobilier et la planification urbaine, la logique de cette dynamique est mise à nu :
« Derrière ces tendances se cache la place grandissante de l’immobilier urbain dans la stratégie de croissance mondiale du capital. À travers ce processus, le prix du foncier devient un déterminant économique central et une question politique dominante. Le terme maladroit de gentrification est devenu un mot courant et devoir déménager à cause de la hausse de son loyer est désormais banal. Le logement devient un actif financier négocié au niveau international, créant des bulles spéculatives. Les autorités municipales sont de plus en plus obsédées par l’augmentation de la valeur des biens immobiliers et la redistribution aux plus riches des profits obtenus via le prix du foncier et les loyers. Il n’est pas anodin que le promoteur immobilier Donald Trump soit d’abord devenu une célébrité avant d’être élu président. Ainsi, nous assistons à la montée en puissance d’un État immobilier, une structure politique au sein de laquelle le capital immobilier a un impact démesuré sur l’organisation de nos villes, sur nos politiques publiques et sur nos propres vies (2).»
Les facteurs de l’essor de l’État immobilier sont complexes, mais ils ont surtout trait à la désindustrialisation qui affaiblit l’emprise du capital industriel sur les villes (qui avaient intérêt à garder des terrains et de l’immobilier bon marché pour les travailleur·euses et les entreprises) et qui renforce le pouvoir du capital immobilier sur la planification urbaine (pouvoir qui cherche à tout prix à augmenter la valeur des biens immobiliers (3)).
De plus, la baisse du taux de profit dans les industries productives conduit de plus en plus de capitalistes à rechercher des taux de rendement plus élevés dans des actifs plus sécurisés tels l’immobilier. Enfin, la déréglementation financière des biens immobiliers privés fait que les logements peuvent être échangés comme des actions en bourse et être regroupés dans des formules d’investissement qui sont vendues et revendues au plus offrant.
Ainsi, posséder un toit devient avant tout synonyme de profit et non plus de logement. En outre, les pratiques bancaires d’assouplissement quantitatif (4) créent des quantités massives d’argent qui ne servent pas à « créer des emplois », mais à financer directement l’achat de foncier et de biens immobiliers. La valeur de l’immobilier explose, et crée des bulles spéculatives amoncelées sur d’autres bulles, qui elles-mêmes n’attendent que l’occasion d’éclater. En d’autres termes, il ne s’agit pas simplement d’un manque d’offre qui provoquerait une surévaluation massive du prix de l’immobilier, mais d’une hyperinflation de la demande en logement à la fois provoquée par un stock mondial de capitaux excédentaires et légalement appuyée par des intérêts de classe travaillant directement contre vous (5).
L’immobilier incarne la forme de richesse la plus répandue aujourd’hui. C’est notre or. Celui qui possède un titre de propriété s’enrichit à la fois sur le travail, la spéculation et la valeur créée par ce bien. Or, puisqu’on peut hériter de droits de propriété, cette richesse est elle aussi héréditaire. Mais elle n’est pas seulement transmise à la génération suivante, elle sert également de point de départ à plus d’accumulation, plus de développement, plus de profit. Comme tout le monde le sait – mais personne n’est censé le dire –, la meilleure façon d’acquérir des biens est de naître dans une famille qui en possède déjà. Dans une économie capitaliste, on acquiert une maison, un immeuble, un appartement ou un terrain uniquement pour sa valeur marchande et non pour répondre à un besoin ou à un usage.
« Tant que la propriété foncière ne sera pas socialement contrôlée, seules celles et ceux qui possèdent des biens immobiliers, des capitaux et un accès au pouvoir détermineront la politique urbaine », proclame Samuel Stein (6). En clair : pour pouvoir mener une vie digne dans nos villes sans craindre d’être déplacé·e ou de sombrer dans la pauvreté, il faut s’attaquer frontalement à la propriété immobilière.
Gentrification et antigentrification à Berlin
« La propriété immobilière met la ville face à deux options : la gentrification ou le désinvestissement (7). » Qu’est-ce que la gentrification ? La gentrification signifie simplement l’optimisation de l’espace urbain pour le capital. C’est, comme le dit la géographe Ipsita Chatterjee, « voler l’espace urbain au travail et le convertir en lieux de profit ». La gentrification désigne ainsi l’attaque incessante des quartiers populaires par une alliance entre le capital immobilier, les municipalités et les urbanistes, qui considèrent tous que l’augmentation de la valeur des biens immobiliers est la condition sine qua non de toute politique urbaine.
Elle n’est pas simplement le fait des touristes, artistes, hipsters ou tout autre groupe social habituellement jugé responsable du phénomène. Bien sûr, le logement en tant que marchandise ne vaudrait rien sans sa consommation. Sans sa vente, la valeur d’une marchandise ne se réalise pas. Mais affirmer que seule la consommation produit la gentrification, c’est malheureusement confondre l’effet et la cause. Les logiques d’investissement, de désinvestissement et de réinvestissement (8) dans les villes ne sont pas dictées en premier lieu par les consommateur·trices branché·es, mais par la valeur potentielle que les promoteur·trices, les politicien·nes et les propriétaires foncier⋅ères peuvent créer en transformant l’espace urbain en un territoire accessible aux populations riches. En d’autres termes :
« De gré ou de force, les urbanistes utilisent la gentrification pour créer les environnements physiques permettant au capital de prospérer. C’est le processus par lequel les villes recherchent des capitaux, et les capitaux recherchent du foncier. Son but ultime est une ville contrôlée par des banquier·ères et des promoteur·rices, gérée comme une entreprise, conçue comme un produit de luxe et planifiée par le secteur financier. Ce qui était public devient privé ; ce qui était commun devient exclusif ; ce qui était bon marché devient cher ; ce qui était partagé devient commercial. À travers l’État immobilier, la ville se gentrifie. Et à travers la gentrification, la ville devient néolibérale (9).»
À Berlin, diverses stratégies ont été déployées pour mettre fin à cet assaut : construction effrénée d’immeubles, plafonnement des loyers, rachats publics, occupation de logements, graffitis militants, bris de vitres, découragement des jeunes cadres dynamiques à s’installer, lobbying politique, aménagement urbain. Mais rien de tout cela n’a ralenti l’explosion des loyers et la spéculation immobilière (10).
Pourquoi les loyers, qui étaient auparavant si bas, ont-ils soudain augmenté ? L’explication est simple : il y a quinze ans, alors que la population berlinoise stagnait voire déclinait et que des centaines de milliers d’appartements demeuraient vides, la municipalité a décidé de vendre une grande partie de son parc public à des entreprises privées afin de réduire son déficit budgétaire. Mais maintenant, Berlin est devenue « cool », attirant de nouveaux résidents et résidentes et de nouveaux emplois à un rythme si rapide que la ville ne peut plus suivre (11). En bref, la demande dépasse l’offre. Pour résoudre le problème, dit-on, il suffit de construire plus de logements.
Cependant, s’il est vrai que la population berlinoise a rapidement augmenté, c’est également le cas des logements nouvellement construits. « Au cours des douze mois précédant mars 2019, précise le journaliste Feargus O’Sullivan, le nombre de nouveaux contrats de construction a augmenté de 11,3 %. »
En outre, l’augmentation de la population et de la demande n’entraînent pas automatiquement la gentrification, les appartements de luxe, les mégafusions d’agences immobilières, les déplacements de population, les expulsions, etc. La question est de savoir pourquoi Berlin est aujourd’hui si attractive ?
Pour comprendre cela, il faut tenir compte de la transition entre une période de désinvestissement et une période de réinvestissement. La « demande » de logement ne vient pas seulement des travailleur·euses qui ont besoin d’un appartement pour vivre – le logemles fonds de capital-risqueent en tant que valeur d’usage –, mais aussi des actionnaires qui ont besoin d’appartements pour investir – le logement en tant que valeur d’échange (12). L’immobilier est la lessiveuse des capitaux excédentaires, non seulement pour les investisseur·euses locaux·ales et étranger·ères, mais aussi pour les banques et les entreprises assises sur des milliards de dollars et d’euros. Que faut-il donc faire ?
L’année dernière, Google a acheté une partie d’un ancien bâtiment industriel en plein Kreuzberg, un quartier berlinois qui se gentrifie rapidement, et a prévu d’en faire un « campus » pour les start-ups. C’était bien vu. Ces derniers temps, les fonds de capital-risque (13) ont en effet tourné au-dessus de Berlin tels des vautours à la recherche de chair fraîche de start-ups à dévorer. (Si vous entendez ou voyez les mots innover, coworking, accélérateur, transition, partage, mission, incuber, pop-up, ou disrupter surgir autour de votre ville, alors la fin est proche.)
Cependant, la perspective de voir de riches cadres de la tech se promener le long du canal en Segway avec leur tote-bag design et leurs AirPods issus du commerce équitable n’enchantait pas spécialement nombre d’habitant·es du quartier. Iels savent ce qui arrive aux villes qui se prosternent devant l’autel du capital-risque : accroissement des inégalités, déplacements des habitant·es, hausse des loyers, emplois informels, homogénéisation de la culture et augmentation de la surpopulation.
Les gens ont donc riposté, avec des assemblées de quartier, des groupes de travail, des manifestations, des interviews dans les médias, des campagnes de pression politique et toutes sortes d’actions directes qui ont abouti à une tonitruante occupation du bâtiment en lui-même – avant l’expulsion des occupant·es par la police (14). Après cela, Google a décidé de se retirer du projet, laissant la place aux associations locales. Les habitant·es ont gagné… et pourtant, Google est resté à Berlin, achetant de nouveaux bureaux dans le quartier de Mitte.
Plus récemment, des activistes locaux·ales ont réussi à bloquer la construction d’un hôtel sur la Skalitzer Straße à Kreuzberg, forçant le propriétaire et la ville à faire des compromis pour une utilisation plus « sociale » de l’espace alloué. Des militant·es de gauche gérant collectivement des espaces de travail sur la Lausitzer Straße ont tenté d’empêcher leur propriétaire (le groupe Taekker) de vendre leur immeuble pour des millions d’euros à un·e autre investisseur·euse. Certain·es se sont rendu·es dans les bureaux du propriétaire à Berlin, et d’autres sont même allé·es au Danemark pour protester contre l’entreprise. Iels ont également pris contact avec les résident·es d’autres immeubles appartenant à la même société afin de créer un réseau de solidarité pour la défense de ces espaces.
En mai 2019, un groupe anonyme a quant à lui organisé une action pour souligner le rôle néfaste d’AirBnB et des locations de vacance sur la ville. Le collectif a loué un appartement AirBnB pour en faire une galerie d’art éphémère exposant des cartes du logement en ville, des récits de personnes obligées de quitter leur quartier, et un lit et une baignoire recouverts de slogans et de graffitis antigentrification (15).
Lorsqu’un·e propriétaire veut vendre son parc de logements à une société ou à une personne, la ville de Berlin dispose d’un droit de préemption afin d’acheter prioritairement le bien immobilier dans l’optique d’en faire des logements à prix abordable ou un bâtiment à usage social. Cela n’est pas suffisant pour juguler l’augmentation effrénée des loyers, mais c’est une pratique de plus en plus répandue (16).
Le droit de préemption est un outil qui peut être utilisé pour « démarchandiser » le logement, mais comme il exige d’acheter d’abord la propriété à la valeur du marché, il nécessite que les finances municipales soient elles aussi en pleine croissance.
Tel est le dilemme : tant que la ville reste dans le paradigme actuel, pour redistribuer la richesse, il faudrait d’abord qu’il y ait assez de richesse à redistribuer, et pour qu’il y ait assez de richesse, l’économie doit croître, ce qui signifie plus de privatisation des biens publics, plus d’exploitation des travailleur·euses, plus de désinvestissement de la protection sociale et plus d’allégements fiscaux pour le secteur privé. En bref, cela signifie plus de gentrification.
Stopper la gentrification par la gentrification est une impasse. Mais il existe une autre option. Comme Engels l’écrivait déjà en 1872, « on peut apporter un soulagement immédiat à la crise du logement en expropriant une partie des habitations de luxe qui appartiennent aux classes possédantes et en réquisitionnant l’autre (17) ». Alors pourquoi ne pas exproprier ?
Exproprier
Cet appel à l’expropriation s’attaque aux plus gros·ses propriétaires immobilier⋅ères de Berlin, c’est-à-dire ceux et celles qui ne visent que le profit et qui possèdent plus de 3 000 appartements. La cible principale est la société immobilière Deutsche Wohnen & Co, qui détient près de 111 500 logements à Berlin, mais ce n’est pas la seule. Il y en a d’autres (comme Vonovia, Akelius ou Pears) qui géreraient potentiellement 294 000 appartements (18).
D’après la loi fondamentale allemande (articles 14 et 15), c’est au gouvernement de proposer une compensation financière aux entreprises afin qu’elles abandonnent la propriété de leurs biens immobiliers à un taux équilibré entre l’intérêt public et le coût privé de ces biens. Cette compensation est estimée entre 7 et 36 milliards d’euros – la dette publique de Berlin s’élevant actuellement à 58 milliards d’euros. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Qui deviendrait le ou la propriétaire de ces appartements – la ville, l’État, les résident·es ? Et comment faire (19) ?
La proposition d’exproprier les gros·ses propriétaires doit d’abord être soumise au vote. Il faut pour cela suivre quelques étapes. Les militant·es doivent dans un premier temps rassembler 20 000 signatures afin de mettre le processus en route puis en rassembler 170 000 autres, sur une période de quatre mois maximum. Ensuite, il faut qu’iels remportent le référendum à la majorité, le nombre de votant·es devant être d’au moins 25 % des électeur·rices inscrit·es pour que le vote soit valide. Après cela, la municipalité est obligée de faire quelque chose, mais rien n’assure qu’elle aille au bout du processus. Elle peut proposer une sorte de compromis, qui noierait la demande d’expropriation dans une promesse de construire plus de logements abordables ou qui encouragerait un gel temporaire des loyers. Mais même si la municipalité décidait de passer à la vitesse supérieure et d’exproprier les mégapropriétaires, cette décision serait très probablement contestée devant les tribunaux. La loi fondamentale allemande renferme pourtant une base juridique autorisant l’expropriation, lorsque celle-ci est effectuée dans l’intérêt public. L’article 14 affirme :
1) La propriété et le droit d’hériter doivent être garantis. Leur contenu et leurs limites doivent être définies par la loi.
2) La propriété entraîne des obligations. Ses usages doivent être au service de l’intérêt public.
3) L’expropriation est autorisée seulement dans l’intérêt public. Elle ne peut être ordonnée qu’en vertu ou en application d’une loi qui détermine la nature et l’étendue de la compensation de cette expropriation. Cette compensation doit trouver un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt des personnes ou organismes affectés par l’expropriation. En cas de désaccord sur le montant de la compensation, il est possible de recourir à un tribunal de droit commun.
« La propriété entraîne des obligations » – mais de quelles obligations parle-t-on, et auprès de qui ? Et que se passe-t-il si ces obligations ne sont pas remplies ? « Ses usages doivent être au service de l’intérêt public » – la propriété foncière, celle des ressources naturelles et des moyens de production est-elle vraiment au service de l’intérêt public ? Est-ce qu’elle satisfait réellement les besoins des individus ? Et si ce n’est pas le cas, que peut-on changer à cela ? « L’expropriation est autorisée seulement dans l’intérêt public » – si l’on considère qu’il est dans l’intérêt public que chacun·e mène une vie digne, qui lui permette de remplir des besoins essentiels tels que se nourrir, se vêtir et se loger, alors l’expropriation dans ce but ne semble pas seulement un moyen adapté, mais nécessaire. L’article 15 affirme :
« La propriété foncière, celle des ressources naturelles et des moyens de production peut, dans le but d’une socialisation [Vergesellschaftung], être transférée à un propriétaire public ou à d’autres formes d’entreprise publique par une loi qui détermine la nature et l’étendue de la compensation. En fonction de cette compensation, la troisième et la quatrième phrase du paragraphe (3) de l’article 14 s’appliquent mutatis mutandis. »
« Dans le but d’une socialisation » – voilà la formule à laquelle s’est accrochée la campagne contre la Deutsche Wohnen & Co Enteignen. Il s’agit d’une stratégie qui n’a jamais été mise en œuvre en Allemagne. Or, tout repose sur l’interprétation que l’on donne du terme Vergesellschaftung. Signifie-t-il nationalisation ou socialisation ?
Si l’on considère qu’il signifie nationalisation, alors c’est l’État qui récupère la propriété en question et l’administre comme des logements sociaux, des transports publics, la Sécurité sociale, l’Armée, etc. Si l’on estime qu’il signifie socialisation, alors ce sont les locataires, les communautés locales, les associations ou les organismes de gestion foncière qui sont propriétaires de ces biens et en assurent la gestion. En d’autres termes, les logements ayant fait l’objet d’une expropriation appartiennent-ils à celleux qui les habitent, les utilisent et en ont besoin, ou doivent-ils être la propriété de l’État, qui doit alors être le premier acheteur de ces propriétés ? Ou peut-être cela signifie-t-il que les terres, les ressources naturelles et les moyens de production peuvent légitimement faire l’objet d’une expropriation et être démarchandisés dès lors que la société elle-même a besoin de socialisation. Si c’est le cas, cela doit être fait rapidement.
La campagne d’expropriation des mégapropriétaires est un développement positif pour la ville, et – bien que de manière tout à fait insuffisante pour l’instant – elle effraie déjà des investisseur·euses. Mais les résultats d’une telle entreprise sont encore inconnus. Les critiques affirment que l’expropriation en elle-même ne permettra pas de créer de nouveaux appartements – elle ferait « seulement » basculer à peu près 12 % de logements du privé vers le public. La ville de Berlin devra quoi qu’il en soit payer des milliards d’euros à ces grand⋅es propriétaires, et donc dépenser de l’argent qui pourrait être utilisé pour construire de nouveaux logements sociaux. Enfin, rien ne garantit que les expropriations finiront par stabiliser les loyers dans le parc immobilier privé ou public.
On peut toutefois opposer à ces arguments le fait que la privatisation du logement social n’a pas non plus créé de nouveaux logements, et pourtant cette politique est portée aux nues par les mêmes chantres du marché qui dénoncent l’expropriation. Celleux qui la réclament, au contraire, veulent aider les locataires aujourd’hui en difficulté, tou·tes celleux qui sont menacé·es d’expulsion et ont besoin de soutien (20). Et surtout, iels tiennent à signaler aux investisseur·euses, aux sociétés immobilières, aux personnalités politiques et aux propriétaires que cette ville n’est pas à vendre.
Si le logement est vraiment l’un des droits humains comme le proclament tant de déclarations universelles, alors il ne peut pas être en même temps une marchandise. Pour que le logement réponde réellement aux besoins de la population et non à la richesse privée, il ne peut pas être produit ou distribué selon les variations du marché. Pour que nous ne soyons plus exproprié·es de nos vies quotidiennes, c’est la propriété qu’il faut exproprier, maintenant. Mais comme le dit très clairement l’article 15, pourquoi s’arrêter au logement ? Pourquoi ne pas tout inclure, « la propriété foncière, celle des ressources naturelles et des moyens de production » ? Pourquoi ne pas tout exproprier ?
Les capitalistes sont les champion⋅nes de l’expropriation. Le développement capitaliste est entièrement basé sur l’expropriation des petits paysans de leurs terres – un processus violent et de longue durée, étalé sur plusieurs générations et plusieurs continents, qui a dépossédé les individus et les a rendus dépendants de leur capacité à vendre leur force de travail pour subvenir à leurs besoins. Sans ce processus initial d’expropriation foncière, personne aujourd’hui n’aurait besoin de courir après son loyer, son travail ou son argent pour survivre. Si le début de l’accumulation capitaliste se trouve dans l’expropriation des masses par quelques-un·es, alors la fin de notre propre misère se trouve dans l’expropriation de quelques-un·es par les « masses ». C’est ce que Marx appelle « la métamorphose en propriété sociale de la propriété capitaliste, qui de fait repose déjà sur un mode de production collectif (21) ». C’est le capitalisme lui-même qui ouvre le chemin à la propriété sociale, en socialisant la production. Pour Marx, c’est même le moyen le plus rapide de sortir de l’embarras dans lequel nous nous trouvons :
« La centralisation des moyens de production et la socialisation du travail atteignent un stade qui les rend incompatibles avec leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise en éclats. L’heure de la propriété privée capitaliste a sonné. Les expropriateurs⋅ices sont exproprié⋅es (22). »
Mais qui va exproprier les expropriateurs·ices ? Et comment ? Comme l’a montré Oliver Nachtwey dans son livre Germany’s Hidden Crisis (2018), qui modère un peu ces élans, nous vivons une période de modernisation régressive, un passage de l’emploi stable et encadré à des conditions de travail de plus en plus informelles, une période d’effondrement social mal dissimulé par la recrudescence des emplois précaires, à temps partiel et mal payés. La crise de la reproduction sociale et de l’incapacité à joindre les deux bouts ne va pas disparaître par magie. Des luttes sociales éclosent ça et là, mais il n’y a pas de classe organisée qui soit assez solide pour forcer l’expropriation de la richesse privée « dans le but d’une socialisation ».
Cependant, et pour freiner la descente vers la barbarie, il nous faut affronter la question de la propriété. « L’objectif, écrit Samuel Stein, n’est pas d’abolir la propriété elle-même, mais de défaire les relations sociales qui produisent de la propriété privée capitaliste 23. » Une des manières de défaire ces relations de propriété qui gouvernent nos vies est d’exproprier ces relations pour nous-mêmes : non seulement dans le logement, mais aussi dans le transport, la nourriture, l’énergie, l’école, l’éducation des enfants, le travail – tous les aspects de la vie dans lesquels nous avons été dépossédé·es de notre avenir afin qu’il soit offert à la souveraineté du « marché ». Ou, comme le suggère Daniel Loick dans The Abuse of Property (2016), peut-être que le principal problème avec la propriété privée aujourd’hui n’est pas sa mauvaise répartition, mais le fait même que des biens comme le logement soient appropriables. À quoi pourrait ressembler un monde dans lequel les choses n’apparaîtraient plus comme appartenant à une personne ou à l’autre, mais où elles existeraient pour être utilisées, satisfaire des besoins ou procurer du plaisir, bref pour tout sauf pour ce qui empêche les individus d’être des humains à part entière ?
La manif « contre l’indécence des loyers » se termine sur le pont de Kreuzberg, où démarre une petite occupation, loin d’être le fruit du hasard. Un appartement vide est investi, et rapidement un appel à tenir le lieu est lancé. Des centaines de personnes accourent, des corps comprimés se débattent dans des rangées de policier·ères anti-émeute gonflé·es à bloc qui empêchent l’accès au bâtiment. Cela ne dure que quelques heures. Une poignée de manifestant·es ensanglanté·es, des policier·ères blessé·es, et quelques arrestations – la routine. C’est la fin du rassemblement, il est temps de rentrer chez soi et de se préparer pour la prochaine manif sur le logement, qui aura probablement lieu la semaine prochaine.
Sur le chemin du retour, je traîne dans les rues. Je passe devant un groupe d’individus qui collectent des signatures pour la campagne d’expropriation, et cela me rappelle un épisode du début de la crise financière, il y a dix ans à New York, lorsque des petit·es malin·es accrochaient des banderoles en haut des immeubles avec écrit « Occupons tout », pour appeler à des occupations de l’espace privé et public. Quelques années plus tard, cet appel était repris partout dans le pays. Mais l’occupation de l’espace n’a jamais été qu’une solution temporaire à un problème bien plus profondément ancré. Pour vraiment se réapproprier nos villes et nos vies, sans risquer de s’en faire expulser par la police ou par notre propre épuisement, l’action politique doit passer de l’occupation à l’expropriation généralisée. Sinon, autant attendre que la météo redevienne normale.
NOTES:
(1) Samuel Stein, Capital City, Verso, 2019, p. 2.
(2) Samuel Stein, Capital City, Verso, 2019, p. 5.
(3) Voir ibid., p. 2-3 : « Plusieurs raisons expliquent la convergence du capital vers le foncier et l’immobilier : une longue période de déréglementation financière, des taux d’intérêt bas et l’achat massif d’actifs immobilier par les banques aux États-Unis ; des programmes d’urbanisation à grande échelle en Chine, aux Émirats arabes unis et dans plusieurs autres pays ; une prolifération de fonds d’actions prédateurs qui parcourent la planète à la recherche d’opportunités d’investissement “sous-évaluées” et les trouvent dans le logement ; une polarisation économique du monde avec des personnes extrêmement riches qui considèrent l’immobilier comme étant l’endroit le plus sûr pour cacher son argent ; et bien d’autres choses encore. Lorsque les gains en termes de capital augmentent alors que les taux de profit chutent dans de nombreux secteurs économiques autrefois dynamiques, l’immobilier devient la dernière étape de ce que la géographe Cindi Katz appelle la recherche éternelle de rentabilité du capitalisme “vagabond”. »
(4) L’assouplissement quantitatif désigne une mesure de politique monétaire exceptionnelle mise en place par une banque centrale et qui consiste à acheter massivement des titres de dette afin de faire circuler une plus grande quantité de monnaie et relancer l’activité économique. La Banque centrale européenne a pratiqué cette politique lors de la crise de la dette de la zone euro en 2015. ndt
(5) Pour une analyse plus économique, voir Josh Ryan-Collins, Why Can’t You Afford a Home?, Polity, 2019. Par exemple p. 123-124: « La demande de propriété foncière est devenue excessive et spéculative. Les systèmes bancaires des économies capitalistes modernes ne se livrent plus aux activités que nos manuels scolaires nous apprennent. Ils sont devenus principalement des créanciers immobiliers, créant des crédits et de l’argent qui alimentent une offre de propriétés foncières. Cela fait monter les prix des maisons, créant une demande toujours plus grande en crédits hypothécaires et in fine des profits plus élevés pour les banques. Grâce à ces profits, le système bancaire – et les autres institutions financières qui achètent des titres adossés à des hypothèques émis par les banques – capitalise sur la hausse des loyers du foncier que leurs propres prêts contribuent à générer. Ce cycle de rétroaction entre le logement et le financement en est venu à dominer les économies capitalistes, comprimant la demande des consommateurs et les investissements productifs, comme le craignaient les économistes classiques lorsque la plupart des terres étaient encore utilisées pour l’agriculture. »
(6) Samuel Stein, ouvr. cité, p. 10.
(7) Ibid., p. 48.
(8) Ibid., p. 58 : « Par définition, la gentrification ne peut pas se déployer partout. Elle est la troisième étape d’un long processus de flux de capitaux dans et en dehors de l’espace urbain : premièrement, investir dans un environnement immobilier ; deuxièmement, se désinvestir du quartier et laisser à l’abandon les biens immobiliers ; et troisièmement, réinvestir dans ce même espace pour générer plus de profits. La clé pour comprendre pourquoi certains endroits se gentrifient est la somme d’argent qu’un⋅e propriétaire foncier⋅ère – qui détient le monopole sur tous les loyers d’un lieu géographique particulier – ⋅trices immobilier⋅ères choisissent d’investir dans un endroit particulier parce qu’iels identifient un écart entre les loyers actuels et les futurs loyers potentiels qu’iels pourraient encaisser si certaines mesures étaient prises, telles que l’expulsion des locataires de longue durée, la rénovation des propriétés négligées ou démodées, ou la démolition et la reconstruction des bâtiments. »
(9) Ibid., p. 91.
(10) Lire Feargus O’Sullivan, « Berlin Builds an Arsenal of Ideas to Stage a Housing Revolution », CityLab, 21 février 2019, disponible sur .
(11) Dans « Berlin’s Massive Housing Push Sparks a Debate About the City’s Future », CityLab, 27 novembre 2018, Feargus O’Sullivan écrit : « Berlin a besoin de nouveaux logements, c’est indéniable. L’année dernière, 41 000 personnes ont emménagé en ville, ce qui a fait passer sa population à plus de 3,7 millions d’habitant⋅es. D’ici 2030, ce chiffre devrait atteindre 4 millions. Alimentés en partie par la spéculation immobilière, les loyers moyens à Berlin ont augmenté l’année dernière de 6 %, sachant que le coût d’achat du foncier a lui augmenté de 13,6 %. Pour gérer cette croissance sans augmenter les loyers au-delà du taux d’inflation, cette ville aura besoin de 114 000 nouveaux logements d’ici 2030. Elle aura également besoin de 77 000 logements supplémentaires pour rattraper le retard accumulé ces dernières années en termes de construction. »
(12) Il ne faut cependant pas oublier les nouvelles vagues d’accumulation du capital dans les centres urbains en Allemagne depuis 2009, qui attirent des travailleur·euses ayant la capacité (supposée) de payer des loyers plus élevés. La hausse des loyers et des prix de l’immobilier ne provient donc pas seulement d’un marché du logement plus tendu, mais aussi de propriétaires et d’investisseur·euses qui misent sur des rendements plus élevés grâce à une économie locale en pleine croissance.
(13) Branche de l’investissement capitaliste spécialisée dans la prise de participations dans les sociétés « à fort potentiel », comme les starts-ups. ndt
(14) Comme le souligne Samuel Stein (ouvr. cité, p. 76), « les forces de police agissent comme la branche armée de l’État immobilier : la police fait appliquer ce que les urbanistes et les décideur·euses politiques promulguent ».
(15) Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples de solidarité dont font preuve les gens contre la hausse des loyers, les déplacements de population et la gentrification telle la création d’un bar associatif, d’un centre social, d’appartements partagés collectivement ou d’un parc public.
(16) En utilisant son droit de préemption, la ville de Berlin a acheté 32 biens immobiliers au cours des quatre dernières années (11 en 2017 et 18 en 2018), pour un montant d’environ 154 millions d’euros. La plupart des biens se trouvaient à Friedrichshain-Kreuzberg et à Neukölln.
(17) Friedrich Engels, La Question du logement, 1872, disponible sur .
(18) Pour une analyse de toutes les grandes sociétés immobilières de Berlin qui possèdent plus de 3 000 appartements, voir par exemple cette étude du Rosa Luxemburg Stiftung, Profitmaximierer oder verantwortungsvolle Vermieter ?, et le rapport sur la difficulté de distinguer qui possède quoi, Wel zahle ich eigentlich miete ?, tous deux disponibles (en allemand) sur .
(19) Combien de mégasociétés immobilières y a-t-il à New York (ou dans votre ville, où que vous soyez ) ? Comment s’organisent ces propriétaires, et quel est leur profil ? Peuvent-iels, elleux aussi, être exproprié·es ? Qu’est-ce que cela demanderait ? Je laisse le lecteur ou la lectrice répondre à ces questions.
(20) Voir aussi l’interview avec Nina Scholz, « We Can Defend Ourselves », dans The Brooklyn Rail, juillet-août 2019, et disponible sur .
(21) Karl Marx, Le Capital, Livre premier, chapitre 32 « Tendance historique de l’accumulation capitaliste », 1867,
(22) Ibid.
(23) Samuel Stein, ouvr. cité, p. 196.
Des groupes à Berlin: https://radar.squat.net/fr/groups/city/berlin
Des événements à Berlin: https://radar.squat.net/fr/events/city/Berlin
Stressfaktor: https://radar.squat.net/de/stressfaktor
Des groupes en Allemagne: https://radar.squat.net/fr/groups/country/DE
Des événements en Allemagne: https://radar.squat.net/fr/events/country/DE
[ Texte de Jacob Blumenfeld, publié le 8 juin 2020 par Jef Klak https://www.jefklak.org/exproprions-tout/
Traduit de l’anglais par Mickaël Correia et Lucile Dumont.
Texte original : « Expropriate Everything », paru dans The Brooklyn Rail, Field Notes, juillet-août 2019, disponible sur Brooklyn Rail https://brooklynrail.org/ ]