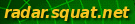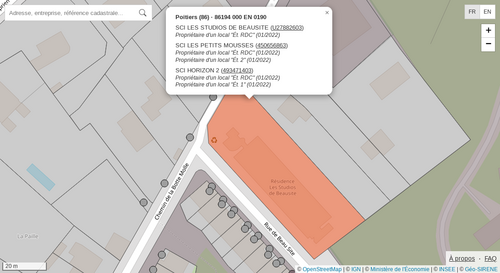Qu’est-ce que cela veut dire de « prendre » cette ville ? Un sentiment est partagé : ça n’est plus tenable de vivre une vie bonne à Genève.
De Malagnou au droit à la ville
À la fin 2016, l’État de Genève résilie le bail de la maison collective de Malagnou. Après une première tentative ratée en 2013, l’État souhaite à nouveau se débarrasser d’une maison qui le dérange – un habitat collectif, indépendant de la Ciguë (Coopérative pour le logement étudiant), qui sert de base logistique pour l’organisation politique ainsi que de lieu de rencontre et d’activités autogérées. Manœuvrant cyniquement sur les mobilisations récentes contre les conditions déplorables d’hébergement des migrant.e.s à Genève, l’État avance la carte de leur accueil pour tenter de vider la maison. Or cette manigance grossière qui met en concurrence des précarités – migrantes et migrants contre « jeunes en formation » – n’a pas l’effet escompté. Mieux, les coups de pression et autres manipulations – filatures, arrestations, perquisitions – que l’État orchestre autour de Malagnou se retournent contre lui sous la forme d’une fronde populaire. Plutôt que de voir les Malagnou Kids à la rue, l’État se retrouve face à un large mouvement de soutien.
Ce sont des milliers de personnes qui battent le pavé en juillet, puis en octobre 2017. Elles répondent à des mots d’ordre qui vont au-delà de la simple défense d’un lieu de vie et d’organisation genevois. Elles donnent suite à un appel à contrer la « pacification de la ville et [sa] gentrification galopante » et à faire barrage à la « politique d’aménagement toujours plus élitiste et dédiée uniquement aux grandes entreprises marchandes et à la spéculation immobilière » qui domine la planification urbaine à Genève. Un large front se forme alors, composé d’entités politiques aux affinités politiques plurielles, allant du collectif informel au grand parti, qui s’empare de la question du droit à la ville. Tel est pris qui croyait prendre.
Qu’est-ce qui cloche dans cette ville qui pointe régulièrement dans les top ten des villes les plus agréables à vivre au monde pour que la colère y gronde ? À qui s’adresse la ville qu’on est en train de nous construire ? Qu’est-ce que cela veut dire de « prendre » cette ville ? Un sentiment est partagé : ça n’est plus tenable de vivre une vie bonne à Genève. La ville qui se construit n’est plus la nôtre, et les formes de vie qu’elle promeut sont définies par le néolibéralisme et le culte du travail. Nous avons affaire à une mystification bâtie sur mesure pour les riches et leurs rapports mortifères. Mais un attachement persiste : un refus de l’abandonner et un sentiment d’imposture forment un socle commun qui pousse des subjectivités diverses à s’organiser ensemble. Peut-être qu’en décortiquant minutieusement Genève, en tirant sur les fils de son histoire, nous trouverons des nœuds intéressants à démêler, des discours à démonter, des ennemis à abattre et des pistes à suivre pour nous la réapproprier.
Avant ? Après ? Maintenant !
À les écouter tous, il n’y aurait que deux conjugaisons possibles de Genève : le futur et le passé. Le futur, c’est cet horizon radieux dont nous bassinent les planificateurs urbains depuis des décennies. Ainsi, la Tribune de Genève a récemment laissé différentes personnalités politiques s’exprimer sur la Genève de 2030 – qu’elle soit écologiste, libertarienne, libérale-radicale, néo-fasciste, etc. Le refrain est souvent le même : « Quand le CEVA aura des dents, quand le quartier Praille-Acacias-Vernets volera, quand la crise du logement s’estompera, nous pourrons en n nous aimer ». Il faut beaucoup d’abnégation pour croire que la Genève idéale viendra un jour, en particulier quand on observe les processus en marche dans la ville.
Le passé, c’est la rengaine du « Genève, c’était mieux avant » – la nostalgie idéaliste d’un paradis perdu, d’une ville où il faisait bon vivre qui se décline sur t-shirts et autocollants. Or, il a toujours plu à la Garden Party des Bastions, le Duo n’était pas exactement le meilleur groupe de rap du monde, les arroseurs automatiques t’empêchaient de dormir au Parc de l’Observatoire, l’Usine a toujours dû se taper PTR et l’on pouvait très bien s’ennuyer dans un squat. Le bonheur qui viendra un jour tout comme le regret d’un passé radieux sont deux freins mentaux aux possibilités de s’organiser ici et maintenant pour prendre la ville. Ni hier, ni demain, c’est aujourd’hui que tout se joue.
La désindustrialisation et ses effets
Néanmoins, la nostalgie qui pousse à déclarer que tout était mieux avant n’est pas ancrée que dans du vent. Il est certain qu’entre les années 1980 et la fin des années 1990, Genève – comme d’autres villes en Suisse, voire dans le monde occidental – a connu un déclin démographique et économique qui a ouvert des brèches inédites. Quand une ville perd 10% de sa population, de nombreux logements restent vacants. C’est dans ce cadre, doublé d’une certaine tolérance des autorités et d’une mode internationale, que le mouvement squat a fleuri à Genève. Et même ceux qui ne squattaient pas profitaient de loyers plus doux que ceux qui se pratiquent de nos jours.
Mais dès le milieu des années 1990, le visage de Genève se métamorphose. La population se recompose. C’en est fini de la Genève industrielle ; les usines disparaissent avec leurs ouvrier.ère.s. La SIP part à Satigny, Tavaro fait faillite en 1995, Kugler vend son usine de la Jonction. Les fabriques se muent alors en ateliers d’artistes, en salles de concert ou en lofts – l’Usine, Kugler, la Parfumerie, l’appartement du procureur général Olivier Jornot, etc. Cette disparition de l’industrie est aujourd’hui tellement achevée que le concept de patrimoine industriel est devenu branché. La Haute École d’Art est très fière de son nouveau campus inséré dans une ancienne usine.
Cette mutation économique et démographique se traduit aussi dans l’équilibre des différents camps politiques en présence. En 1993, c’est l’Alliance de Gauche qui regroupe divers partis à gauche du Parti socialiste, qui finit les élections au Grand Conseil en tête. Avec les Socialistes et les Verts, la gauche représente alors près de 50% des suffrages exprimés. Les mêmes forces ne représentent plus que 39% des voix en 2013. Le Parti du Travail, comme l’industrie genevoise, s’effondre totalement en 20 ans.
« Crise du logement » ou le bal des hypocrites
Depuis 2002 et l’entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union Européenne, Genève pète la forme économiquement. Il y a bien sûr des années moins bonnes que d’autres : la « crise » du franc fort a eu des effets sur le taux de chômage. Mais globalement, le PIB genevois a explosé pendant cette dernière décennie. En parallèle, l’État avance à marche forcée pour le développement des infrastructures : le CEVA, les divers centres de recherche, le nouveau quartier de gratte-ciels prévu à la Praille, l’extension de l’aéroport et le sinistre complexe carcéral qui s’étend autour de Champ-Dollon. Cette croissance rime avec augmentation de la population et hausse des prix de l’immobilier. En effet, pendant les années 1990, personne ne voulait s’attaquer la question de la pénurie de logements. En période de basse conjoncture, cette pénurie servait objectivement les intérêts des propriétaires fonciers. Si en 2002, le Conseiller d’État Laurent Moutinot pouvait encore déclarer que les Genevois.e.s étaient bien logés, la donne va rapidement changer.
Après la vague squat, c’est dorénavant le discours sur l’urgence à réagir face au manque qui domine sur le front du logement. Les squatteuses et squatteurs deviennent des parasites à éliminer. La chasse est initiée dans les années 90 déjà, sous le règne du procureur socialiste Bernard Bertossa. Mais c’est bien le parti Libéral – Mark Muller et le procureur général Daniel Zappelli notamment – et plus globalement le virage de la politique parlementaire du canton vers la droite qui ont changé le cours des choses. L’État martèle que les squats sont un obstacle à sa nouvelle politique du logement qui va permettre de résoudre la crise. Le tour de force est réussi. Dans les discours dominants, les squatteur.euse.s deviennent même des privilégiés qui s’opposent aux intérêts des locataire.trice.s.
La nouvelle urgence devient donc la construction de logements. Ce n’est pas le souci des conditions d’habitat des Genevois.e.s qui cause ce changement de paradigme. C’est plutôt que la pénurie de logements commence à faire baisser l’attrait de Genève pour les multinationales. Et cette at- tractivité est un enjeu majeur pour la croissance locale. Les forces du capital ont donc besoin de construire du logement et cela tombe bien : les investisseurs se pressent au portillon, surtout depuis les effondrements multiples des bourses qui caractérisent cette décennie. L’immobilier suisse est un placement très sûr qui produit d’excellents rendements. On parle de 5 à 9% pour un immeuble locatif bien placé à Genève, pendant que les taux hypothécaires sont aux plus bas et que Monsieur et Madame tout le monde se voient facturer des intérêts négatifs sur leurs comptes d’épargne.
Mais pour qui construire des logements ? Plus personne ne veut du modèle d’urbanisme des années 1960 qui ont vu énormément de logements sociaux apparaître sous la forme de grands ensembles, ou « cités » – les Avanchets, le Lignon. Il s’agissait alors de loger de la main-d’œuvre ouvrière, considérée comme une part entière du processus d’accumulation du capital. Au début du 21e siècle en Suisse, le travail humain est devenu très largement superflu. Or, il y a Genève une classe d’hyperriches et de cadres subventionnées par leurs entreprises qui ont la capacité d’acheter des appartements ou de payer des loyers à des prix démesurés. C’est vers cette demande que les promoteurs immobiliers vont évidemment se tourner.
C’est dans ce contexte que le Conseiller d’État libéral Mark Muller, ancien secrétaire général de la Chambre Genevoise Immobilière, est élu à la tête du département chargé de l’urbanisme. Il est alors le fer-de-lance de celle qu’il nomme « Nouvelle Politique du Logement ». En 2006, elle scelle un accord historique entre « partenaires sociaux », celui du programme Logements d’Utillité Publique (LUP). Cet accord peut se résumer comme une mesure visant à stimuler la construction et la promotion immobilière. Il prévoit la réduction drastique du taux minimal (baisse de 33% à 15% suivant les cas) de logements sociaux construits lors d’un nouveau projet en zone de développement, ainsi qu’une augmentation massive des prix admis de vente de terrains constructible en zone agricole. En termes d’urbanisme, cela se traduit par une volonté forte, soutenue par un plan directeur d’aménagement, de densifier la ville. Tout comme il faudrait fluidifier le traffic plutôt que le réduire, Genève – toutes tendances politiques confondues – ne pense qu’à densifier plutôt qu’à questionner la vache sacrée de la croissance et ses conséquences.
Pour faire passer la pilule de ces cadeaux financiers au lobby immobilier, Mark Muller va acheter ce qu’on peut appeler la « paix du logement ». Le prix de cette paix sociale est le suivant : en échange de ces avantages faits aux promoteurs, la loi indique qu’à terme, l’État va constituer un socle de 20% de logement dits « d’utilité publique » sur tous les logements du Canton. Un logement d’utilité publique est un logement contrôlé de manière durable par l’État. Il est ainsi censé échapper aux « lois du marché » qui calquent la demande de logement sur les capacités monstrueuses des hyperriches. Il ne faut pas croire pour autant qu’un LUP est bon marché ; il faut parfois sortir 2’800 francs par mois pour 4 pièces.
Un fond public de 35’000’000 de francs par année est débloqué. L’État l’utilise pour acquérir directement des logements contrôlés. Ce fond est le bras armé de la politique foncière proactive de l’État et son contrôle est un enjeu majeur. Mais le taux de 20% de logement dit social est un objectif de la planification qui ne sera évidemment pas atteint. 10 ans plus tard, en 2017, le taux de logement LUP stagne à 10% et n’a augmenté que quelques centièmes de pour cent. On peut supposer que l’État n’a jamais visé à réaliser cet objectif. Mais le fait de poser cette contrainte en 2006 était un gage qui a permis de rallier une partie de la gauche à cet accord, notamment le Rassemblement pour une Politique Sociale du Logement.
Si certaines villes sont qualifiées de cités-dortoirs, Genève est une cité-bureaux. Il y a bien assez de surfaces bâties pour loger tous les habitants de Genève. Le taux de logement vacant environne les 0.50%, alors que le taux de vacance des bureaux est lui de près de 10%. La crise du logement n’est donc pas un phénomène économique incontrôlé, né du seul libre jeu des forces du marché. La crise du logement est aussi une arme politique, le bâton idéal pour pacifier la population. Qu’une ville entière ait à craindre de se retrouver mal-logée permet de lui faire avaler bien des couleuvres. Et pour la droite locale, très proche du lobby immobilier, cette rareté orchestrée qui fait exploser le prix du logement est une bonne chose.
Dans cette mascarade, la régie immobilière joue le rôle du bailli que toutes et tous saluent avec déférence plutôt que de lui cracher au visage. Chacune et chacun soigne son dossier, dit connaître un ami du beau-frère qui peut faire remonter sa demande en haut de la pile et craint la lettre avec la photo de la trottinette sur le palier qui viendra marquer le début d’un processus qui finira par la résiliation du bail. Pris entre le marteau de la régie et l’enclume de la crise du logement, il ne peut y avoir qu’une issue collective au cauchemar du logement genevois et le développement d’une lutte pour le droit à la ville réveille quelques espoirs.
Bouche-trous
Par son essence, la spéculation immobilière crée des lieux vides qui sont à la fois une aberration et la norme d’une économie immobilière fondée sur le profit. Ces espaces inhabités ont pu être des brèches pour des occupations. Il fut un temps où les squats avaient pour fonction de remplir ces trous. Cependant, dans la situation de développement urbain à flux tendu et le mode de gestion genevois autoritaire qui caractérise cette phase de « paix du logement », ces brèches se sont fortement rétrécies. Les squats ont beau avoir disparu, les maisons n’en demeurent pas moins vides – dans l’attente d’une destruction probable ou d’une rénovation hypothétique.
Il faut donc trouver des alternatives pour remplir les trous créés par la spéculation immobilière. Tout un milieu associatif s’est formé pour boucher ces trous. La Cigüe, coopérative de logement pour les personnes en formation accepte des contrats précaires sur des maisons vides. L’association Carrefour-Rue loge des ex-sans-abris dans des containers aménagés sur des terrains considérés comme vides, et d’autres associations – artistes, entreprises solidaires ou caritatives, etc – remplissent ce rôle avec docilité et opportunisme.
Parfois même, certains acceptent de boucher des trous qui ne sont même pas vides, comme les artistes – de Zabriskie Point et KiosK – qui ont remplacé les galériennes et galériens dans les salles d’attente du tram à Plainpalais et aux Augustins. L’office des bâtiments a un secteur de gérance spécialement dédié à créer des contrats précaires et travaille étroitement avec la BRIC, brigade de renseignement politique de la police cantonale issue de la brigade des squats, pour contrôler que tout ce petit monde se tienne à carreau.
Les acteurs de cette forme de collaboration associative, soutenus par la vision nostalgique de Genève, tournent souvent leur renoncement à la lutte en un dénigrement des radicalités. « Soyons réalistes », ce qui s’est passé à Genève dans les années 1990 ne serait plus possible aujourd’hui. En lieu et place des occupations ou autres fêtes sauvages, les spécialistes des ressources urbaines s’associent pour institutionnaliser les pratiques dites « alternatives » dans l’espoir d’obtenir des subventions qui permettent d’en vivoter, voire un lieu où les développer… dans les normes.
La culture fait partie intégrante d’une gestion de la ville et d’une « politique urbaine » consensuelle qui vise à maintenir une cohésion sociale sans conflit. On donne un peu à ceux qui pourraient ouvrir leur gueule, pour qu’ils nous foutent la paix. On parle alors de « solidarité » , de « projet collectif » voire « alternatif », de « participation », de « biens communs ». La Ville et ses cadres, souvent issus de la mouvance alterno-squat des années 1980-90 déclarent : « Vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous faisiez dans les squats, mais ça ne sera plus des squats ». Il s’agit de décharger tout le contenu antagoniste de pratiques pour n’en garder que la forme. D’ailleurs, la question du « droit à la vill e » est inscrite dans le discours de nombreux partis politiques, qui ont pris le soin d’en ôter toute charge critique, toute portée anti-capitaliste. Désormais ce qui prime, c’est la « qualité de vie ». Au point que même l’UDC surfe sur cette vague et base tout son argumentaire électoral sur la figure du Bon Genève – qui s’oppose au Grand Genève.
Contradictions urbaines
Genève est à la fois une métropole globalisée et le chef-lieu d’une zone périphérique préservée. Comme le disait récemment un conseiller national socialiste : « Genève, c’est Davos tous les jours ». Néanmoins, alors que des négociations cruciales sur le plan de la géopolitique internationale ou la signature de gros contrats se jouent à Genève, le Canton a moins d’influence au niveau fédéral qu’une ville similaire telle que Zurich. Et le microcosme politique, intellectuel ou culturel local se tient dans une dynamique villageoise. Les avions se suivent sur le tarmac de Cointrin pour déposer, tour à tour, banquiers, traders en céréales, Émirati en goguette, touristes anglais en route pour Chamonix et locaux de retour d’un week-end low-cost. Les figures de l’expat et du frontalier sont les meilleures incarnations de ce double visage genevois. Le premier est attiré par le rôle de Genève sur un plan global ; il y construit pendant quelques années sa carrière, souvent logé aux frais de sa multinationale. Il glisse dans la ville en profitant des nouvelles infrastructures qui lui sont réservées et se divertit à coup de tartares, burgers et autres happy hours. Le second est là pour profiter des retombées de l’accumulation malsaine de capital qui prend place à Genève. Il joue un rôle d’auxiliaire dans le système et se retrouve logé où il peut se le permettre, à la périphérie, en France. Il cultive un rapport ambigu à une ville où il passe le plus clair de son temps, mais qui n’est pas taillée pour lui. Et où il ne tisse aucun lien social.
En 1873, le richissime Charles II de Brunswick meurt en exil à Genève. Dans son testament, il propose de léguer toute sa fortune à la Ville de Genève en l’échange de belles funérailles et d’un monument en son honneur, rien de moins qu’une reproduction du tombeau des Médicis à Florence. Exiger l’érection de la statue d’un catholique au cœur de Genève l’iconoclaste, cela provoque alors un vif débat. Mais, la Rome protestante n’hésite pas à abandonner tous ses principes face à la perspective de toucher un petit pactole. Car si Genève est une terre de refuge, elle l’est d’abord pour les plus fortunés des exilés. Le nerf de la guerre à Genève, c’est le fric, le gros fric. La figure du bon riche qui nous arrose est devenue familière à Genève depuis la tombe de Brunswick. Il y a la Fondation Wilsdorf et ses fonds intarissables, l’argent sale de Jean-Claude Gandur que l’on refuse pour le Musée d’Art et d’Histoire ou les millions d’Abdallah Chattila que l’on accepte pour le skatepark. On retrouve le fantôme du bon riche dans tous ces parcs et jardins, vestiges de domaines légués par de vieilles familles patriciennes. Mais ce n’est pas pour nos beaux yeux que, sous le stratus, il pleut de l’argent.
L’attrait de Genève ne réside pas uniquement dans l’écrin de sa rade ou la blancheur du panache de son jet d’eau. C’est la douceur de son bouclier fiscal ou la compétence de ses avocats d’affaires et banquiers privés qui séduit nombre de ses nouveaux habitants. Le Canton et la Ville participent au grand jeu de la concurrence entre villes, cantons et pays pour attirer le bourgeois. Dans l’économie globalisée du 21e siècle, Genève se veut un pôle attractif pour le capital, à tout prix. Le premier mécanisme qui structure la ville, c’est l’intérêt privé. Et le racolage des capitaux privés se joue à un niveau international. Quand les princes saoudiens se retrouvent en prison, la rue du Rhône est à la peine. Quand les montres suisses sont considérées comme des preuves de corruption en Chine, c’est l’horlogerie genevoise qui taille dans sa masse salariale. Même si SolidaritéS gagnait tous les sièges lors des prochaines élections, ses élus ne pourraient pas faire grand-chose de cette ville sans une remise en question radicale de son fonctionnement présent.
Aujourd’hui, ce qui domine l’économie en Ville de Genève, ce qui porte sa croissance, ce sont les services, en particulier les services aux entreprises – conseils juridiques, maintenance, propreté, sécurité, logistique, etc. Les industries à très forte valeur ajoutée qui persistent – horlogerie et mécanique de précision par exemple – se sont exilées loin du centre, dans les différentes zones industrielles qui encerclent Genève. Au cœur de la ville, tous les suceurs de sang du monde se retrouvent pour vaquer à leurs spéculations morbides – finance, avocats d’affaires, négoce de pétrole ou de blé. Autour d’eux, une nuée de serviteur.euse.s ramassent les miettes de leurs profits – du restaurateur bistronomique branché à l’entrepreneur aux rênes d’un empire de gestion de la propreté. L’immobilier, avec toute sa capacité de nuisance n’est responsable que de 1,5% des emplois à Genève. Certains ont fait leur business de siphonner l’argent des expats. Et par ricochet, c’est la qualité vie de toutes les habitantes et habitants de Genève qui baisse au fur et à mesure de l’augmentation spéculative du prix du renversé.
On s’occupe de tout !
Pour l’instant, la réaction politique aux mutations de Genève avec le plus de succès est une réaction droitière qui s’affirme dans les urnes. C’est le MCG et l’UDC qui sont parvenus à se profiler comme des opposants à la ville qui se construit sous nos yeux. Avec leurs mots d’ordre réactionnaires, ces formations font mouche chez celles et ceux qui se plaignent des attaques contre la classe moyenne, de la destruction de leur ville. Les mots d’ordre de ces partis sont particulièrement iniques dans la mesure où ils tapent sur le symptôme – le frontalier, le migrant – plutôt que sur la cause des mutations de Genève – son asservissement total aux logiques du capital. Au niveau de l’aménagement de la ville et du territoire aussi, l’opposition est plus aguerrie à droite. Le lobby des propriétaires de villa et l’UDC sont les premiers à défier l’État sur des questions de densification. Ils ont même commencé à faire des manifestations qui remportent un certain succès. Mais d’autres sensibilités en ont ras le bol de la fuite en avant que l’on nous présente comme le progrès.
Le mouvement qui s’est formé autour de Malagnou montre bien qu’il existe un autre antagonisme à la Genève que l’on nous bâtit. Cette opposition n’a pas comme première cible la densification ; elle ne se mobilise pas sur la corde sensible du « Pas de ça chez moi ». Ses composantes se sont agrégées autour de la défense de la maison de Malagnou dans la mesure où cette histoire cristallisait de nombreuses autres frustrations. Malagnou incarne une autre manière de vivre – bas loyer, habitat collectif, espace pour l’organisation politique, la solidarité, mais aussi la fête – qui fait cruellement défaut à Genève. Contrairement au mouvement de résistance aux évacuations de squats des années 2000, la défense de Malagnou et le mouvement pour le droit à la ville ouvrent une nouvelle séquence.
2015 a été une année « chaude » à Genève. Plusieurs événements se sont succédé dans une temporalité très courte : au printemps, un mouvement de base de migrantes et migrants refusant de vivre dans les bunkers occupent la Maison des arts du Grütli, à l’automne, une mobilisation syndicale de fonctionnaires contre l’austérité ainsi que des manifestations du centre culturel autogéré l’Usine contre une nouvelle loi sur les divertissements ont lieu. Alors que ces deux derniers mouvements sont sur le déclin, un appel à une manifestation nocturne « sauvage » pour la réappropriation de la rue est lancé. La nuit du 19 décembre 2015, ce cortège festif traverse le centre-ville de Genève. Il macule les façades des boutiques de luxe et du Grand Théâtre – marqué « à vie » par l’huile de vidange – et s’attaque au magasin d’e-cigarettes d’Eric Stauffer. L’improvisation de la police et les dégâts occasionnés provoquent une polémique « anticasseurs » très virulente. En découlent des arrestations et condamnations sévères ainsi qu’une petite crise institutionnelle. Logiquement, les manifestations suivantes sont marquées par un chage accru de leurs participantes et participants, ainsi que par des nasses ou gros déploiements policiers au moindre « pet de travers ».
Dans ce contexte verrouillé, le mouvement autour de la défense de la maison collective de Malagnou est parvenu à reconstruire une opposition de rue forte et déterminée. Pour y arriver, il a été fait usage de l’arme de l’humour doublée d’un effort pour éviter d’être rangé par le pouvoir dans la case « squatteurs ». L’assignation de cette identité aurait relégué la défense de la maison dans une position minoritaire suicidaire. En allant à la rencontre de différentes organisations démocratiques qui portent une opposition aux projets de la droite genevoise sur la question du logement et en portant un discours politique public dans les médias, Malagnou est parvenu à monter une coordination large au printemps 2017. Ses trois grandes composantes sont : le secteur associatif anti-gentrification (Comité des associations de quartiers, collectifs ou quidam), les acteur.trice.s culturels (l’Usine, La Culture Lutte et quelques autres) et les partis de gauche (SolidaritéS, Verts et PS). Ce genre de coalition large n’est pas vraiment inédite ; c’était courant dans la première moitié des années 2000 au sein du mouvement anti-globalisation lors des manifestations contre le WEF ou l’OMC. Aujourd’hui, l’idée est d’avancer de concert dans la création d’un large front contre la situation catastrophique du logement et l’absence de lieux autogérés à Genève. Cette dynamique laisse à chaque composante un espace pour s’exprimer et articuler ses revendications propres. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de porte-parole commun. Aucun accord électoral n’est en jeu. Si des élues ou élus ont participé aux réunions de coordination, c’est au même titre que les autres participante.e.s. Le comité unitaire n’a pas pour but de servir de véhicule à des carrières politiciennes.
La première manifestation initiée par cette coordination a eu lieu le 1er juillet 2017. Le mot d’ordre du « droit à la ville » a ainsi réuni une composante jeune, très disponible à la participation et qui s’est emparée du mouvement de manière festive et spontanée, mais aussi des actrices et acteurs plus âgés – des anciens squatteur.euse.s aux « soixante-huitards ». Son encourageant succès a poussé les gens à remettre le couvert ! Le succès de la seconde manifestation « Prenons la ville ! » du 7 octobre 2017 est encore plus net. Elle se déploie avec une belle énergie qui vise à la réappropriation de l’espace urbain. La composition est sensiblement la même, et le nombre de participant.e.s dépasse les 2’000. Les acteur.trice.s impliqués s’emparent de cette lutte avec toujours plus de détermination. Le cortège se termine par une occupation de place avec une fête foraine déjantée. La structure cognitive des manifestantes et manifestants peut être décrite comme hétéroclite. Mais deux choses sont notables : un refus d’acheter le « rêve helvétique » et de modeler intégralement son quotidien en fonction de son occupation salariale et professionnelle, ainsi que le sentiment, bien réel, que les évolutions urbaines rendent ce territoire hostile, et qu’une guerre larvée a lieu en ville. Dès lors que c’est le capital qui fixe les règles du jeu, il va donc falloir les enfreindre pour résister. Les chants entonnés ce jour-là indiquent un décrochage d’un pan entier de la jeunesse envers la ville qui l’entoure. L’ensemble est très compact, joyeux et déterminé. On se serre les coudes et le moment où le cortège se met à courir dans la principale artère marchande fait paniquer les pandores et gonfler les poitrines d’optimisme pour la suite. On peut donc retenir du 7 octobre une nette accumulation de force et une prise de confiance dans ses propres possibilités. Mais il faut aussi reconnaître que le mouvement n’est jusqu’à présent pas parvenu à une intensité de conflit suffisante pour troubler (même provisoirement) la normalité capitaliste.
Le bilan de l’occupation de l’ancien immeuble H&M pour une fête le 31 décembre 2017 est nuancé. Cette action ose un pas en avant dans un mouvement qui se cherche, mais elle conduit à un nombre démesuré d’arrestations. Ce qui est en tout cas certain, c’est que le potentiel de rupture incarné par la composition hétérogène de ces deux manifestations est encore intact, parce que l’Etat – qui ne peut pas traiter ces manifs comme des « manif de casseurs » – reste pour l’instant circonspect. Dans ce contexte, les camarades de « l’aire extra-parlementaire » ont parfois de la peine à apporter des propositions claires pour la suite du mouvement, oscillant entre un désir d’emmener la coalition vers des pratiques plus radicales et la crainte de perdre son soutien.
Un premier problème à surmonter est le côté très « localiste » de la mobilisation. Les succès d’une lutte comme celle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes provient notamment du fait d’avoir créé un imaginaire de lutte qui dépassait leur petite zone de Loire Atlantique. D’autre part, on connaît un dé cit de propositions sur la manière de mener une lutte anti-capitaliste alors même qu’avec Malagnou, se dessine une occasion en or de ne plus être, pour une fois, à la « gauche de l’extrême gauche », c’est-à-dire de (pour)suivre l’agenda poilitique de l’extrême gauche institutionnelle en essayant avec plus ou moins de succès d’y amener des thématiques « radicales ». La coalition actuelle est un outil, un instrument envers des buts déterminés, en l’occurrence, orienter la recherche des antagonismes qui émanent de la société vers un développement radical, en vue d’une rupture avec l’ordre en place. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 17 mars 2018 pour une troisième manifestation Prenons la ville, en espérant que ce moment de lutte confirmera la dynamique actuelle.
P.-S.: Ce texte fut initialement publié sous la forme d’une brochure qui rassemble également divers extraits, citations et coupures de presse sur le thème du droit à ville. Pour recevoir la brochure, contactez prenons-la-ville@@@riseup.net.
[Publié le 16 mars 2018 sur renverse.co.]