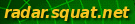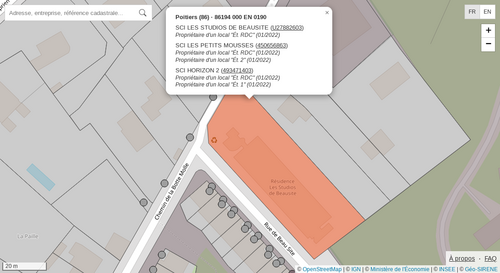Article sur les tentatives de légalisation des squats en France, paru dans « Cette Semaine » n°80 – mai/juin 2000 (BP 275 – 54005 Nancy cedex):
SQUATS : LUTTER OU SE LÉGALISER ?
Alors que des squats continuent de se faire expulser, refusant tout compromis avec l’Etat ou les propriétaires, luttant plutôt par le biais de liens avec le quartier et de barricadages, réinvestissent même parfois les lieux après expulsion (comme ce fut le cas du squat Dada aux Lilas), d’autres croient avoir trouvé la solution en réclamant leur légalisation. Si beaucoup se définissent comme «artistiques», ce n’est pas toujours le cas. Certains squats que nous avons fréquenté prennent le même chemin…
DE LA COGESTION ASSOCIATIVE…
L’idée de légaliser les squats n’est pas nouvelle et s’exprime par exemple depuis plusieurs années par la voix du DAL (Droit au Logement). Créé en octobre 1990 à partir des luttes de la place de la Réunion, en scissionnant une partie des familles pour s’allier avec les caritatifs comme Emmaüs et négocier avec l’Etat, le DAL s’est érigé en spécialiste de la cogestion de la misère. A partir de l’occupation de la rue du Dragon (Paris-6e), profitant de la campagne pour les élections présidentielles, s’appuyant sur des «personnalités» médiatiques, le DAL a fait du lobbying pour ressusciter une ordonnance de 1945 sur la réquisition de logements vides. Dès lors, il ne s’agira pas de réappropriations ou d’occupations mais simplement de réquisitions, appelant l’Etat à se saisir lui-même de ces immeubles, pour en confier ensuite la gestion -la surveillance- à des associations comme Emmaüs, le DAL, l’Armée du Salut, etc… Ainsi, il n’est jamais question pour lui de squatter des immeubles mais plutôt de faire des coups médiatiques afin de caser ses listes dans celles de l’Etat. De même, le Comité des Sans-Logis, issu d’une scission de la Coordination des Sans Abris fin 1993 avec l’aide du DAL (dont il fit officiellement partie jusqu’en 1996), précise bien qu’il n’est pas question de squatter, mais bien d’appliquer cette ordonnance, puis de travailler main dans la main avec l’Etat 1. Le DAL et le CDSL (qui s’occupe des célibataires), depuis plusieurs années, occupent donc le terrain de la légalité et de la cogestion, y compris pour les HLM (à Paris, le DAL trie parmi ses familles celles qui se verront attribuer un HLM par l’OPAC).
A l’inverse, de la même façon que certains s’agitent à la télé et entraînent les sans-abris de campements bidons en hôtels sociaux insalubres, d’autres s’organisent pour squatter et prendre en main leur vie. Des familles africaines par exemple, reprenant l’idée du foyer, squattent de nombreux immeubles, ce qui est également le cas d’autres squatters, plutôt jeunes (il ne reste que peu de personnes issues de la «mouvance autonome» qui continuent sur cette voie). Durant ces dernières années à Paris, il y a par exemple eu les squats qui vont de la rue de Charonne à celle de Maraîchers ou de l’avenue Jaurès à la rue des Orteaux (voir précédents n° de CETTE SEMAINE).
…A LA DEMANDE DE LÉGALISATION
Récemment, divers squats, issus de la mouvance artistique et des squatters plus politiques (selon l’auto-définition des uns et des autres), se sont pourtant alliés pour réclamer leur légalisation. Petit aperçu de squats qui ont signé cet appel :
o On trouve tout d’abord le squat artistique de la Grange aux Belles (Paris-10e) ouvert au n°31 depuis 1995 et moteur de cette initiative. Se posant essentiellement comme un lieu culturel palliant les déficits d’équipements municipaux, ce collectif a fait l’objet du soutien du PS local, dont le maire du 10e arrondissement, Tony Dreyfus, s’est même fendu d’une lettre de soutien le 30 octobre 1998 à Jean Tibéri ! De même, Anne-Charlotte Berger, son adjointe, faisait remarquer qu’«il ne s’agit pas de s’opposer aux droits de la propriété. Le 31 rue de la Grange aux Belles est un lieu parfaitement géré» 2. Mais il est vrai que ce squat avait déjà signé une convention avec son premier propriétaire. Le procès en référé du 25 septembre 96 ne l’avait en effet pas condamné à l’expulsion mais avait nommé un médiateur. Cette convention stipulait notamment l’engagement de déménager dès le début des travaux et «l’occupation paisible et l’entretien courant des locaux». Le nouvel acquéreur du lieu obtiendra lui, par référé du 12 octobre 98, l’expulsion sous 4 mois plus une amende de 5000 francs au titre d’indemnité d’occupation. Depuis, La Grange aux Belles pétitionne contre son expulsion et compte sur le PS. Les démocrates, squatters ou non, ne sont jamais plus désappointés que lorsqu’ils trouvent en face des capitalistes francs du collier.
o L’espace autogéré des Tanneries, ouvert à Dijon le 30 octobre 1998 au 13-15 boulevard de Chicago. Ce squat, fréquenté par bon nombre de personnes se réclamant de la mouvance libertaire 3, constitue une anomalie dans la liste. Apparemment, seule une minorité aurait signé, engageant par là le reste du collectif sans qu’aucun démenti n’ait circulé. Toutefois, une particularité des squats à Dijon est de mélanger radicalisme et réformisme 4, un manque de clarification ayant pu amener à ce genre de dérives. Lorsque les Tanneries ont appris que le lieu était expulsable, la première réaction fut par exemple d’entamer des discussions avec le maire RPR de la ville, accompagnées de fêtes de soutien au lieu pour prouver combien ce lieu était indispensable à la ville («ce lieu est rapidement devenu un centre culturel important au sein de l’agglomération dijonnaise»). Auparavant, les habitantEs s’étaient déjà mis d’accord pour proposer de signer un bail précaire, ce qui leur fut toutefois refusé. Depuis fin 99, L’espace autogéré des Tanneries a obtenu la promesse d’une non-expulsion en échange de la remise aux normes de sécurité et organise une souscription et des concerts pour financer ces travaux !
o Le squat Chez Emile, ouvert à Rouen 16 rue de Tunis et habité depuis mai 1996. Ce squat, comme les nombreux autres de la liste des signataires que nous ne détaillerons pas plus avant, se revendique notamment de la mouvance artistique. En septembre 97, le procès en référé leur laisse trois ans de délais mais le 27 octobre 99, l’appel du propriétaire ne leur laisse plus que deux mois. Comme les Tanneries, ce squat a été fréquenté par des libertaires. Dans leur dossier, on trouve ainsi des phrases telles que : «Nous faisons partie des gens qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Nous refusons la toute puissance de la valeur travail, pour le contrôle social et l’aliénation qu’elle opère sur les individuEs. Nous refusons aussi la logique de consommation, pour le conditionnement mental qu’elle exerce et la passivité qui en résulte. Bien au contraire, nous pensons que l’épanouissement de chacunE passe par la découverte de ses désirs, la possibilité de les réaliser, par la reconnaissance de l’être (non du paraître, ni du produire)». Cependant, eux aussi se sont engagés dans la voie de la négociation avec le pouvoir, notamment pour chercher un nouveau lieu. Ils ont par exemple contacté la SNCF, la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) et diverses municipalités pour ce faire. Leur logique à ce sujet est on ne peut plus claire : «Nous pensons qu’une réflexion et un dialogue sont souhaitables et permettraient de mettre en place des dispositifs autorisant la pérennité de notre action et son officialisation. Des solutions à des situations analogues ont été trouvées et sont rentrées dans les moeurs dans différents pays d’Europe, comme la Suisse, l’Allemagne, les Pays Bas. Elles prévoient des accords entre squatteurs et institutions ; elles amènent stabilité et démarginalisation pour les uns, et un apport de cohésion sociale, ainsi que des garanties pour les autres» 5.
Au total, ce ne sont pas moins d’une quinzaine de lieux qui ont signé le texte appelant à une légalisation, repris par une partie de la presse, puisque telle était leur volonté 6. Ce long libellé contient les revendications suivantes, partant de l’idée de signer des conventions d’occupation ou des contrats de confiance avec les propriétaires, le tout garanti par l’Etat :
«Compte rendu des rencontres réunissant
plusieurs squats de France.
(…)
Nous proposons :
1) Que l’état puisse être médiateur et garant moral de ces collectifs auprès de propriétaires privés disposant de lieux vacants appropriés à la mise en place de projets créatifs et donne l’exemple en tant que propriétaire.
2) Que les pouvoirs publics locaux soient soumis à une charte nationale à établir par les présents, l’état et des juristes compétents, concernant les conventions d’occupation de lieux vacants.
3) Que l’état s’engage à exonérer partiellement de taxes foncières et impôts locaux (ou autres incitatifs fiscaux) les propriétaires privés établissant ces dits contrats.
4) Qu’au titre de la sécurité des personnes, des publics et des lieux, des travaux de mise aux normes puissent être engagés : les occupants fournissant la main d’ouvre nécessaire en concertation avec des cabinets d’architectes compétents, les pouvoirs publics pouvant intervenir en subventionnant les matériaux.
5) Le droit aux fluides (électricité et eau) étant inaliénable, les pouvoirs publics s’engagent à faire respecter ce droit.
6) Que les lois de réquisition et contre l’exclusion soient régénérées et que l’état leur donne force d’application.»
L’ILLUSION RÉFORMISTE
Lorsque des squats s’ouvrent et réclament leur légalisation, on peut penser qu’il s’agit simplement d’une volonté d’intégration à l’ordre capitaliste, l’illégalité n’étant qu’une contrainte passagère vécue comme telle. Tout le monde n’a pas hérité d’un appartement et ne se voit pas encore louer des espaces suffisamment grands pour «créer» ! En ce sens, il s’agit d’une tactique plus efficace parfois que de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’HLM ou de loft d’artistes et de patienter sagement. La négociation avec les élus, le dialogue avec l’Etat ou les propriétaires n’est qu’un mauvais moment à passer.
C’est un tout autre problème que de se revendiquer «alternatif» (quoique ce mot exprime bien la volonté de rester dans le système capitaliste) voire «radical» d’un côté et même d’essayer de le vivre (autogestion, application du prix libre, réflexion sur le patriarcat, pratiques de débrouille) puis, d’un autre côté, de s’engager dans ce genre de démarche. Peut-on en même temps se revendiquer anarchiste et se vanter de respecter le code de procédure pénale et d’être pacifistes (squat Saumaise à Dijon, qui n’a pas signé la demande de légalisation) ? Si on laisse de côté les lieux qui se revendiquent du seul aspect artistique (l’art comme activité séparée), la revendication de la légalisation de la part de lieux ayant une démarche libertaire (cas des Tanneries de Dijon, de Chez Emile de Rouen, du Clandé de Toulouse, signataires) se place directement au travers de la route de celles et ceux qui refusent l’alternative pour préférer la rupture et qui préfèrent lutter sans pétitions, dossier de presse et autres conciliabules démocratiques pour éviter l’expulsion. Plus certainEs se dissocient des luttes plus radicales et plus l’Etat peut frapper fort sur ces dernières.
L’un des gros leurres des squats souhaitant se placer naïvement sous tutelle est en effet de considérer que le squat est une fin en soi, que tenir le lieu est un objectif prioritaire. Or à l’inverse, le fait de squatter, pour prendre un sens rupturiste, doit être partie prenante de la lutte de classe. L’appropriation d’espaces qui deviennent des lieux subversifs ne peut se faire qu’à la condition qu’ils ne soient pas séparés du reste des luttes. En ce sens, il n’est pas possible de tenir un lieu bien longtemps (deux ans au plus sur Paris), l’expression vivante de ces potentialités radicales empêchant définitivement toute pérennité du lieu en l’état actuel du rapport de force. Peut-on en effet être un lieu d’agitation sociale à la face de tous et toutes tout en restant dans l’illégalité revendiquée sans être rapidement expulsé ? Lorsque les habitantEs d’un squat l’ouvrent non seulement à des activités dites artistiques (mais qui réduisent toujours la plupart des personnes à l’état de spectateurs même s’ils n’ont pas payé l’entrée) comme des concerts, du théâtre ou des expos, mais également à des discussions/débats où se nouent des complicités, des réunions d’où partent des complots contre ce vieux monde, des échanges de savoirs liés à des pratiques quotidiennes de subversion (sabotages, tags, réappropriations diverses,…), dans ces cas il n’est plus possible de penser le squat comme un lieu qui opérerait la distinction intérieur/extérieur, mais plutôt de le penser comme un pôle de luttes parmi d’autres. Le maintien d’un squat dans ces conditions dépend donc de l’état même de la lutte à l’extérieur dont il est un prolongement 7. Tenir un lieu coûte que coûte en prenant prétexte que ce qui s’y passe vaut bien une institutionnalisation partielle relève alors de la simple satisfaction du désir des occupantEs. Et il se trouve que pour une partie d’autres squatters, ces désirs sont totalement incompatibles avec un Etat «garant», une main d’oeuvre gratuite sous la responsabilité d’un architecte ou la signature d’une convention avec un propriétaire, toutes choses qui entravent nécessairement ce qui peut se passer dans un lieu.
C’est alors un non-sens que d’avoir tout dialogue ou compromis avec des ennemis, qu’ils s’incarnent dans la sale gueule de l’huissier, du serrurier, du propriétaire et de ses sbires ou de l’élu local et des médias à ses bottes. Que des artistes suivent le chemin qui leur est tout tracé dans cette société, des marges de l’avant-garde aux expos dans les halls de fondations avant de finir en musée est une chose 8, que des lieux plus proches les rejoignent au nom d’une relative stabilité pour s’organiser librement (de quelle liberté parlent-ils, ceux qui se lient par contrats avec leur ennemi d’hier ?) en est une autre. La résistance la plus efficace pour continuer de vivre comme on l’entend, outre le barricadage et l’ouverture au quartier, ne réside-t-elle pas à l’inverse dans l’aspect collectif, c’est-à-dire la multiplication de lieux qui refusent ces compromis-là ? L’expérience des squats dans un quartier comme celui de la Réunion (20e) à Paris ou des pentes de la Croix-Rousse à Lyon montre que c’est justement dans cette seule optique qu’ils peuvent durer.
Aujourd’hui, la situation en France n’est justement pas encore celle de l’Allemagne par exemple où un vaste mouvement de légalisation a eu lieu et où squatter sans conventions est devenu quasi-impossible en l’état du rapport de force. En devançant l’intégration totale, les squats qui ont signé cet appel 9 s’engagent ainsi dans un processus qui voit des naïfs réclamer plus d’ordures mais constitue surtout un danger pour les autres. Des copains/copines du squat Dada sont déjà allés rendre visite aux occupants de La Grange aux Belles. Face à ceux/celles qui ont choisi de se vendre au plus offrant, ceux/celles qui ne partagent pas que leur temps entre le squat, les études à la fac et leurs «créations». se regroupent également. L’an dernier une intersquat s’était montée de bric et de broc, intervenant toutefois contre une exposition d’architectes, un cabinet d’avocats d’expulseurs, des agences EDF et menant une manifestation festive et sauvage. Depuis la réoccupation du squat Dada le 15 avril, une coordination informelle entre divers squats se met en place. A suivre…
Un squatter en colère
1 «Il est très important pour nous, comme pour le DAL, d’entrer dans un processus de négociation avec les pouvoirs publics et de remporter des victoires» précise son président, J-Y Cottin dans le bouquin d’autopromotion des gauchistes (Les nouveaux sans-culottes, J-C Brochier & H Delouche, Grasset, 2000, p97).
2 Le Parisien, 19/11/98
3 Il a par exemple fait l’objet d’un communiqué de presse paru dans Courant Alternatif (journal publié par l’OCL) n°91, été 1999.
4 Ainsi, le squat situé 3 rue Saumaise (expulsé le 5 avril 2000 et qui a réouvert au 11 rue Chevreul) peut à la fois dénoncer les brutalités policières et revendiquer que «nos pratiques sont la preuve que l’on peut s’organiser seul-e-s, sans chef, sans institution ni subventions» tout en précisant que «depuis quelques temps, des groupes de personnes, pour la plupart précaires, chômeurs et chômeuses, RMistes, étudiant-e-s prennent leur existence en main, et ouvrent des bâtiments à l’abandon, en respectant le code de procédure pénale. Les squatters-euses de Dijon se sont toujours montré-e-s pacifiques» (tract suite au tabassage des keufs subi le 20-21/3. Conclusion : 3 mois avec sursis et 14 000 francs d’amende pour le tabassé et un mois avec sursis pour un autre squatteur, verdict du 4/4/00)…
5 Extraits du dossier disponible sur leur site internet (www.spyh.com/emile/). Ce squat a notamment été soutenu par le label et zine On a faim !
6 Notamment Libération du 3/4/00 p39 et Le Parisien du 7/4/00 pIII
7 Rappelons que le fait de squatter est considéré en France depuis 1991 comme un délit continu, ce qui signifie qu’il peut être expulsé à tout moment (la trêve d’hiver est théorique, tout comme les fameuses 48 heures). De plus, la préfecture peut toujours évoquer le trouble à l’ordre public ou l’insalubrité.
8 Un chargé de mission au ministère de la culture a ainsi pu dire d’eux : «Ce mouvement est une immense rencontre éphémère, avec des chefs de tribus qui proposent un jeu de société correct» (Libé, 3/4/00 p39).
9 Le texte de l’intersquat mentionne seulement une liste de «présents» pour élaborer ce texte. Espérons que certains squats s’en sont par la suite démarqués, distinguant la présence de certainEs de leurs membres de l’engagement du squat tout entier. Cependant, je ne vois pas comment rester à une réunion qui s’engage sur de telles bases…